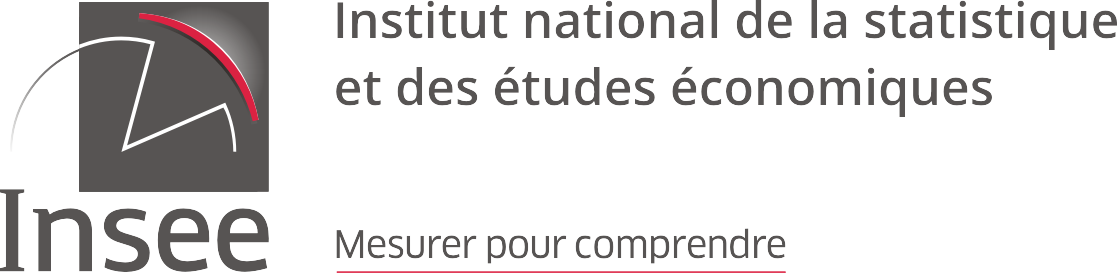Revenus et patrimoine des ménages Édition 2021
L'Insee présente avec Revenus et patrimoine des ménages les principaux indicateurs et des analyses sur les inégalités monétaires, la pauvreté et le patrimoine des ménages.
Inégalités de niveau de vie et pauvreté entre 2008 et 2018
Michaël Sicsic (Insee)
En 2018, en France métropolitaine, la moitié de la population a un niveau de vie inférieur à 1 771 euros par mois, un niveau légèrement plus élevé que celui de 2008 en euros constants. Le niveau de vie plafond des 10 % les plus modestes reste lui inférieur à celui de 2008, du fait de la baisse du revenu avant redistribution ; cette baisse est elle‑même liée à la hausse du nombre de chômeurs chez les plus modestes. À l’inverse, les revenus avant redistribution des plus aisés ont augmenté. Finalement, les inégalités avant redistribution ont fortement augmenté depuis 10 ans. Le système socio‑fiscal a amorti cette hausse : en 2018, après redistribution, les inégalités sont légèrement supérieures à leur niveau de 2008.
En 2018, 14,8 % des personnes habitant en logement ordinaire vivent au‑dessous du seuil de pauvreté en France métropolitaine, soit 9,3 millions de personnes. Les chômeurs, les jeunes adultes et les familles monoparentales sont beaucoup plus exposés à la pauvreté. Si le taux de pauvreté global en 2018 est proche de celui de 1996, celui des adultes inactifs hors retraités (étudiants vivant chez leurs parents et hommes ou femmes au foyer) a fortement augmenté. L’intensité de la pauvreté est globalement stable depuis 2008, malgré une forte hausse avant redistribution initiée en 2002. La redistribution réduit aussi fortement le taux de pauvreté, qui serait plus élevé de 7,5 points en 2018 en l’absence de transferts.
En prenant en compte des populations habituellement non comptabilisées (communautés, sans‑abri, habitations mobiles, étudiants non cohabitants), environ 10 millions de personnes seraient sous le seuil de pauvreté en France métropolitaine. Dans les DOM, 940 000 personnes sont en deçà du seuil de pauvreté national.
Les inégalités de niveau de vie et la pauvreté sont beaucoup plus élevées en Île‑de‑France (notamment à Paris) et dans les DOM, et plus généralement dans les communes denses, notamment les communes‑centres. Les inégalités de niveau de vie, le taux de pauvreté et l’intensité de la pauvreté sont relativement faibles en France par rapport à la majorité des pays de l’OCDE.
Insee Références
Paru le :27/05/2021
- Les niveaux de vie en 2018
- La médiane des niveaux de vie est légèrement plus élevée en 2018 qu’en 2008, mais pas le premier décile
- Les inégalités ont légèrement augmenté entre 2008 et 2018
- La hausse des inégalités avant redistribution est liée à la baisse des revenus avant redistribution des plus modestes
- La hausse des inégalités avant redistribution est également liée au dynamisme des hauts revenus
- Le système socio‑fiscal a limité la hausse des inégalités depuis 2013
- Les inégalités sont beaucoup plus élevées à Paris et dans les communes denses
- Les inégalités sont plus faibles en France que chez ses principaux partenaires internationaux
- 14,8 % de la population vit au‑dessous du seuil de pauvreté en 2018
- La redistribution réduit le taux de pauvreté de 7,5 points
- Les chômeurs, les jeunes et les familles monoparentales sont beaucoup plus exposés à la pauvreté
- En prenant en compte les communautés, les sans‑domicile et les étudiants, environ 10 millions de personnes seraient en situation de pauvreté en France métropolitaine
- Le taux de pauvreté est plus élevé dans les zones denses
- La France a un des taux de pauvreté les plus bas de l’Union européenne
- Encadré 1 - Un premier éclairage sur l’évolution des revenus en 2020
- Encadré 2 - Effet de la réduction du loyer de solidarité
- Encadré 3 - Estimation du nombre de personnes pauvres non comptabilisées habituellement
Les niveaux de vie en 2018
En 2018, la moitié des personnes vivant dans un ménage de France métropolitaine ont un niveau de vie inférieur à 1 771 euros par mois, soit 21 250 euros par an. Ce niveau de vie médian correspond à un revenu disponible de 1 771 euros par mois pour une personne seule et de 3 719 euros par mois pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans.
L’effet de la pandémie de Covid‑19 sur les niveaux de vie est encore inconnu à la date de sortie de l’ouvrage. Des premières indications sur l’évolution des revenus en 2020, mais sur des concepts différents de celui de cette vue d’ensemble, sont données dans l’encadré 1.
La médiane des niveaux de vie est légèrement plus élevée en 2018 qu’en 2008, mais pas le premier décile
En 2018, le niveau de vie médian s’accroît de 0,3 % en euros constants par rapport à 2017 (figure 1). C’est la cinquième année de hausse consécutive, après une baisse de 0,4 % en moyenne annuelle entre 2009 et 2013. Cette légère augmentation traduit l’amélioration de l’activité économique de ces années, mais elle reste plus faible que la croissance du PIB par unité de consommation (UC) depuis 2016. Alors qu’il augmentait régulièrement depuis 1970, le niveau de vie médian a tendance à stagner depuis la crise économique de 2008 [Blasco et Picard, 2019]. En 2018, le niveau de vie médian n’est supérieur que de 1 % à son niveau de 2008. Cette quasi stagnation contraste avec la période plus dynamique du milieu des années 2000, pendant laquelle le niveau de vie médian évoluait plus rapidement que le PIB (+ 1,7 % par an en moyenne entre 2004 et 2008). Globalement, depuis 1996, le niveau de vie évolue d’une façon relativement proche du PIB, mais avec des évolutions moins heurtées, en suivant les fluctuations conjoncturelles avec un peu de retard [Boiron et al., 2016].
tableauFigure 1 - Évolution des déciles de niveau de vie de 1996 à 2018
| PIB en volume par unité de consommation | Niveau de vie | |||
|---|---|---|---|---|
| 1er décile | Médiane | 9e décile | ||
| 1996 | 84,0 | 81,2 | 84,7 | 84,4 |
| 1997 | 85,5 | 81,6 | 84,8 | 84,5 |
| 1998 | 88,0 | 85,1 | 86,6 | 86,1 |
| 1999 | 90,4 | 87,1 | 87,9 | 88,9 |
| 2000 | 93,2 | 88,5 | 89,5 | 91,6 |
| 2001 | 94,3 | 91,5 | 91,7 | 92,8 |
| 2002 | 94,5 | 94,6 | 94,1 | 95,0 |
| 2003 | 94,6 | 94,3 | 93,8 | 93,5 |
| 2004 | 96,5 | 94,5 | 93,4 | 92,4 |
| 2005 | 97,4 | 94,7 | 95,0 | 93,9 |
| 2006 | 99,1 | 95,9 | 96,3 | 96,8 |
| 2007 | 100,6 | 97,8 | 98,4 | 98,0 |
| 2008 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2009 | 96,4 | 98,9 | 100,4 | 100,7 |
| 2010 | 97,5 | 97,5 | 99,9 | 100,4 |
| 2011 | 99,0 | 96,7 | 99,9 | 102,5 |
| 2012 | 98,6 | 95,6 | 99,0 | 100,6 |
| 2013 | 98,5 | 96,9 | 98,7 | 98,8 |
| 2014 | 98,8 | 96,6 | 99,0 | 98,1 |
| 2015 | 99,3 | 96,9 | 99,4 | 99,5 |
| 2016 | 99,8 | 98,4 | 100,3 | 99,5 |
| 2017 | 101,5 | 98,6 | 100,7 | 100,1 |
| 2018 | 102,7 | 97,1 | 101,0 | 100,7 |
- Lecture : entre 2008 et 2018, le 1er décile de niveau de vie a baissé de 3 %.
- Champ : France pour le PIB ; France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré à l'administration fiscale est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante pour les déciles de niveau de vie.
- Sources : Insee, comptes nationaux, base 2014 (données semi-définitives pour 2018) ; Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2018.
graphiqueFigure 1 - Évolution des déciles de niveau de vie de 1996 à 2018

- Lecture : entre 2008 et 2018, le 1er décile de niveau de vie a baissé de 3 %.
- Champ : France pour le PIB ; France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré à l'administration fiscale est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante pour les déciles de niveau de vie.
- Sources : Insee, comptes nationaux, base 2014 (données semi-définitives pour 2018) ; Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2018.
Cependant, l’évolution des niveaux de vie n’est pas la même pour toute la population et l’évolution de la médiane peut masquer des évolutions plus contrastées le long de l’échelle des niveaux de vie. Le premier décile de niveau de vie (c’est‑à‑dire le niveau de vie plafond des 10 % les plus modestes, de 930 euros en 2018) est en 2018 inférieur de 2,9 % à son niveau de 2008, alors que la médiane et le 9e décile ont eux augmenté. En effet, le premier décile a subi une plus forte baisse à la suite de la crise (– 4,4 % entre 2008 et 2012, contre – 1,0 % pour la médiane). Il a ensuite crû un peu plus fortement entre 2012 et 2017, avant de baisser de 1,6 % en 2018. La baisse de 2018 est toutefois liée pour plus d’un tiers à la mesure de la réduction du loyer de solidarité (encadré 2). Avant la crise de 2008, le premier décile augmentait au moins aussi vite que le niveau de vie médian (+2,6 % par an en moyenne entre 1996 et 2002 contre + 1,8 %, et au même rythme entre 2002 et 2008). À l’autre extrémité de la distribution, l’évolution du 9e décile (c’est à dire le seuil minimal des 10 % les plus aisés, de 3 260 euros mensuels en 2018) a été globalement proche de celle du niveau de vie médian entre 1996 et 2018 (à part un épisode plus heurté entre 2011 et 2013, cf. infra).
Les évolutions individuelles peuvent être bien plus fortes. En effet, chaque année, la moitié des individus voient leur niveau de vie baisser ou augmenter de plus de 10 % [Accardo, 2016]. Au niveau agrégé, ces fluctuations se compensent en grande partie.
Les inégalités ont légèrement augmenté entre 2008 et 2018
En 2018, le rapport interdécile D9/D1, rapport entre le niveau de vie plancher des 10 % les plus aisés (le neuvième décile) et le niveau de vie plafond des 10 % les plus modestes (premier décile), est de 3,49 (figure 2). Tout en haut de la distribution, les inégalités sont encore plus fortes. Ainsi, parmi les 10 % les plus aisés, le niveau de vie plancher des 1 % les plus aisés (7 180 euros mensuels en 2018) est lui‑même 2,2 fois plus élevé que celui du 9e décile, et celui du plancher des 0,1 % les plus aisés (17 540 euros mensuels en 2018) est 5,3 fois plus élevé. Le seuil de revenu délimitant les 0,01 % les plus aisés est quant à lui de 54 500 euros mensuels, plus de 15 fois supérieur au 9e décile (fiche 1.23).
La mesure de la part des niveaux de vie détenue par certaines parties de la population permet de mesurer plus finement la concentration des revenus en haut et en bas de la distribution. Les 20 % les plus modestes détiennent ainsi 8,7 % des niveaux de vie en 2018, les 20 % les plus aisés détenant 38,0 %, et les 10 % les plus aisés 24,8 %. Le rapport interquintile des masses (ratio (100‑S80)/S20), mesurant le rapport entre la masse des niveaux de vie des 20 % les plus aisés et celle des 20 % les plus modestes, est donc de 4,45 en 2018. Enfin, l’indice de Gini, qui prend en compte l’ensemble de la distribution des revenus, est de 0,298 en 2018.
Complémentaires pour donner une vision exhaustive des inégalités [Insee, 2021], tous ces indicateurs indiquent que le niveau des inégalités en 2018 est légèrement supérieur à celui de 2008. Cette hausse depuis 2008 prolonge celle qui avait commencé auparavant (en 2004 selon le rapport interdécile, voire en 1997‑1998 selon le rapport interquintile des masses, l’indice de Gini ou la part détenue par les 10 % les plus aisés). La hausse des inégalités entamée depuis cette période s’interrompt en 2011, avec une forte baisse enregistrée entre 2011 et 2013, liée à la diminution du niveau de vie des plus aisés (la part de niveau de vie détenue par les 10 % les plus aisés baisse de 25,3 % à 23,8 %). Entre 2013 et 2017, les inégalités se stabilisent et sont proches du niveau de 2008, avant d’augmenter de nouveau en 2018.
La hausse de 2018 s’explique par celle du niveau de vie des plus aisés, liée à la forte progression des dividendes reçus, et, dans une moindre mesure, par la baisse des allocations logement (encadré 2). La baisse en 2013 et la hausse en 2018 des revenus dans le haut de la distribution sont liées à des mesures sur la fiscalité des dividendes. Ainsi, ces variations seraient fortement atténuées en adoptant une définition plus large des revenus prenant en compte les profits non distribués des entreprises, comme celle utilisée dans Accardo et al. (2021).
Selon les estimations provisoires issues du modèle Ines, les inégalités auraient diminué en 2019 (– 0,003 pour l’indice de Gini et – 0,1 point pour le rapport interquintile des masses), notamment sous l’effet de l’augmentation de la prime d’activité [Buresi et Cornuet, 2020].
tableauFigure 2 - Indicateurs sur le niveau de vie de 1996 à 2018
| 1996 | 1999 | 2002 | 2005 | 2008 | 2011 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau de vie (en euros 2018) | |||||||||
| Moyenne | 20 230 | 21 380 | 22 940 | 23 060 | 24 490 | 24 720 | 23 970 | 24 350 | 24 650 |
| 1er décile (D1) | 9 380 | 10 060 | 10 930 | 10 940 | 11 550 | 11 170 | 11 160 | 11 390 | 11 210 |
| Médiane | 17 820 | 18 500 | 19 800 | 19 990 | 21 050 | 21 030 | 20 830 | 21 190 | 21 250 |
| 9e décile (D9) | 32 800 | 34 530 | 36 930 | 36 480 | 38 860 | 39 840 | 38 140 | 38 900 | 39 130 |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3,50 | 3,43 | 3,38 | 3,33 | 3,36 | 3,57 | 3,42 | 3,42 | 3,49 |
| Masses de niveau de vie détenues (en %) | |||||||||
| Part des 20 % les plus modestes (S20) | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 8,9 | 8,9 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 8,7 |
| Part des 40 % les plus modestes (S40) | 22,7 | 22,6 | 22,9 | 22,7 | 22,7 | 21,9 | 22,6 | 22,5 | 22,2 |
| Part des 50 % les plus modestes (S50) | 31,0 | 30,8 | 31,0 | 30,9 | 30,8 | 29,9 | 30,8 | 30,8 | 30,3 |
| Part des 20 % les plus aisés (100-S80) | 37,2 | 37,9 | 37,9 | 38,1 | 38,5 | 39,4 | 38,0 | 38,0 | 38,7 |
| Part des 10 % les plus aisés (100-S90) | 22,9 | 23,7 | 23,8 | 24,2 | 24,7 | 25,3 | 23,9 | 23,9 | 24,8 |
| Ratio | |||||||||
| (100-S80)/S20 | 4,18 | 4,21 | 4,12 | 4,28 | 4,33 | 4,64 | 4,32 | 4,32 | 4,45 |
| (100-S90)/S40 (Indice de Palma) | 1,01 | 1,05 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,16 | 1,06 | 1,06 | 1,12 |
| (100-S90)/S50 | 0,74 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,80 | 0,85 | 0,78 | 0,78 | 0,82 |
| Indice de Gini | 0,282 | 0,286 | 0,284 | 0,289 | 0,292 | 0,305 | 0,289 | 0,289 | 0,298 |
- Note : pour permettre une comparaison temporelle, les indicateurs de niveau de vie et d’inégalités ont été rétropolés et chainés de 1996 à 2011.
- Lecture : en 2018, les 20 % les plus pauvres disposent de 8,7 % des niveaux de vie (S20) et les 20 % les plus aisés de 38,7 % (complément à 100 de S80), soit 4,45 fois plus.
- Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.
- Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées 1996-2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005-2018.
La hausse des inégalités avant redistribution est liée à la baisse des revenus avant redistribution des plus modestes
Depuis 2008, les inégalités avant redistribution, c’est‑à‑dire avant ajout des prestations monétaires et prélèvement des impôts directs, se sont accentuées : l’indice de Gini augmente de 0,021, le rapport interquintile des masses de 1,5 et le rapport interdécile de 1,0. Cette hausse est en grande partie liée à la baisse des revenus avant redistribution des plus modestes. En effet, le 1er décile du niveau de vie avant redistribution a diminué de 11 % entre 2008 et 2018 et le 2e décile de 3 %, tandis que les autres déciles augmentent.
La baisse de la masse des niveaux de vie avant redistribution moyen des 20 % les plus modestes est de 7,9 % entre 2008 et 2018, soit légèrement inférieure à celle du premier décile de niveau de vie. Cette baisse de 7,9 % est principalement liée à la dégradation de la conjoncture du marché du travail qui a entrainé une hausse du nombre de personnes recevant des allocations chômage parmi les 20 % les plus modestes (+ 44 % entre 2008 et 2018). Ces derniers ont remplacé une partie des retraités et des salariés dans le bas de la distribution : le nombre de personnes recevant des pensions de retraite parmi les 20 % les plus modestes a baissé de 6 % en dix ans, et le nombre de salariés a diminué jusqu’en 2016 (– 5 % entre 2008 et 2016) avant de réaugmenter seulement en 2017 et 2018. La proportion des inactifs hors retraités (étudiants vivant avec leurs parents, ou hommes ou femmes au foyer) dans le bas de la distribution a également augmenté sur la période, comme en témoigne la hausse de leur taux de pauvreté (cf. infra). Ce changement de profil dans le bas de la distribution tire à la baisse les revenus agrégés, car les chômeurs (et a fortiori les inactifs hors retraités) ont en moyenne des revenus plus faibles que les salariés et les retraités. Ainsi, pour les 20 % les plus modestes, les revenus du chômage contribuent pour + 3,7 points à l’évolution de leur revenu avant redistribution, mais ne compensent pas la baisse des salaires et des retraites, qui contribuent respectivement à – 6,6 points et – 2,6 points (figure 3). Cette baisse des salaires est aussi liée au développement du temps partiel. Le nombre d’indépendants parmi les 20 % les plus modestes a aussi fortement augmenté, mais la baisse de leur rémunération moyenne conduit à une contribution de – 0,3 point à la baisse du revenu avant redistribution. Enfin, les montants moyens de revenus du patrimoine ont fortement baissé pour cette partie de la population, conduisant à une contribution négative de – 2,0 points des revenus du patrimoine.
tableauFigure 3 - Évolution des composantes du niveau de vie avant redistribution des 20 % les plus modestes par rapport à 2008
| Masse des niveaux de vie avant distribution | Salaires | Revenus des indépendants | Allocations chômage | Pensions de retraite | Revenus du patrimoine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en % | en points | |||||
| 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2009 | -3,4 | -3,7 | 0,1 | 1,9 | -0,9 | -0,6 |
| 2010 | -6,7 | -6,8 | 0,3 | 1,9 | -1,1 | -1,1 |
| 2011 | -8,3 | -7,0 | 0,6 | 2,0 | -2,4 | -1,4 |
| 2012 | -10,5 | -8,5 | 0,2 | 2,7 | -3,4 | -1,4 |
| 2013 | -6,4 | -7,0 | 0,5 | 3,1 | -1,6 | -1,3 |
| 2014 | -8,0 | -7,9 | 0,4 | 3,4 | -2,2 | -1,6 |
| 2015 | -9,2 | -8,5 | 0,4 | 4,2 | -3,5 | -1,7 |
| 2016 | -10,2 | -8,8 | -0,2 | 4,2 | -3,5 | -1,9 |
| 2017 | -9,3 | -7,5 | -0,2 | 3,9 | -3,1 | -2,3 |
| 2018 | -7,9 | -6,6 | -0,3 | 3,7 | -2,6 | -2,0 |
- Lecture : la masse des niveaux de vie avant redistribution des 20 % des individus ayant les revenus avant redistribution les plus faibles a baissé de 7,9 % entre 2008 et 2018, dont – 2,9 points sont liés à l’évolution des salaires et allocations chômage, – 2,0 points liés aux revenus du patrimoine, – 2,6 points liés aux pensions de retraites et – 0,3 point lié aux revenus des indépendants.
- Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante, et appartenant aux 20 % ayant le revenu avant redistribution le plus faible.
- Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005-2018.
graphiqueFigure 3 - Évolution des composantes du niveau de vie avant redistribution des 20 % les plus modestes par rapport à 2008

- Lecture : la masse des niveaux de vie avant redistribution des 20 % des individus ayant les revenus avant redistribution les plus faibles a baissé de 7,9 % entre 2008 et 2018, dont – 2,9 points sont liés à l’évolution des salaires et allocations chômage, – 2,0 points liés aux revenus du patrimoine, – 2,6 points liés aux pensions de retraites et – 0,3 point lié aux revenus des indépendants.
- Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante, et appartenant aux 20 % ayant le revenu avant redistribution le plus faible.
- Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005-2018.
La hausse des inégalités avant redistribution est également liée au dynamisme des hauts revenus
Avant redistribution, le 9e décile de niveau de vie est celui qui a le plus augmenté entre 2008 et 2018 (+ 5,4 %). La part des niveaux de vie avant redistribution détenue par les 10 % les plus aisés est passée de 27,9 % à 28,8 % entre 2008 et 2018. La hausse est exclusivement portée par les 1 % les plus aisés depuis 2013 : la part des revenus déclarés détenus par ceux‑ci était de 6,4 % en 2013 et atteint 7,4 % en 2018 (figure 4), tandis que celle des 0,1 % les plus aisés passe de 1,6 % à 2,3 %.
tableauFigure 4 - Part des revenus déclarés dans le haut de la distribution
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 20121 | 20132 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus déclarés par les individus… | |||||||||||||||
| … entre le 9e décile et le 99e centile | 20,7 | 20,6 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,4 | 20,5 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,2 | 20,4 |
| … les 0,9 % suivants | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,1 |
| … les 0,1 % les plus aisés | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 |
| … les 1 % les plus aisés | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7,4 |
- 1. À partir de 2012, la source utilisée est Filosofi, ce qui entraîne une rupture de série.
- 2. En 2013, la mesure du revenu dans Filosofi est plus complète. Les majorations de pensions de retraites pour avoir élevé trois enfants ou plus, ainsi que l’avantage en nature constitué par la participation des employeurs aux contrats collectifs de complémentaire santé sont désormais comptabilisés dans le revenu déclaré. De plus, le minimum vieillesse mesuré dans Filosofi couvre l’ensemble des caisses et plus seulement la Cnav et la CCMSA. Ces deux changements entraînent une rupture de série.
- Note : les personnes sont classées selon leur revenu déclaré par unité de consommation.
- Lecture : en 2018, les 1 % des individus les plus aisés reçoivent 7,4 % des revenus déclarés par l’ensemble des ménages.
- Champ : France métropolitaine, ménages fiscaux en logement ordinaire dont le revenu déclaré est strictement positif.
- Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Revenus fiscaux localisés 2004 à 2011, Fichier localisé fiscal et social 2012 à 2018.
Cette hausse des très hauts revenus déclarés est notamment liée au dynamisme des revenus du patrimoine, en particulier des valeurs mobilières. En effet, les revenus avant redistribution des très hauts revenus sont constitués d’une part importante de revenus du patrimoine ou de revenus exceptionnels : environ 35 % pour les 1 % les plus aisés et plus de 50 % pour les 0,01 % [Cazenave‑Lacrouts, 2018]. La hausse est aussi liée à celle des revenus d’activité des salariés et des indépendants (ces derniers étant, comme les revenus du patrimoine, particulièrement concentrés parmi les plus aisés). Dans le secteur privé, la part de la masse salariale détenue par les 1 % des salariés les mieux rémunérés a augmenté de 0,2 point entre 2008 et 2017 et de 1,0 point depuis 1998 [Berger et Bonnet, 2020].
Cette hausse des très hauts revenus s’inscrit dans une tendance internationale depuis les années 1980‑1990 [Alvaredo et al., 2020], même si la hausse en Europe et plus particulièrement en France est plus faible et plus tardive que dans les pays anglo‑saxons. Plusieurs pistes d’explication sont avancées, notamment le commerce international et le progrès technique biaisé vers les plus qualifiés Ouvrir dans un nouvel onglet[Autor et al., 2014 ; Ouvrir dans un nouvel ongletAcemoglu et Restrepo, 2020], l’innovation Ouvrir dans un nouvel onglet[Aghion et al., 2019], l’effet des baisses de la fiscalité sur les très hauts revenus sur les revenus primaires des cadres dirigeants Ouvrir dans un nouvel onglet[Piketty, Saez et Stancheva, 2014] , ou encore la hausse des rémunérations dans le secteur financier Ouvrir dans un nouvel onglet[Boustanifar et al., 2018].
Le système socio‑fiscal a limité la hausse des inégalités depuis 2013
Une année donnée, le système socio‑fiscal diminue les inégalités via une redistribution verticale des revenus. En 2018, il diminue l’indice de Gini de 0,085. Le rapport interquintile des masses est divisé par 2 : le niveau de vie moyen avant redistribution des 20 % de personnes les plus aisées est 8,7 fois supérieur au niveau de vie moyen des 20 % de personnes les plus modestes ; après redistribution, ce rapport est de 4,4 (figure 5). La réduction des écarts est encore plus grande aux extrémités de la distribution des revenus, où le rapport entre le niveau de vie moyen des 10 % les plus riches et celui des 10 % les plus pauvres est divisé par 3,4 du fait de la redistribution (passant de 24 à 7,1). Pour tous les indicateurs, la réduction des inégalités serait encore plus forte en prenant en compte dans la redistribution les transferts en nature comme la santé et l’éducation, et les services publics [Accardo et al., 2021].
Le système socio‑fiscal atténue aussi l’évolution des inégalités dans le temps. En effet, avant redistribution, les inégalités évoluent tendanciellement plus vite qu’après redistribution lorsque la conjoncture se détériore, et diminuent moins lorsqu’elle s’améliore. Cela est vérifié quel que soit l’indicateur considéré (figure 5). Globalement, depuis 2008, les inégalités ont beaucoup augmenté avant redistribution et n’ont progressé que légèrement après.
Cette réduction du niveau des inégalités et ce lissage de leur évolution sont en partie mécaniques et liés à la progressivité des impôts directs (impôt sur le revenu notamment), et au ciblage des prestations sociales sous condition de revenu. Ces dernières augmentent mécaniquement quand les revenus des plus modestes baissent ou lorsque le chômage augmente. Cependant, cet effet a été amplifié par les réformes socio‑fiscales de ces dix dernières années, qui ont soutenu les plus modestes à travers les revalorisations exceptionnelles de certaines prestations au‑dessus des revalorisations usuelles calées sur l’inflation. Entre 2008 et 2017, les réformes socio‑fiscales ont ainsi fortement bénéficié aux 10 % de ménages les plus modestes [Madec et al., 2019], pour lesquels plus de la moitié du revenu disponible est composé de prestations sociales. Par exemple, dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté en janvier 2013, le revenu de solidarité active (RSA) a été revalorisé de 2 % par an pendant cinq ans. Le complément familial, versé aux familles nombreuses sous condition de ressources, et l’allocation de soutien familial, réservée aux parents isolés ne percevant pas de pension alimentaire, ont également été fortement revalorisés pendant quatre ans. La création de la prime d’activité en 2016 en remplacement du RSA activité et de la prime pour l’emploi a également soutenu le niveau de vie des travailleurs pauvres.
La redistribution limite ainsi la baisse du niveau de vie des plus modestes, qui n’est plus que de 3 % pour le niveau du 1er décile de niveau de vie. L’évolution du 2e décile est quant à elle inchangée avant et après redistribution, tandis que dans les autres déciles, les niveaux de vie après redistribution sont moins dynamiques qu’avant redistribution. C’est pour les plus hauts revenus que l’écart est le plus important. Pour le 9e décile, la hausse est de 5,4 % avant redistribution depuis 2008 et de 0,7 % après. La part des revenus détenus par les 10 % les plus aisés a augmenté de 0,9 points avant redistribution, alors qu’elle est restée quasi‑stable après redistribution.
tableauFigure 5 - Inégalités de niveaux de vie avant et après redistribution depuis 1996
| Avant redistribution | Après redistribution | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice de Gini | Ratio (100-S80)/S20 | Rapport interdécile D9/D1 | Indice de Gini | Ratio (100-S80)/S20 | Rapport interdécile D9/D1 | |
| 1996 | 0,358 | 7,45 | 5,88 | 0,282 | 4,18 | 3,50 |
| 1997 | 0,360 | 7,60 | 5,80 | 0,281 | 4,18 | 3,48 |
| 1998 | 0,362 | 7,52 | 5,75 | 0,279 | 4,09 | 3,40 |
| 1999 | 0,369 | 7,78 | 5,76 | 0,286 | 4,21 | 3,43 |
| 2000 | 0,369 | 7,66 | 5,68 | 0,289 | 4,24 | 3,48 |
| 2001 | 0,368 | 7,51 | 5,56 | 0,288 | 4,23 | 3,41 |
| 2002 | 0,359 | 7,05 | 5,25 | 0,284 | 4,12 | 3,38 |
| 2003 | 0,358 | 7,14 | 5,24 | 0,283 | 4,11 | 3,34 |
| 2004 | 0,359 | 7,15 | 5,17 | 0,283 | 4,11 | 3,29 |
| 2005 | 0,360 | 7,17 | 5,21 | 0,289 | 4,28 | 3,33 |
| 2006 | 0,364 | 7,36 | 5,22 | 0,293 | 4,34 | 3,39 |
| 2007 | 0,362 | 7,33 | 5,23 | 0,292 | 4,31 | 3,37 |
| 2008 | 0,362 | 7,24 | 5,27 | 0,292 | 4,33 | 3,36 |
| 2009 | 0,365 | 7,47 | 5,35 | 0,293 | 4,36 | 3,43 |
| 2010 | 0,375 | 8,04 | 5,65 | 0,302 | 4,56 | 3,46 |
| 2011 | 0,380 | 8,40 | 5,98 | 0,305 | 4,64 | 3,57 |
| 2012 | 0,380 | 8,55 | 6,02 | 0,302 | 4,60 | 3,54 |
| 2013 | 0,368 | 7,89 | 5,76 | 0,288 | 4,32 | 3,43 |
| 2014 | 0,372 | 8,25 | 5,79 | 0,289 | 4,32 | 3,42 |
| 2015 | 0,375 | 8,45 | 6,11 | 0,292 | 4,35 | 3,46 |
| 2016 | 0,374 | 8,58 | 6,23 | 0,288 | 4,26 | 3,40 |
| 2017 | 0,374 | 8,60 | 6,30 | 0,289 | 4,32 | 3,42 |
| 2018 | 0,383 | 8,74 | 6,26 | 0,298 | 4,45 | 3,49 |
- Lecture : en 2018, l’indice de Gini des niveaux de vie est de 0,383 avant redistribution et de 0,298 après redistribution.
- Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.
- Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2016.
graphiqueFigure 5 - Inégalités de niveaux de vie avant et après redistribution depuis 1996

- Lecture : en 2018, l’indice de Gini des niveaux de vie est de 0,383 avant redistribution et de 0,298 après redistribution.
- Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.
- Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2016.
Les inégalités sont beaucoup plus élevées à Paris et dans les communes denses
Parmi les régions françaises, le niveau de vie médian est plus élevé en Île‑de‑France (23 900 euros en 2018) et en Auvergne‑Rhône‑Alpes (22 500 euros). À l’inverse, les niveaux de vie médians sont les plus faibles dans les Hauts‑de‑France, dans l’ancienne région Languedoc‑Roussillon, dans les départements et régions d’outre‑mer (DOM) et en Corse. En Île‑de‑France, les niveaux de vie médians sont les plus élevés à Paris, dans les Hauts‑de‑Seine, dans les Yvelines et en Essonne. En dehors de l’Île‑de‑France, seule la Haute‑Savoie a un niveau de vie médian proche de celui de ces départements, grâce à la proximité de Genève.
Les territoires avec les niveaux de vie médians les plus élevés sont souvent également les plus inégalitaires, c’est le cas de ceux cités précédemment. Par exemple, l’Île‑de‑France est la région la plus inégalitaire avec un rapport interquintile des masses de niveaux de vie supérieur à 6, et Paris le département le plus inégalitaire avec un rapport de près de 10, soit plus du double de la moyenne nationale. À elle seule, l’Île‑de‑France concentre 43 % des 1 % des personnes les plus aisées vivant en France (dont 30 % à Paris et dans les Hauts de Seine) et plus de la moitié des 0,1 % les plus aisés [Robin et Guevara, 2020].
À la maille des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les inégalités sont particulièrement élevées sur le littoral méditerranéen, et à la frontière avec la Suisse et le Luxembourg (figure 6). Dans les premières zones, les inégalités sont liées à la conjonction d’une forte proportion de retraités aisés et d’un taux de pauvreté et de chômage élevé (cf. infra) ; dans les secondes, aux travailleurs transfrontaliers qui perçoivent des salaires plus élevés.
Toutefois, des inégalités élevées ne vont pas toujours de pair avec des niveaux de vie élevés. Ainsi, les inégalités sont fortes dans certains territoires dont le niveau de vie médian est faible, comme la Seine‑Saint‑Denis, les DOM, et dans une moindre mesure, l’Hérault et la Haute‑Corse. À l’inverse, la Bretagne et les Pays de la Loire, qui ont des niveaux de vie médians légèrement supérieurs à la moyenne nationale, sont les régions avec les inégalités les plus faibles. Au sein de ces régions, la Vendée et la Mayenne sont les départements les moins inégalitaires du pays. Dans les territoires du centre de la France, les inégalités sont également plus faibles que la moyenne, tout en ayant un niveau de vie médian proche ou légèrement inférieur à la moyenne nationale.
La densité de population et les inégalités sont souvent corrélées, comme le montre l’exemple des territoires du centre de la France. Les communes peu denses et très peu denses ont ainsi un rapport interdécile et un rapport interquintile des masses très en dessous des moyennes nationales. Ces communes ont un 1er décile et une médiane des niveaux de vie proches de la moyenne nationale, mais beaucoup moins de hauts revenus : les 20 % les plus aisés détiennent 34,9 % des niveaux de vie, contre 41,9 % dans les communes denses en 2018. À l’inverse, dans les communes denses, le rapport interquintile des masses est de 5,6 et le rapport interdécile de 4,2. C’est en effet dans ces territoires que sont concentrés à la fois les plus aisés [Robin et Guevara, 2020] et les plus pauvres.
Au sein des aires d’attraction des villes, les inégalités sont beaucoup plus élevées dans les pôles que dans les couronnes (car les revenus des plus aisés y sont plus élevés et ceux des plus modestes plus faibles), et au sein des pôles, encore plus marquées dans les communes‑centres. En plus de ce premier effet, s’ajoute celui de la taille de l’aire : plus la population s’accroît, plus les inégalités augmentent. Les inégalités sont les plus élevées dans les communes‑centres des aires de plus de 700 000 habitants et les moins élevées dans les couronnes des aires de moins de 200 000 habitants et dans les communes hors attraction des villes (fiche 1.19).
La crise de 2008 aurait davantage affecté les départements les plus modestes, augmentant ainsi les inégalités entre départements [Chaput et al., 2021]. Entre 2008 et 2011, les écarts entre hauts et bas revenus se sont accrus au sein de tous les départements, mais ont légèrement baissé ensuite entre 2012 et 2017.
graphiqueFigure 6 - Rapport interquintile des masses de niveau de vie des ménages par établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en 2018

- Lecture : dans l'EPCI du Grand Paris, les 20 % les plus aisés détiennent plus de 5,5 fois plus que les 20 % les plus modestes (ratio (100-S80)/S20).
- Champ : France métropolitaine, ménages fiscaux en logement ordinaire dont le revenu disponible est strictement positif.
- Sources : Insee, Fichier Localisé Social et Fiscal (Filosofi) 2018.
Les inégalités sont plus faibles en France que chez ses principaux partenaires internationaux
Les inégalités de niveaux de vie sont relativement faibles en France par rapport aux autres pays de l’OCDE. Elles sont beaucoup plus faibles qu’aux États‑Unis où le rapport interquintile des masses est près de deux fois plus élevé, et qu’au Royaume‑Uni, en Italie ou en Espagne, où ce rapport est de 35 à 40 % plus élevé qu’en France (figure 7). Les inégalités sont proches de celles de l’Allemagne, et plus élevées que dans les pays nordiques.
Les inégalités de niveaux de vie dépendent en grande partie des inégalités avant redistribution. Avant redistribution, la France est beaucoup moins inégalitaire que les pays anglo‑saxons Ouvrir dans un nouvel onglet[Bozio et al., 2020 ; Insee, 2021] et légèrement moins que la médiane des pays européens Ouvrir dans un nouvel onglet[Rousselon et Viennot, 2020], notamment en lien avec le niveau du salaire minimum Ouvrir dans un nouvel onglet[Autor et al., 2016]. Après redistribution, en se basant donc sur tous les éléments du niveau de vie, elle est légèrement mieux classée Ouvrir dans un nouvel onglet[Causa et Hermansen, 2017 ; Ouvrir dans un nouvel ongletGuillaud et al., 2018].
tableauFigure 7 - Rapport interquintile des masses de niveaux de vie en comparaison internationale depuis 2008
| Norvège | France | Allemagne | Espagne | Italie | Royaume-Uni | États-Unis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 5,7 | 5,3 | 6,5 | 7,7 |
| 2009 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 6,0 | 5,3 | 6,5 | 7,7 |
| 2010 | 3,7 | 4,5 | 4,3 | 6,1 | 5,8 | 5,9 | 7,9 |
| 2011 | 3,7 | 4,7 | 4,4 | 6,3 | 5,7 | 5,9 | 8,2 |
| 2012 | 3,8 | 4,6 | 4,3 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 8,2 |
| 2013 | 3,8 | 4,3 | 4,4 | 6,6 | 5,8 | 6,0 | 8,6 |
| 2014 | 3,9 | 4,4 | 4,4 | 6,6 | 5,9 | 6,0 | 8,7 |
| 2015 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 8,3 |
| 2016 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 6,5 | 5,9 | 6,0 | 8,5 |
| 2017 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 8,4 |
- Note : avant 2012, les données utilisent une définition des revenus légèrement différente pour certains pays (la France, l’Allemagne et les États-Unis), et ne peuvent donc pas être bien comparées aux données après 2012.
- Lecture : en 2017, aux États-Unis, le niveau du rapport interquintile des masses de niveaux de vie des ménages est de 8,4, contre 4,0 en Norvège.
- Champ : ménages d’Allemagne, Espagne, États-Unis, Italie, France, Norvège, Royaume-Uni.
- Source : OCDE.
graphiqueFigure 7 - Rapport interquintile des masses de niveaux de vie en comparaison internationale depuis 2008

- Note : avant 2012, les données utilisent une définition des revenus légèrement différente pour certains pays (la France, l’Allemagne et les États-Unis), et ne peuvent donc pas être bien comparées aux données après 2012.
- Lecture : en 2017, aux États-Unis, le niveau du rapport interquintile des masses de niveaux de vie des ménages est de 8,4, contre 4,0 en Norvège.
- Champ : ménages d’Allemagne, Espagne, États-Unis, Italie, France, Norvège, Royaume-Uni.
- Source : OCDE.
14,8 % de la population vit au‑dessous du seuil de pauvreté en 2018
En 2018, en France métropolitaine, le taux de pauvreté monétaire s’établit à 14,8 % de la population, soit 9,3 millions de personnes pauvres (figure 8). Une personne est considérée comme pauvre si son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de France métropolitaine. Ce seuil est de 1 063 euros par mois en 2018, ce qui correspond à un revenu disponible de 1 595 euros par mois pour un couple sans enfant et de 2 232 euros par mois pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans.
Le taux de pauvreté monétaire augmente de 0,7 point par rapport à 2017. La mesure de réduction du loyer de solidarité (RLS) contribue pour 0,3 point à cette hausse (encadré 2), tandis que le reste de la hausse est lié à une plus faible progression des revenus d’activité en dessous de la médiane et, dans une moindre mesure, aux autres évolutions législatives affectant le niveau de vie des plus modestes (gel du barème et baisse de 5 euros des aides au logement, réforme de la prestation d’accueil du jeune enfant).
Le taux de pauvreté reste plus élevé en 2018 qu’il y a dix ans, malgré une stabilité entre 2011 et 2017. Le niveau de 2008 était lui‑même plus élevé que celui de 2004, dernier point bas connu depuis 1996. Sur un champ restreint (hors revenus financiers non fiscalisés et allocation aux adultes handicapés), pour lequel on peut avoir davantage de recul, 2004 est même le point le plus bas depuis 1970 (fiche 1.10), le taux de pauvreté ayant fortement baissé entre 1970 et le milieu des années 1980, notamment du fait de la chute du taux de pauvreté des retraités et des indépendants [Blasco et Labarthe, 2018].
Selon les estimations provisoires issues du modèle Ines, le taux de pauvreté aurait baissé de 0,3 point en 2019 et s’établirait à 14,5 %, notamment sous l’effet de la hausse de la prime d’activité [Cornuet et Buresi, 2020]. Sans prendre en compte la mesure de la RLS de 2018, le taux de pauvreté serait de 14,2 % en 2019, soit très proche du niveau de 2017.
tableauFigure 8 - Indicateurs de pauvreté
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seuil à 60 % de la médiane | |||||
| Nombre de personnes pauvres (en milliers) | 8 732 | 8 875 | 8 783 | 8 889 | 9 327 |
| Taux de pauvreté (en %) | 14,0 | 14,2 | 14,0 | 14,1 | 14,8 |
| Seuil de pauvreté (en euros 2018/mois) | 1 042 | 1 046 | 1 056 | 1 060 | 1 063 |
| Niveau de vie médian des personnes pauvres (en euros 2018/mois) | 832 | 841 | 848 | 852 | 855 |
| Intensité de la pauvreté (en %) | 20,2 | 19,6 | 19,7 | 19,6 | 19,6 |
| Seuil à 50 % de la médiane | |||||
| Nombre de personnes pauvres (en milliers) | 4 964 | 5 020 | 4 997 | 5 010 | 5 265 |
| Taux de pauvreté (en %) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,3 |
| Seuil de pauvreté (en euros 2018/mois) | 868 | 872 | 880 | 883 | 885 |
| Niveau de vie médian des personnes pauvres (en euros 2018/mois) | 711 | 727 | 728 | 728 | 739 |
| Intensité de la pauvreté (en %) | 18,1 | 16,6 | 17,3 | 17,6 | 16,5 |
- Lecture : en 2018, le taux de pauvreté à 60 % de la médiane est de 14,8 % en France métropolitaine.
- Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.
- Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux de 2014 à 2018.
En 2018, le niveau de vie médian des personnes pauvres est de 855 euros par mois. L’intensité de la pauvreté, c’est‑à‑dire l’écart relatif entre le niveau de vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté, est de 19,6 % en 2018. L’intensité de la pauvreté avait augmenté avec la crise de 2008, progressant de 1,9 point entre 2008 et 2012 pour atteindre 21,4 % en 2012. Elle a baissé entre 2012 et 2015, et est relativement stable depuis.
La pauvreté est une situation persistante : 70 % des personnes qui étaient en 2016 en situation de pauvreté monétaire le sont toujours l’année suivante. Cette persistance sur deux années consécutives a même augmenté de 7 points entre 2008 et 2017 [Albouy et Delmas, 2020]. De plus, 34 % des personnes pauvres au moins une année entre 2014 et 2017 le sont restées une année seulement, contre 40 % entre 2008 et 2011.
La redistribution réduit le taux de pauvreté de 7,5 points
Avant redistribution, c’est‑à‑dire avant prise en compte des prestations monétaires et des prélèvements par les impôts directs, le taux de pauvreté est de 22,3 % en 2018 (figure 9) : les prestations sociales non contributives et les impôts directs permettent donc une réduction de 7,5 points du taux de pauvreté. Les prestations sociales contribuent pour 90 % à la baisse : les minima sociaux contribuent pour 1,8 point, les allocations logement pour 2,0 points, les prestations familiales pour 1,9 point et la prime d’activité pour 1,0 point. La réduction de la pauvreté du fait de la redistribution est particulièrement marquée pour les familles nombreuses, les moins de 20 ans et les personnes en situation de handicap Ouvrir dans un nouvel onglet[Drees, 2020].
tableauFigure 9a - Taux de pauvreté à 60 %
| Taux de pauvreté | ||
|---|---|---|
| Avant redistribution | Après redistribution | |
| 1996 | 22,6 | 14,6 |
| 1997 | 22,8 | 14,3 |
| 1998 | 22,7 | 13,9 |
| 1999 | 22,4 | 13,6 |
| 2000 | 22,1 | 13,7 |
| 2001 | 22,1 | 13,5 |
| 2002 | 21,3 | 13,1 |
| 2003 | 21,1 | 13,1 |
| 2004 | 20,6 | 12,7 |
| 2005 | 20,9 | 13,2 |
| 2006 | 21,3 | 13,3 |
| 2007 | 21,3 | 13,6 |
| 2008 | 20,2 | 13,2 |
| 2009 | 21,5 | 13,6 |
| 2010 | 21,9 | 14,3 |
| 2011 | 22,1 | 14,6 |
| 2012 | 22,3 | 14,2 |
| 2013 | 21,8 | 13,8 |
| 2014 | 21,8 | 14,0 |
| 2015 | 22,3 | 14,2 |
| 2016 | 22,2 | 14,0 |
| 2017 | 22,1 | 14,1 |
| 2018 | 22,3 | 14,8 |
- Lecture : en 2018, le taux de pauvreté après redistribution s’élève à 14,8 %.
- Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.
- Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées 1996-2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005-2018.
graphiqueFigure 9a - Taux de pauvreté à 60 %

- Lecture : en 2018, le taux de pauvreté après redistribution s’élève à 14,8 %.
- Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.
- Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées 1996-2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005-2018.
L’intensité de la pauvreté avant redistribution aurait été de 39,8 % en 2018, contre 19,6 % après redistribution. Les prestations monétaires et les impôts directs réduisent ainsi de plus de 20 points l’intensité de la pauvreté en 2018. L’intensité de la pauvreté avant redistribution a fortement augmenté depuis la crise de 2008, avec une hausse de 7 points entre 2007 et 2018 (une légère tendance à la hausse préexistait depuis 2002, où un point bas de 31,6 % avait été atteint). En revanche, l’intensité de la pauvreté après redistribution est restée stable. Cette hausse de l’intensité de la pauvreté avant redistribution est directement liée à la baisse du niveau de vie avant redistribution des plus modestes depuis 2008 (cf. supra).
Les chômeurs, les jeunes et les familles monoparentales sont beaucoup plus exposés à la pauvreté
En 2018, les salariés ont un taux de pauvreté de 7,2 %, plus faible que toutes les autres situations sur le marché du travail (figure 10). Le rôle protecteur de l’emploi salarié face à la pauvreté s’est même renforcé puisque le taux de pauvreté des salariés a diminué depuis 1996. Les indépendants sont beaucoup plus exposés au risque de pauvreté (17,7 %), même si ce risque a légèrement baissé depuis 1996.
37,8 % des chômeurs vivent sous le seuil de pauvreté en 2018, soit un taux plus de cinq fois plus élevé que pour les salariés. Le taux de pauvreté des chômeurs a augmenté entre le milieu des années 2000 et 2011 d’environ 5 points (le niveau de vie des chômeurs ayant notamment baissé entre 2009 et 2011, Houdré et al., 2014), avant de diminuer. Le taux de pauvreté est encore plus élevé (50,8 %) pour les personnes vivant dans un ménage dont la personne de référence est au chômage.
Le taux de pauvreté des retraités (8,7 %) est très en dessous de la moyenne nationale et stable depuis 1996, car leurs revenus sont souvent supérieurs au seuil de pauvreté (pensions de retraites, ou minima vieillesse complétés par les allocations logement). Le taux de pauvreté des inactifs hors retraités est très élevé (32,7 % en 2018) et a fortement augmenté depuis 2004. Il fluctuait entre 21,7 % et 24,2 % entre 1996 et 2004 puis a augmenté régulièrement. Le taux de pauvreté des enfants est de 21,0 % en 2018, en légère hausse depuis le milieu des années 2000. Ce taux est supérieur au taux de pauvreté global, ce qui s’explique par le fait que les familles avec des enfants ont en moyenne un niveau de vie plus faible.
tableauFigure 10 - Taux de pauvreté selon le statut d'activité
| Salariés | Indépendants | Chômeurs | Retraités | Autres inactifs (dont étudiants) | Enfants de moins de 18 ans1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 8,0 | 19,8 | 36,1 | 8,4 | 22,9 | 19,3 |
| 1997 | 7,8 | 19,1 | 35,7 | 8,0 | 23,6 | 18,9 |
| 1998 | 7,4 | 17,9 | 36,0 | 8,1 | 23,2 | 18,5 |
| 1999 | 7,7 | 16,3 | 34,9 | 8,2 | 23,2 | 18,3 |
| 2000 | 7,6 | 15,7 | 35,8 | 8,6 | 24,2 | 18,8 |
| 2001 | 7,5 | 15,5 | 33,9 | 8,4 | 23,8 | 18,8 |
| 2002 | 6,9 | 18,8 | 34,9 | 8,5 | 21,7 | 17,1 |
| 2003 | 6,3 | 18,6 | 35,9 | 7,6 | 23,6 | 18,1 |
| 2004 | 6,4 | 18,8 | 34,3 | 7,3 | 23,1 | 17,1 |
| 2005 | 6,6 | 18,2 | 35,3 | 7,9 | 24,9 | 18,0 |
| 2006 | 6,5 | 18,2 | 35,7 | 8,3 | 25,2 | 18,1 |
| 2007 | 7,3 | 15,8 | 37,3 | 8,6 | 26,7 | 18,3 |
| 2008 | 6,7 | 16,3 | 36,7 | 8,7 | 26,2 | 17,7 |
| 2009 | 6,7 | 17,9 | 35,6 | 8,7 | 27,6 | 18,1 |
| 2010 | 6,7 | 17,8 | 37,3 | 9,0 | 28,6 | 20,0 |
| 2011 | 7,3 | 17,3 | 40,4 | 8,3 | 29,2 | 20,2 |
| 2012 | 6,9 | 16,2 | 38,7 | 7,4 | 29,5 | 20,3 |
| 2013 | 6,2 | 17,6 | 36,6 | 7,6 | 29,9 | 19,6 |
| 2014 | 6,3 | 18,7 | 37,3 | 7,2 | 30,9 | 19,8 |
| 2015 | 6,5 | 17,3 | 37,6 | 7,3 | 32,1 | 19,9 |
| 2016 | 6,4 | 17,5 | 38,3 | 7,4 | 31,1 | 19,8 |
| 2017 | 7,1 | 17,2 | 37,6 | 7,6 | 31,3 | 20,1 |
| 2018 | 7,2 | 17,7 | 37,8 | 8,7 | 32,7 | 21,0 |
- 1. Toutes les personnes de moins de 18 ans sont considérées comme enfant quelle que soit leur occupation.
- Note : les statuts d’activité sont ceux au sens du Bureau international du travail (BIT). Le mode de calcul de la variable activité au sens du BIT a été modifié plusieurs fois au cours de la période observée, ce qui explique certaines évolutions heurtées, par exemple entre 2002 et 2003.
- Lecture : en 2018, le taux de pauvreté (à 60%) des chômeurs est de 37,8 %.
- Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.
- Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux de 2005 à 2018, rétropolées pour prendre en compte les ruptures de séries.
graphiqueFigure 10 - Taux de pauvreté selon le statut d'activité

- 1. Toutes les personnes de moins de 18 ans sont considérées comme enfant quelle que soit leur occupation.
- Note : les statuts d’activité sont ceux au sens du Bureau international du travail (BIT). Le mode de calcul de la variable activité au sens du BIT a été modifié plusieurs fois au cours de la période observée, ce qui explique certaines évolutions heurtées, par exemple entre 2002 et 2003.
- Lecture : en 2018, le taux de pauvreté (à 60%) des chômeurs est de 37,8 %.
- Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.
- Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux de 2005 à 2018, rétropolées pour prendre en compte les ruptures de séries.
Les familles monoparentales sont la catégorie de ménages la plus exposée à la pauvreté : leur taux de pauvreté est de 35,3 % en 2018 (fiche 1.13). Ce taux est en hausse par rapport à 2017 (+ 1,7 point). Ceci s’explique en partie par le fait qu’au sein des familles monoparentales, l’adulte est nettement plus souvent sans emploi ou dans la catégorie socioprofessionnelle des employés (profils plus exposés à la pauvreté) que dans l’ensemble de la population. Parmi les enfants vivant avec un seul parent et dont celui‑ci est sans emploi, 78 % sont pauvres.
Le taux de pauvreté est également plus élevé que la moyenne pour les personnes seules de moins de 65 ans (20,2 %) et pour les couples de trois enfants ou plus (23,1 %) et ces différences ne s’expliquent pas seulement par leur statut d’activité ou leur catégorie socioprofessionnelle [Blasco et Labarthe, 2018]. À l’inverse, le taux de pauvreté est le plus faible pour les couples sans enfant (7,1 %), avec un ou deux enfants (9,3 %), et les couples dont la personne de référence a plus de 65 ans (6,2 %).
Le risque de pauvreté décroit globalement avec l’âge : le taux de pauvreté des 18‑24 ans est le plus élevé (22,7 % , fiche 1.14), tandis que celui des personnes âgées de 65 à 74 ans est le plus faible (8,5 %). Cependant, depuis 2012, le taux de pauvreté de ces derniers s’est accru de 3,1 points.
En prenant en compte les communautés, les sans‑domicile et les étudiants, environ 10 millions de personnes seraient en situation de pauvreté en France métropolitaine
Le taux de pauvreté est usuellement mesuré pour les ménages vivant dans un logement ordinaire en France métropolitaine, et dont la personne de référence n’est pas étudiante. En mobilisant diverses sources de données, on peut estimer qu’environ 460 000 personnes seraient en situation de pauvreté monétaire parmi les ménages « non ordinaires » (encadré 3). 278 000 personnes pauvres vivraient dans des communautés, dont 119 000 en maison de retraite et Ehpad, et 86 000 en cité universitaire (ou autres établissements hébergeant des élèves ou étudiants). Par ailleurs, 77 000 personnes seraient sans abri ou vivraient dans des établissements pour personnes en grande difficulté sociale. Enfin, 108 000 personnes résidant en habitation mobile seraient pauvres. En comptabilisant aussi ces personnes pauvres vivant en ménages non ordinaires, 9,8 millions de personnes seraient en situation de pauvreté monétaire en 2018 en France métropolitaine. En ajoutant également 0,2 million de jeunes étudiants ne vivant ni chez leurs parents, ni en communauté (encadré 3), environ 10 millions de personnes seraient pauvres en France métropolitaine en 2018.
Par ailleurs, selon l’enquête Budget de famille 2017 (sources), 940 000 personnes dans les DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte) auraient un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté national [Audoux et al., 2020]. En ajoutant les DOM aux 10 millions de personnes pauvres en France métropolitaine estimées précédemment, 10,9 millions de personnes seraient en situation de pauvreté en France. Cependant, ce chiffre ne prend pas en compte les DOM (et les personnes ne vivant pas en ménages ordinaires) dans le calcul du seuil de pauvreté, et surestime donc le seuil de pauvreté et le nombre de personnes pauvres en métropole. Ainsi, avec un seuil recalculé de 1 031 euros en 2018 sur l’ensemble de la population, 8,5 millions de personnes seraient pauvres en métropole (au lieu de 9,3 millions). En ajoutant les communautés, les étudiants ne vivant ni chez leurs parents ni en communauté, et les DOM, 10,1 millions de personnes seraient ainsi en situation de pauvreté monétaire en France, avec un seuil de pauvreté plus faible que celui utilisé usuellement.
En France, environ 2 millions de personnes seraient en situation de grande pauvreté [Blasco et Picard, 2021], soit environ un cinquième des personnes pauvres. Elles cumulent faiblesse des revenus (niveau de vie inférieur à 50 % de la médiane) et multiplicité de privations matérielles et sociales.
Le taux de pauvreté est plus élevé dans les zones denses
La pauvreté est plus marquée dans les zones densément peuplées : dans les communes denses, 18,6 % des habitants sont pauvres (figure 11). L’intensité de la pauvreté y est également la plus marquée (21,8 %). Ces communes se situent dans les grandes agglomérations, où se trouvent notamment les quartiers prioritaires de la politique de la ville. À l’inverse, dans les communes peu denses, le taux de pauvreté est le plus bas (10,6 %). Ces communes regroupent 21 % de la population pauvre (et 30 % de la population totale) contre 46 % dans les communes très denses (37 % de la population totale). L’intensité de la pauvreté y est également plus faible que dans les communes denses. Dans les communes de densité intermédiaire, le taux de pauvreté et l’intensité de la pauvreté sont d’un niveau intermédiaire par rapport aux autres types de communes (respectivement 15,2 % et 19,7 %). La situation dans les communes très peu denses est particulière : le taux de pauvreté et l’intensité de pauvreté y sont plus élevés que dans les communes peu denses, mais restent moins élevés que dans les communes denses.
tableauFigure 11 - Inégalités et taux de pauvreté en 2018 selon le type de commune de résidence
| Niveau de vie (en euros) | Indicateurs d’inégalités | Indicateurs de pauvreté (en %) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er décile | Médiane | 9e décile | Rapport interdécile D9/D1 | S20 | S80 | Ratio (100-S80)/S20 | Taux de pauvreté à 60 % | Intensité de la pauvreté | Répartition de lapopulation pauvre | |
| Communes denses | 10 437 | 21 648 | 43 880 | 4,20 | 7,5 | 58,1 | 5,59 | 18,6 | 21,8 | 46,2 |
| Communes de densité intermédiaire | 11 396 | 21 529 | 38 298 | 3,36 | 8,9 | 62,7 | 4,20 | 15,2 | 19,7 | 29,4 |
| Communes peu denses | 12 825 | 21 867 | 36 105 | 2,82 | 10,0 | 65,1 | 3,48 | 10,6 | 18,0 | 21,0 |
| Communes très peu denses | 11 657 | 20 659 | 34 100 | 2,93 | 9,6 | 65,1 | 3,63 | 14,2 | 20,0 | 3,4 |
- Lecture : en 2018, dans les communes denses, le taux de pauvreté est de 18,6 % et l’intensité de la pauvreté de 21,8 %.
- Champ : France métropolitaine, Martinique et Réunion, ménages fiscaux en logement ordinaire dont le revenu disponible est strictement positif.
- Source : Insee, Fichier Localisé Social et Fiscal (Filosofi) 2018.
Le taux de pauvreté est relativement faible en Bretagne et dans les Pays de la Loire et dans les départements de l’Ouest de la France et du pourtour atlantique où les taux sont inférieurs à 13 % (fiche 1.18). La proportion de personnes pauvres est en revanche plus forte d’une part dans les DOM, et d’autre part dans le Sud et le Nord de la France, là où il y a de nombreux pôles. En général, dans les aires d’attraction des villes, le taux de pauvreté est beaucoup plus élevé dans le pôle que dans la couronne, et au sein du pôle, encore plus marqué dans la commune‑centre, et ce, quelle que soit la taille de l’aire (fiche 1.19). Le taux de pauvreté est de 20,7 % en moyenne dans les communes‑centres, qui concentrent 37 % des personnes pauvres (contre 27 % de la population). L’intensité de la pauvreté est également la plus élevée dans ces territoires (21,5 %). Hors de l’attraction des villes, les niveaux de vie sont un peu plus faibles qu’au niveau national, tandis que le taux de pauvreté et l’intensité de la pauvreté sont proches.
La France a un des taux de pauvreté les plus bas de l’Union européenne
En 2018, selon l’enquête SRCV (annexe), avec une définition harmonisée pour les pays européens, le taux de pauvreté de la France s’élève à 13,6 % contre 16,8 % en moyenne en Europe (figure 12). Il fait partie des plus bas d’Europe, la France se situant en 10e position. Certains pays nordiques (notamment Danemark et Finlande) et d’Europe de l’Est (notamment la République tchèque, la Slovénie ou la Slovaquie) ont des taux de pauvreté plus faibles. Cependant, les seuils de pauvreté de ce dernier groupe de pays sont très en‑deçà de celui de la France (plus de deux fois plus faible en standards de pouvoir d’achat (SPA) pour la Hongrie et la Slovaquie), et donc la mesure de la pauvreté est difficilement comparable. En effet, les seuils de pauvreté étant calculés pour chaque pays de façon relative par rapport au niveau de vie médian, le taux de pauvreté reflète la dispersion des niveaux de vie dans le bas de la distribution. Parmi les pays dont le seuil de pauvreté est supérieur à celui de la France, seuls les Pays‑Bas, l’Autriche et le Danemark ont un taux de pauvreté inférieur. À l’inverse de la France, certains pays cumulent fort taux de pauvreté et seuil de pauvreté très faible, comme les pays baltes, la Bulgarie et la Roumanie. En Espagne et en Italie, le taux de pauvreté est aussi relativement élevé, tandis que le seuil de pauvreté se situe à un niveau intermédiaire, proche de la moyenne des pays de l’UE.
La France se distingue aussi par une intensité de la pauvreté faible en moyenne par rapport à ses voisins européens (16,5 % contre 24,2 %). Parmi les cinq pays avec des intensités de la pauvreté plus faibles que la France, seule la Belgique a un seuil de pauvreté supérieur à la France. Les autres pays ayant une intensité de la pauvreté plus faible que la France ont des seuils de pauvreté significativement plus faibles ; c’est notamment le cas la République tchèque qui a l’intensité de la pauvreté la plus faible mais un seuil de pauvreté de près de 4 000 euros par an, plus faible qu’en France (fiche 1.12).
tableauFigure 12 - Seuil et taux de pauvreté dans l'Union européenne en 20181
| Taux de pauvreté (en %) | Seuil de pauvreté (en SPA) | |
|---|---|---|
| République tchèque | 10,1 | 8 421 |
| Finlande | 11,6 | 12 217 |
| Slovaquie | 11,9 | 6 302 |
| Slovénie | 12,0 | 9 980 |
| Hongrie | 12,3 | 5 616 |
| Danemark | 12,5 | 13 423 |
| Irlande | 13,1 | 11 865 |
| Pays-Bas | 13,2 | 13 181 |
| Autriche | 13,3 | 14 212 |
| France2 | 13,6 | 12 283 |
| Chypre | 14,7 | 11 154 |
| Allemagne | 14,8 | 13 616 |
| Belgique | 14,8 | 13 260 |
| Pologne | 15,4 | 7 401 |
| Zone euro | 16,4 | 11 399 |
| UE à 28 | 16,8 | 10 531 |
| Malte | 17,1 | 11 153 |
| Suède | 17,1 | 12 248 |
| Portugal | 17,2 | 6 961 |
| Luxembourg | 17,5 | 17 366 |
| Grèce | 17,9 | 5 859 |
| Croatie | 18,3 | 6 440 |
| Royaume-Uni3 | 18,6 | 11 054 |
| Italie | 20,1 | 10 259 |
| Lituanie | 20,6 | 6 905 |
| Espagne | 20,7 | 9 703 |
| Estonie | 21,7 | 8 544 |
| Bulgarie | 22,6 | 5 022 |
| Lettonie | 22,9 | 6 619 |
| Roumanie | 23,8 | 4 403 |
- /// : Absence de données due à la nature des choses.
- 1. Le seuil de pauvreté est fixé à 60 % du niveau de vie national médian. L'année retenue ici (2018) correspond à l'année de perception des revenus et non à celle de l'enquête Statistics on income and living conditions (SILC) qui est l'année retenue dans les publications d'Eurostat (2019).
- 2. Les données pour la France diffèrent de celles usuellement utilisées pour l’analyse de la pauvreté en France. Ici, les différents indicateurs sont calculés à partir d'une autre source statistique et sur un champ différent, de manière à disposer de statistiques comparables entre pays européens.
- 3. Donnée SILC-2018 portant sur l’année 2017.
- Champ : Union européenne à 28 pays.
- Source : Eurostat, dispositif EU-SILC.
graphiqueFigure 12 - Seuil et taux de pauvreté dans l'Union européenne en 20181

- /// : Absence de données due à la nature des choses.
- 1. Le seuil de pauvreté est fixé à 60 % du niveau de vie national médian. L'année retenue ici (2018) correspond à l'année de perception des revenus et non à celle de l'enquête Statistics on income and living conditions (SILC) qui est l'année retenue dans les publications d'Eurostat (2019).
- 2. Les données pour la France diffèrent de celles usuellement utilisées pour l’analyse de la pauvreté en France. Ici, les différents indicateurs sont calculés à partir d'une autre source statistique et sur un champ différent, de manière à disposer de statistiques comparables entre pays européens.
- 3. Donnée SILC-2018 portant sur l’année 2017.
- Champ : Union européenne à 28 pays.
- Source : Eurostat, dispositif EU-SILC.
Encadré 1 - Un premier éclairage sur l’évolution des revenus en 2020
Les niveaux de vie des ménages de 2019 et 2020 ne sont pas connus à l’heure de la publication de cet ouvrage. En effet, leur construction s’appuie sur les données fiscales et sociales (sources), qui ne sont disponibles qu’environ un an après la fin de l’année considérée, auquel s’ajoute un temps de traitement des données (appariements et imputations). Quelques données sur l’évolution des revenus en 2020 permettent toutefois de premiers éclairages sur l’impact de la crise sanitaire.
D’après la première estimation des comptes nationaux, le pouvoir d’achat des ménages (revenu disponible brut corrigé de l’inflation) par unité de consommation (UC) a baissé de 0,4 % en 2020, après une hausse de 1,5 % en 2019. La forte hausse des prestations sociales en espèces et la baisse des prélèvements ont presque compensé en moyenne la forte baisse de la masse salariale et des revenus de la propriété liée à la crise sanitaire. Cette légère baisse cache de fortes variations au cours de l’année : le pouvoir d’achat des ménages par UC a baissé de 0,9 % au 1er trimestre et de 1,9 % au 2e trimestre, et augmenté par la suite de 2,6 % au 3e trimestre et de 1,5 % au 4e.
Ces évolutions moyennes recouvrent des situations diverses selon le profil des ménages. Quelques sources peuvent les documenter à ce stade : les données sur les prestations sociales, les données bancaires et les données d’enquêtes.
Les données de bénéficiaires de prestations sociales donnent un premier éclairage sur la situation financière des ménages les plus modestes Ouvrir dans un nouvel onglet[Cabannes et al., 2020]. C’est le cas en particulier du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). En effet, l’éligibilité au RSA dépend des ressources du ménage les mois précédents, et le RSA est ciblé sur les ménages les plus modestes : deux tiers des allocataires du RSA sont en situation de pauvreté monétaire en 2018. Alors que le nombre d’allocataires du RSA était relativement stable depuis début 2017, autour de 1,9 million et avec un taux de croissance en glissement annuel compris entre − 0,2 % et + 1,3 %, il a augmenté constamment depuis la crise sanitaire pour atteindre 165 000 bénéficiaires supplémentaires en septembre 2020, correspondant à une hausse de + 8,7 % par rapport à septembre 2019 (figure A). Le nombre d’allocataires du RSA a légèrement ralenti depuis : la hausse s’établit à 7,5 % en décembre 2020 par rapport à décembre 2019 (+ 143 000 bénéficiaires supplémentaires). Un non‑recours important existant au RSA, la dégradation financière pourrait concerner plus de ménages que celle suggérée par la hausse du nombre d’allocataires. La hausse des effectifs depuis juin s’explique en premier lieu par le faible nombre de sorties du RSA, puis par l’importance des entrées d’allocataires l’ayant déjà été dans le passé Ouvrir dans un nouvel onglet[Cnaf, 2020]. Elle ne correspondrait donc pas à l’entrée massive de nouveaux allocataires et concernerait surtout des personnes qui ont déjà été par le passé dans une situation financière difficile. La hausse du nombre d’allocataires est plus marquée dans les départements où la proportion d’allocataires est habituellement faible (Sud et Centre Est, et Ouest de la France). Enfin, le montant moyen de RSA reçu serait plus élevé que dans une situation hors crise sanitaire Ouvrir dans un nouvel onglet[Cnaf 2021], ce qui indique que les ressources des allocataires ont diminué.
En 2020, le nombre de bénéficiaires des aides au logement (AL), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l’aide spécifique du Crous, trois prestations également très ciblées sur les personnes à bas revenus, augmente aussi. La hausse des bénéficiaires des AL débute en avril 2020 et est progressive avec un pic à + 2,5 % en novembre 2020 en glissement annuel, alors que les effectifs étaient en baisse d’en moyenne 1 % en glissement annuel entre mars 2019 et mars 2020. La hausse des bénéficiaires de l’ASS débute quant à elle en juillet 2020 et atteint 6,1 % en octobre 2020, après une période avant crise où les effectifs baissaient fortement depuis 2018 Ouvrir dans un nouvel onglet[Cabannes et al., 2020]. Enfin, la situation financière des étudiants (qui n’ont pas accès au RSA) se dégrade : en décembre 2020, 10 400 étudiants ont bénéficié d’une aide spécifique ponctuelle attribuée par les services sociaux des Crous en cas de situation d’urgence ou de détresse avérée, soit une hausse de 48 % par rapport à janvier 2019.
tableauA. Nombre d’allocataires du RSA depuis janvier 2017
| Effectif | ||
|---|---|---|
| 2017 | janvier | 1 895 900 |
| février | 1 891 000 | |
| mars | 1 893 300 | |
| avril | 1 893 500 | |
| mai | 1 894 100 | |
| juin | 1 887 900 | |
| juillet | 1 879 100 | |
| août | 1 870 200 | |
| septembre | 1 868 100 | |
| octobre | 1 875 200 | |
| novembre | 1 883 700 | |
| décembre | 1 883 800 | |
| 2018 | janvier | 1 891 300 |
| février | 1 890 100 | |
| mars | 1 891 700 | |
| avril | 1 890 700 | |
| mai | 1 893 400 | |
| juin | 1 892 400 | |
| juillet | 1 887 200 | |
| août | 1 880 800 | |
| septembre | 1 883 000 | |
| octobre | 1 894 200 | |
| novembre | 1 905 300 | |
| décembre | 1 903 800 | |
| 2019 | janvier | 1 903 700 |
| février | 1 902 200 | |
| mars | 1 902 700 | |
| avril | 1 902 000 | |
| mai | 1 904 500 | |
| juin | 1 902 000 | |
| juillet | 1 900 100 | |
| août | 1 893 700 | |
| septembre | 1 898 200 | |
| octobre | 1 907 200 | |
| novembre | 1 916 800 | |
| décembre | 1 916 100 | |
| 2020 | janvier | 1 920 900 |
| février | 1 926 000 | |
| mars | 1 950 100 | |
| avril | 1 971 700 | |
| mai | 1 988 100 | |
| juin | 2 019 800 | |
| juillet | 2 046 500 | |
| août | 2 056 100 | |
| septembre | 2 063 600 | |
| octobre | 2 069 300 | |
| novembre | 2 076 600 | |
| décembre | 2 059 200 | |
| 2021 | janvier | 2 039 800 |
- Note : les données de septembre 2020 à janvier 2021 sont provisoires. Les données ne sont pas désaisonnalisées.
- Lecture : fin janvier 2021, 2 039 800 foyers bénéficiaient du revenu de solidarité active (RSA) soit une augmentation de 6,2 % par rapport à fin janvier 2020.
- Champ : effectifs en France en fin de mois.
- Sources : Cnaf, Allstat FR6 et FR2, estimations Drees pour les données provisoires ; MSA.
graphiqueA. Nombre d’allocataires du RSA depuis janvier 2017

- Note : les données de septembre 2020 à janvier 2021 sont provisoires. Les données ne sont pas désaisonnalisées.
- Lecture : fin janvier 2021, 2 039 800 foyers bénéficiaient du revenu de solidarité active (RSA) soit une augmentation de 6,2 % par rapport à fin janvier 2020.
- Champ : effectifs en France en fin de mois.
- Sources : Cnaf, Allstat FR6 et FR2, estimations Drees pour les données provisoires ; MSA.
Les données bancaires donnent une idée de l’évolution mensuelle des revenus et de son hétérogénéité selon le profil des individus. Ainsi, comme dans Bonnet et al. (2021), les données du Crédit Mutuel Alliance Fédérale sont mobilisées en considérant la somme des chèques et virements entrants comme une approximation des revenus. Des différences importantes entre la mesure habituelle des revenus et celle issue des données bancaires mobilisées ici existent toutefois, liées notamment à la population considérée (celle des clients de ce groupe bancaire, qui n’a pas la même structure que l’ensemble de la population française) ou bien à la définition des revenus. Les résultats suivants donnent donc plutôt des indications. D’après ces données, lors du premier confinement, les revenus perçus ont globalement diminué, et ce, pour l’ensemble des quartiles de revenu. En avril et en mai 2020, la médiane des revenus a diminué de 8 à 9 % par rapport aux mêmes mois de l’année précédente. La baisse a été plus forte pour le 3e quartile de revenus (c’est‑à‑dire le revenu plancher du quart de la population qui en perçoit le plus) que pour le 1er quartile. Après le déconfinement, les revenus ont beaucoup progressé en juin, avec un fort rebond pour tous les quartiles de revenus (d’environ 8 %), légèrement plus élevé pour le 3e quartile. La fin de l’année a été marquée, malgré le deuxième confinement, par un relatif retour à la normale (à part une légère baisse en octobre), avec une évolution moyenne plus proche de celle observée en février 2020 avant la crise.
D'autres études ciblées sur le premier confinement à partir des enquêtes Camme et Epicov [Albouy et Legleye, 2020 ; Givord et Silhol, 2020] avaient cependant montré que les personnes les plus modestes déclaraient plus souvent que leur situation financière s’était dégradée pendant le premier confinement, entre mars et mai 2020. Depuis octobre 2020, l’enquête Camme interroge directement les ménages de France métropolitaine sur les éventuelles conséquences de la crise sanitaire sur leur revenu. 69 % des ménages indiquent que leur revenu mensuel est quasi‑stable entre mars 2020 et le premier trimestre 2021, 9 % qu’il augmente et 22 % qu’il baisse [Clerc et al., 2021]. 29 % des ménages appartenant aux 20 % les plus modestes estiment que leur revenu a baissé (figure B) (dont 26 % de plus de 100 euros), cette part étant également élevée pour les 20 % suivants (26 %) mais nettement plus faible ensuite (en moyenne 18 % sur le reste de la distribution). En moyenne, les ménages estiment avoir eu une perte de leur revenu mensuel par UC, relativement limitée, de l’ordre de 2 %. La baisse est plus marquée pour les 20 % les plus modestes (− 8 % de leur revenu par UC avant crise) que la moyenne, et notamment que les 20 % les plus aisés (− 1 %). La baisse de 5 % pour les personnes entre le 2e et le 4e décile est également supérieure à la moyenne (figure B). Ces données sont déclaratives et pourraient correspondre davantage à un revenu primaire ou un salaire, plutôt qu’au niveau de vie mesuré habituellement. Selon Eurostat (2020), les revenus du travail avant mesure de chômage partiel (et autres mesures de soutien de l’État) auraient davantage baissé chez les plus modestes que chez les plus aisés en France et en général dans les pays européens. La redistribution liée aux mesures de chômage partiel serait également plus forte pour les plus modestes.
Les enquêtes et les données bancaires ne donnent pas des signaux complètement convergents sur l’effet de la crise sur les inégalités de revenu en 2020. Ces données sont imparfaites en matière de représentativité de la population et de définition du revenu, et il est donc nécessaire d’attendre les estimations avancées du taux de pauvreté et les indicateurs d’inégalités de niveau de vie à l’automne 2021, puis les données de l’ERFS à l’été 2022 pour connaître précisément l’évolution des inégalités de niveau de vie en 2020.
tableauB. Part des ménages indiquant une baisse de revenu et évolution du revenu au 1er trimestre 2021 par rapport à mars 2020
| 1er cinquième | 2e cinquième | 3e cinquième | 4e cinquième | 5e cinquième | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part des ménages indiquant une baisse de revenu¹ | 29,1 | 26,2 | 17,4 | 18,6 | 17,1 |
| Évolution du revenu par UC | -7,9 | -4,7 | -1,5 | -1,6 | -0,6 |
- 1. Baisse de revenu de plus de 50 euros.
- Lecture : au 1er trimestre 2021, 29 % des personnes appartenant au 1er cinquième de la population (les 20 % les plus modestes) ont déclaré une baisse de revenu depuis mars 2020. En moyenne, leur revenu a baissé de 8 % sur la période.
- Champ : ménages vivant en logement ordinaire en France métropolitaine.
- Source : Insee, enquête Camme vagues entrantes de janvier à mars 2021 empilées.
graphiqueB. Part des ménages indiquant une baisse de revenu et évolution du revenu au 1er trimestre 2021 par rapport à mars 2020

- 1. Baisse de revenu de plus de 50 euros.
- Lecture : au 1er trimestre 2021, 29 % des personnes appartenant au 1er cinquième de la population (les 20 % les plus modestes) ont déclaré une baisse de revenu depuis mars 2020. En moyenne, leur revenu a baissé de 8 % sur la période.
- Champ : ménages vivant en logement ordinaire en France métropolitaine.
- Source : Insee, enquête Camme vagues entrantes de janvier à mars 2021 empilées.
tableauC. Distribution des revenus des ménages en 2020, en glissement annuel
| 1er quartile | Médiane | 3e quartile | |
|---|---|---|---|
| févr. | 3,31 | 1,07 | 0,56 |
| mars | 3,32 | 0,8 | -0,27 |
| avr. | -5,64 | -8,9 | -11,71 |
| mai | -5,91 | -8,43 | -10,94 |
| juin | 8,29 | 7,82 | 8,7 |
| juil. | 1,45 | 0,28 | -0,82 |
| août | 3,04 | 3,05 | 2,85 |
| sept. | 2,2 | 1,35 | 1,09 |
| oct. | -1,86 | -2,58 | -2,92 |
| nov. | 3,17 | 2,09 | 1,7 |
| déc. | 0,81 | 0,39 | 0,56 |
- Note : les quartiles et la médiane sont des seuils de revenu et s’interprètent comme suit : un quart des ménages gagnent moins que le 1er quartile, la moitié moins que la médiane et les trois quart moins que le 3e quartile.
- Lecture : en avril 2020, le 1er quartile de revenu était 5,6 % plus bas que son niveau d'avril 2019.
- Champ : clients Crédit Mutuel de France métropolitaine hors Corse.
- Source : données Crédit Mutuel Alliance Fédérale, calculs Insee.
graphiqueC. Distribution des revenus des ménages en 2020, en glissement annuel

- Note : les quartiles et la médiane sont des seuils de revenu et s’interprètent comme suit : un quart des ménages gagnent moins que le 1er quartile, la moitié moins que la médiane et les trois quart moins que le 3e quartile.
- Lecture : en avril 2020, le 1er quartile de revenu était 5,6 % plus bas que son niveau d'avril 2019.
- Champ : clients Crédit Mutuel de France métropolitaine hors Corse.
- Source : données Crédit Mutuel Alliance Fédérale, calculs Insee.
Encadré 2 - Effet de la réduction du loyer de solidarité
La réforme de la réduction du loyer de solidarité (RLS), mise en œuvre en février 2018, a simultanément baissé les allocations logement des ménages du parc social et réduit les loyers dans ce parc d’un montant équivalent. Cette mesure est donc neutre pour les ménages concernés dans le parc social. Or, seule la réduction des allocations logement affecte le niveau de vie compte tenu de sa définition, tandis que la réduction des loyers concerne les dépenses de consommation et n’est donc pas prise en compte dans le niveau de vie. Cette mesure a donc conduit à une baisse des niveaux de vie des ménages habitant dans le parc social, compensée à due concurrence par une baisse de leurs dépenses. La mesure aurait affecté 2,1 millions de bénéficiaires selon les données de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf). Un tiers des ménages bénéficiaires d’allocations logement ont perçu la RLS.
En utilisant ces données de la Cnaf, la RLS aurait un effet de – 0,6 % pour le 1er décile de niveau de vie, et de – 0,4 % pour le 2e. Elle aurait un effet de + 0,3 point sur le taux de pauvreté et de + 0,001 sur l’indice de Gini. Ainsi, sans prise en compte de cette mesure, le taux de pauvreté aurait augmenté de 0,4 point entre 2017 et 2018 et aurait atteint 14,5 % en 2018 (et 14,2 % en 2019 en utilisant les estimations provisoires).
Encadré 3 - Estimation du nombre de personnes pauvres non comptabilisées habituellement
Le champ de la plupart des données utilisées dans cette vue d’ensemble est celui des ménages ordinaires, c’est‑à‑dire que sont exclus les personnes vivant en collectivité (foyers, maisons de retraite, etc.), ainsi que les sans‑abri et les personnes vivant dans des habitations mobiles (caravanes, roulottes, etc.). Une deuxième exclusion concerne les jeunes vivant dans un ménage dont la personne de référence est étudiante, du fait des transferts intra familiaux fréquents qui ne sont pas appréhendés par la source ERFS. Cet encadré propose un chiffrage de ces populations usuellement exclues des analyses sur la pauvreté.
Les personnes sans domicile
Au 1er janvier 2017, 77 000 personnes sont sans abri ou vivent dans des établissements pour personnes en grande difficulté sociale, selon les données du recensement de la population. Ces personnes sont ici toutes supposées pauvres au seuil de 60 %. Cette population correspond environ à la moitié des sans domicile en France d’après l’enquête auprès des sans‑domicile de 2012, l’autre moitié étant constitué des personnes hébergées dans un logement ou vivant dans un hôtel qui sont susceptibles d’être présentes dans les données de l’ERFS.
Les personnes en habitation mobile
Le recensement des habitations mobiles et des personnes sans abri (HMSA) estime au 1er janvier 2017 à 108 000 le nombre de personnes résidant en habitation mobile. Selon l’enquête de la Drees sur les bénéficiaires de minima sociaux de 2018, la totalité des personnes résidant en habitation mobile vivrait dans un ménage bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le montant est inférieur au seuil de pauvreté.
Les personnes hébergées en communauté
Pour les 1,3 million de personnes (soit 2 % de la population française) vivant au sein d’une communauté au sens du recensement (hors centres d’hébergement), les sources et méthodes suivantes ont été appliquées pour estimer le nombre de personnes en situation de pauvreté (reposant en grande partie sur la méthodologie adoptée par Blasco et Picard, 2021) :
Pour les 574 000 personnes âgées résident en Ehpad ou en maisons de retraite (représentant 43 % de la population vivant en communauté), leur taux de pauvreté au seuil de 60 % (à partir du seuil calculé sur les ménages ordinaires) est estimé en mobilisant l’enquête CARE‑Institutions, volet Seniors, de 2016 (voir Blasco et Picard, 2021, cet ouvrage).
Pour les 268 000 personnes résidant dans des structures pour personnes nécessitant des soins médicaux, pour personnes handicapées ou pour enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et les 358 000 personnes résidant en communauté du fait de leur situation d’activité (foyers de travailleurs, cité universitaire, internat scolaire ou foyer d’étudiants, gendarmerie et autre établissement militaire notamment), deux méthodes sont appliquées selon l’âge des individus, à chacun des douze types de communauté :
- pour les personnes mineures et celles âgées de 25 ans ou plus, on applique les taux de pauvreté selon le sexe et l’âge calculés dans l’ERFS de 2017 à la structure par sexe et par âge de chaque communauté.
- pour les jeunes de 18 à 24 ans (qui représentent 19 % des personnes vivant en communauté), les taux de pauvreté au seuil de 60 % sont estimés à partir de l’enquête nationale sur les ressources des jeunes (ENRJ) (annexe) réalisée en 2014 par la Drees et l’Insee. Dans cette enquête, le revenu disponible des jeunes n’habitant plus avec leurs parents est calculé à partir des déclarations de l’enquêté et comprend les aides monétaires des parents. Le taux de pauvreté des jeunes résidant dans ces communautés a été appliqué à la population des personnes de 18 à 24 ans vivant dans ces communautés.
Aucune donnée n’est disponible pour les 94 000 personnes vivant dans des communautés religieuses ou en établissement pénitentiaire, qui n’ont donc pas été comptabilisées ici.
Au total, 278 000 personnes seraient pauvres dans les communautés hors centres d’hébergement.
Les jeunes vivant dans un ménage dont la personne de référence est étudiante
6,3 % des 4,7 millions de personnes de 18 à 24 ans en logement ordinaire vivent dans un ménage dont la personne de référence est étudiante en 2018 : ils ne vivent ni chez leurs parents, ni en communauté. Le taux de pauvreté de ces jeunes, estimé à partir de l’enquête ENRJ et en prenant en compte les aides monétaires des parents, est de 80 %. En appliquant ce taux aux effectifs observés dans l’ERFS en 2018, 230 000 étudiants décohabitants seraient pauvres. En prenant aussi en compte les aides non monétaires des parents, le taux de pauvreté serait plus faible, de 57 %, ce qui conduirait à un nombre d’étudiants décohabitants pauvres de 170 000.
Sources
Les enquêtes Revenus fiscaux et sociaux (ERFS)
Les statistiques présentées dans la majeure partie de cette vue d’ensemble sont tirées des enquêtes Revenus fiscaux et sociaux (ERFS), privilégiées à l’Insee pour le calcul des niveaux de vie (cf. infra) et disponibles annuellement depuis 2005. L’ERFS s’appuie sur un échantillon de ménages représentatifs de la France métropolitaine issu de l’enquête Emploi de l’Insee, sur leurs déclarations fiscales, ainsi que sur les prestations sociales qu’ils ont perçues. Le champ retenu est celui des personnes vivant en France métropolitaine et appartenant à un ménage ordinaire dont la personne de référence n’est pas étudiante et dont le revenu déclaré est positif ou nul. Il exclut donc notamment les personnes résidant en institution ainsi que les personnes sans abri. En 2018, l’enquête s’appuie sur un échantillon de 50 300 ménages et couvre une population de 63,1 millions de personnes. Avec un intervalle de confiance de 95 %, le niveau de vie annuel moyen ou médian se situe dans un intervalle de +/– 130 euros et le taux de pauvreté à 60 % dans un intervalle de +/– 0,46 point.
Depuis 2005, la mesure des revenus dans les ERFS a fait l’objet d’améliorations qui génèrent plusieurs ruptures de séries, en 2010 et 2013 (voir annexe sources et méthodes de cet ouvrage). Afin de pouvoir apprécier les évolutions sur longue période, les indicateurs ont été rétropolés jusqu’en 1996 en chaînant leurs évolutions à méthodologie constante (soit en taux d’évolution pour les niveaux de vie, soit en variation de points pour les indices).
Avant 2005, les enquêtes Revenus fiscaux (ERF) ont été utilisées : elles s’appuyaient également sur l’enquête Emploi et les déclarations de revenus des ménages répondants à l’enquête et les revenus étaient complétés par imputation des revenus sociaux sur barème. La série d’ERF a été rétropolée sur 1996‑2004 pour corriger des ruptures de séries.
Le dispositif Filosofi
Le dispositif Filosofi (Fichier localisé social et fiscal) remplace les anciens dispositifs Revenus fiscaux localisés (RFL) et Revenus disponibles localisés (RDL) à partir de 2012. Les données issues de Filosofi proviennent du rapprochement des données fiscales (les déclarations de revenus des personnes physiques, la taxe d’habitation et le fichier d’imposition des personnes) fournies à l’Insee par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et des données sur les prestations sociales émanant des principaux organismes gestionnaires de ces prestations : la caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), la caisse nationale assurance vieillesse (Cnav) et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Elles sont complétées par des imputations de certains revenus financiers selon une méthodologie proche de celle de l’ERFS. Les statistiques sont produites sur la France métropolitaine jusqu’en 2014 et en Martinique et à La Réunion en 2015. Le champ couvert est celui des ménages fiscaux dits « ordinaires », c’est‑à‑dire ayant rempli au moins une déclaration de revenus et imposables au titre de la taxe d’habitation.
Le dispositif Filosofi est utilisé pour donner des statistiques au niveau infra national du fait de son exhaustivité. Cependant, sur le plan national, l’ERFS reste la source de référence pour l’observation du revenu disponible, des inégalités de niveaux de vie et de la pauvreté. En effet, les données sociales sont mieux appariées1, les revenus financiers non fiscalisés sont mieux imputés, et le lien logement‑individu est mieux fait à partir de l’enquête Emploi. De plus les données de l’ERFS sont rétropolées à méthodologie identique (cf. supra), contrairement à Filosofi, ce qui permet d’avoir une profondeur historique plus importante dans l’ERFS.
L’enquête SRCV
Les Statistiques sur les ressources et conditions de vie (SRCV) sont la partie française du système de statistiques communautaires EU‑SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions). Les statistiques françaises sont collectées annuellement sous la forme d’une enquête en panel, qui a pris en 2004 la suite du Panel européen. Chaque année, un échantillon d’environ 3 000 logements répondant pour la première fois à l’enquête alimente le panel tandis que 11 000 logements sont réinterrogés et qu’un échantillon de ménages dit « sortants » le quitte. Les ménages et individus sont interrogés neuf années consécutives (échantillon rotatif renouvelé par neuvième). Chaque année, 14 000 ménages sont interrogés.
Si le dispositif SRCV répond à un objectif de comparaison internationale, l’ERFS reste la source de référence en France sur les revenus. Sur des champs semblables et en prenant la même définition du ménage, les différences entre les taux de pauvreté basés sur les données ERFS et SRCV sont à la limite de la significativité. Les différences de niveau ou d’évolution entre les deux sources s’expliquent donc essentiellement par des différences de champ, de définition du ménage et par l’aléa statistique, les deux enquêtes reposant toutes deux sur un échantillon.
L’enquête sur les ressources des jeunes (ENRJ)
Menée conjointement par la Drees et l’Insee en France en 2014, cette enquête décrit finement les différentes ressources des jeunes adultes de 18 à 24 ans afin de préciser leur niveau de vie. 5 800 jeunes et 6 300 parents ont répondu à l’enquête. Une méthodologie spécifique a été mise en place pour appréhender leurs revenus du travail, y compris non réguliers, et les ressources issues de transferts de la famille, en interrogeant les jeunes quelle que soit leur situation de logement (chez leurs parents, en communauté ou en logement autonome, et y compris en multirésidence), ainsi que leurs parents.
Les données bancaires de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Les résultats de l’encadré 1 reposent sur l’exploitation de données de comptes bancaires anonymisées auxquelles le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a permis l’accès. Elles représentent un échantillon fixe d’individus au cours du temps en 2019 et 2020, permettant d’étudier la manière dont ils ont traversé la crise sanitaire.
L’échantillon a été constitué à partir de clients dont le Crédit Mutuel Alliance Fédérale était la banque principale en décembre 2018 et en juin 2020 selon des critères géographiques et de tranche d’âge. L’échantillon a été repondéré afin de représenter la structure de la population française en termes d’âge et de département de résidence, mais il est important de noter que l’échantillon, même après repondération, n’est pas totalement représentatif de la population française : les retraités restent sous‑représentés, tandis que les étudiants sont sur‑représentés (voir Bonnet et al., 2021 pour plus de détails).
En plus de ces différences de couvertures, plusieurs différences existent entre la mesure habituelle des revenus (ERFS notamment) et celles via des données bancaires : le champ des personnes étudiées diffère1, les données bancaires intègrent une part des transferts entre ménages (ou avec d’autres comptes secondaires dans d’autres banques), et les prélèvements fiscaux non prélevés à la source ne sont pas soustraits des revenus dans les données bancaires. De plus, le fait que les revenus ne sont pas rapportés aux unités de consommation conduit à ordonner les personnes différemment de ce qui est fait dans le reste de l’article à partir des autres sources de données : en particulier les personnes seules sont plus souvent classées en bas de la distribution qu’en haut.
Notre partenaire, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, souhaite rappeler les éléments suivants :
Première banque à adopter le statut d’entreprise à mission, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a participé à cette étude dans le cadre des missions qu’elle s’est fixées :
- contribuer au bien commun en œuvrant pour une société plus juste et plus durable : pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale, participer à l’information économique c’est contribuer au débat démocratique ;
- protéger l’intimité numérique et la vie privée de chacun : Crédit Mutuel Alliance Fédérale veille à la protection absolue des données de ses clients. Toutes les analyses réalisées dans le cadre de cette étude ont été effectuées sur des données strictement anonymisées et sur les seuls systèmes d’information sécurisés et hébergés en France du Crédit Mutuel.
Enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages
Afin de suivre l’opinion des ménages sur leur environnement économique et sur leur situation personnelle, l’Insee réalise une enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages (Camme). Plus de 1 600 ménages répondent tous les mois à l’enquête. Le questionnaire a été plusieurs fois adapté afin d’interroger les Français de métropole sur leurs conditions de vie durant le confinement ou sur les éventuelles conséquences de la crise sanitaire sur leur revenu. La variable de revenu sur laquelle sont interrogés les ménages est différente du niveau de vie de l’ERFS, elle correspond au revenu mensuel déclaré dans l’enquête, hors prestations sociales, mais dont les prélèvements fiscaux et sociaux ont été soustraits.
Définitions
Dans les enquêtes sur les Revenus fiscaux et sociaux (ERFS), le ménage désigne l’ensemble des occupants d’une résidence principale, qu’ils aient ou non des liens de parenté. Le ménage peut ne comprendre qu’une seule personne. Ne font pas partie des ménages les personnes vivant dans des habitations mobiles (y compris les mariniers et les sans‑abri) ou dans des communautés (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, etc.).
Le revenu disponible comprend les revenus d’activité, les indemnités de chômage, retraites et pensions, les revenus du patrimoine (fonciers et financiers) et les autres prestations sociales perçues. Tous ces revenus sont nets des impôts directs : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, contribution sociale généralisée (CSG), contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS) et autres prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Le revenu disponible correspond ainsi à l’ensemble des revenus à la disposition du ménage pour consommer et épargner (voir Glossaire).
Le niveau de vie est le revenu disponible du ménage rapporté au nombre d’unités de consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même pour toutes les personnes d’un même ménage.
Les inégalités avant redistribution sont calculées à partir du niveau de vie avant redistribution. Celui est défini ici comme l’ensemble de ses revenus avant paiement des impôts directs (mais nets de cotisations sociales) et perception des prestations sociales, par unité de consommation (UC). Il comprend ainsi les revenus d’activité (y compris indemnités de chômage), les pensions et retraites et les revenus du patrimoine.
En ordonnant une distribution de revenus ou de niveaux de vie etc., les déciles (notés généralement de D1 à D9) sont les valeurs qui partagent cette distribution en 10 parties d’effectifs égaux. Les centiles (notés généralement de C1 à C99) la partagent en 100 parties d’effectifs égaux. La médiane (D5 ou C50) partage la population en deux sous‑populations égales.
Les dépenses d’un ménage de plusieurs personnes ne sont pas strictement proportionnelles au nombre de personnes, grâce aux économies d’échelle issues de la mise en commun de certains biens. Aussi, pour comparer les niveaux de vie de personnes vivant dans des ménages de taille ou de composition différente, on utilise une mesure du revenu par unité de consommation, à l’aide d’une échelle d’équivalence. L’échelle la plus utilisée actuellement (dite de l’ « OCDE modifiée ») consiste à décompter 1 unité de consommation (UC) pour le premier adulte du ménage, puis 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus, et 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d’un ménage.
Le rapport interdécile est le rapport du 9e décile au 1er décile (D9/D1). Il met en évidence l’écart entre le revenu (ou le niveau de vie) plancher des 10 % des ménages les plus aisés et le revenu plafond des 10 % des ménages les plus modestes.
L’indice de Gini mesure le degré d’inégalité d’une distribution (par exemple, le revenu ou le niveau de vie) pour une population donnée. Il varie entre 0 et 1, la valeur 0 correspondant à l’égalité parfaite (tous les ménages ont le même revenu), la valeur 1 à l’inégalité extrême (un ménage a tout le revenu, les autres n’ayant rien).
Le ratio (100‑S80)/S20 ou rapport interquintile des masses met en évidence les écarts entre la masse des revenus disponibles par UC détenue par les 20 % des personnes les plus aisées et celle détenue par les 20 % des personnes les plus pauvres.
Le taux de pauvreté est le pourcentage de la population dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Pour la pauvreté monétaire, ce seuil est calculé, au niveau national, comme étant égal à 60 % du niveau de vie médian de l’ensemble des personnes.
L’intensité de la pauvreté permet d’apprécier à quel point le niveau de vie de la population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. Elle est mesurée comme l’écart relatif entre le niveau de vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté, rapporté au seuil de pauvreté. Plus cet indicateur est élevé et plus la pauvreté est dite « intense », au sens où le niveau de vie des plus pauvres est très inférieur au seuil de pauvreté.
La personne de référence du ménage est déterminée à partir de la structure familiale du ménage et des caractéristiques des individus qui le composent. Il s’agit le plus souvent de la personne de référence de la famille quand il y en a une, ou de l’homme le plus âgé, en donnant priorité à l’actif le plus âgé.
Quatre catégories de commune sont distinguées selon leur densité de population. Cette catégorisation s’appuie sur la distribution de la population à l’intérieur de la commune en découpant le territoire en carreaux de 1 kilomètre de côté. Elle repère ainsi des zones agglomérées. C’est l’importance de ces zones agglomérées au sein des communes qui va permettre de les caractériser (et non la densité communale habituelle). Cette classification reprend les travaux d’Eurostat, en introduisant une catégorie supplémentaire pour tenir compte des espaces faiblement peuplés, plus fréquents en France que dans d’autres pays européens.
L’aire d’attraction d’une ville définit l’étendue de son influence sur les communes environnantes. Une aire est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi, et d’une couronne, constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Au sein du pôle, la commune la plus peuplée est appelée commune‑centre.
Le modèle Ines est un modèle de microsimulation qui simule les effets de la législation sociale et fiscale française. Il est cogéré par l’Insee, la Drees et la Cnaf.
L'unité de standard de pouvoir d’achat (SPA) permet d’exprimer dans une unité commune les pouvoirs d’achat des différentes monnaies. Elle est calculée à partir de la parité de pouvoir d’achat (PPA), rapport entre la quantité d’unités monétaires nécessaire dans des pays différents pour se procurer un même panier de biens et de services.
Accardo J., « La mobilité des niveaux de vie en France », in Les revenus et le patrimoine des ménages, coll. « Insee Références », édition 2016.
Accardo A., André M., Billot S., Germain J.‑M., Sicsic M., « Réduction des inégalités : la redistribution est deux fois plus ample en intégrant les services publics », in Les revenus et le patrimoine des ménages, coll. « Insee Références », édition 2021.
Acemoglu D., Restrepo P., "Ouvrir dans un nouvel ongletRobots and Jobs: Evidence from US Labor Markets", Journal of Political Economy 128(6): 2188‑2244, 2020.
Autor D. H., Dorn D., Hanson G., Song J., "Ouvrir dans un nouvel ongletTrade Adjustment: Worker Level Evidence", Quarterly Journal of Economics 129(4): 1799–1860, 2014.
Autor D. H., Manning A., Smith C. L., "Ouvrir dans un nouvel ongletThe Contribution of the Minimum Wage to US Wage Inequality over Three Decades: A Reassessment", American Economic Journal: Applied Economics 8 (1): 58‑99, 2016.
Albouy V., Delmas F., « 70 % des personnes pauvres en 2016 le restent l’année suivante, une persistance en hausse depuis 2008 », Insee Focus n° 208, octobre 2020.
Albouy V., Legleye S., « Conditions de vie pendant le confinement : des écarts selon le niveau de vie et la catégorie socioprofessionnelle », Insee Focus n° 197, juin 2020.
Aghion P., Akcigit U., Bergeaud A., Blundell R., Hemous D., "Ouvrir dans un nouvel ongletInnovation and Top Income Inequality", The Review of Economic Studies, Volume 86, Issue 1, 1–45, janvier 2019.
Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G., "Towards a System of Distributional National Accounts: Methods and Global Inequality Estimates from WID.world", Economie et Statistique / Economics and Statistics, 517‑518‑519, 41–59, Insee, 2020.
Audoux L., Mallemanche C., Prévot P., « Une pauvreté marquée dans les DOM, notamment en Guyane et à Mayotte », Insee Première n° 1804, juillet 2020.
Bach L., Bozio A., Fabre B., Guillouzouic A., Leroy C., Malgouyres C., « Ouvrir dans un nouvel ongletÉvaluation d’impact de la fiscalité des dividendes », Rapport IPP n° 25, 2019.
Berger E., Bonnet O., « Les hauts salaires dans le secteur privé », Insee Première n° 1800, mai 2020.
Blasco J., Labarthe J., « Inégalité de niveaux de vie et pauvreté en 2015 et sur longue période », in Les revenus et le patrimoine des ménages, coll. « Insee Références », édition 2018.
Blasco J., Picard S., « Quarante ans d’inégalités de niveau de vie et de redistribution en France (1975‑2016) », in France, portrait social, coll. « Insee Références », édition 2019.
Boiron A., Huwer M., Labarthe J., « Inégalités de niveaux de vie et pauvreté en 2013 », in Les revenus et le patrimoine des ménages, coll. « Insee Références », édition 2016.
Bonnet O., Olivia T., Roudil‑Valentin, « En 2020, la chute de la consommation a alimenté l’épargne, faisant progresser notamment les hauts patrimoines financiers », Insee, Note de conjoncture, mars 2021.
Boustanifar H., Grant E., Reshef A., "Ouvrir dans un nouvel ongletWages and Human Capital in Finance: International Evidence, 1970–2011", Review of Finance, 22(2), 699–745, 2018.
Bozio A., Garbinti B., Goupille‑Lebret J., Guillot M., Piketty T., "Ouvrir dans un nouvel ongletPredistribution vs. Redistribution: Evidence from France and the U.S.", WID.world Working Paper, n° 2020/24, 2020.
Buresi G., Cornuet F., « Estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs d’inégalités », Insee Analyses n° 60, novembre 2020.
Cabannes P.‑Y., Calvo M., Echegu O., « Ouvrir dans un nouvel ongletPlus de 2 millions d’allocataires du RSA fin octobre 2020 », DREES, Études et Résultats n° 1175, décembre 2020.
Causa O., Hermansen M., "Ouvrir dans un nouvel ongletIncome redistribution through taxes and transfers across OECD countries", OECD Economics Department Working Papers No. 1453, 2017.
Chaput K., Herviant J., Jabot D., Khelladi I., de Lapasse B., « Les inégalités territoriales de niveau de vie en France entre 2008 et 2017 », in La France et ses territoires, coll. « Insee Références », édition 2021.
Clerc M., Legleye S., Nougaret A., « Au premier trimestre 2021, 22 % des ménages déclarent une baisse de revenus par rapport à mars 2020 », Insee Focus, n° 238, mai 2021.
Cnaf, « Ouvrir dans un nouvel ongletEstimations avancées des évolutions des foyers allocataires du RSA », RSA conjoncture, novembre 2020.
Cnaf, « Ouvrir dans un nouvel ongletLe revenu de solidarité active fin septembre 2020 », RSA conjoncture, janvier 2021.
Drees, « Ouvrir dans un nouvel ongletMinima sociaux et prestations sociales », édition 2020.
Eurostat, « Ouvrir dans un nouvel ongletImpact of COVID‑19 on employment income ‑ advanced estimates », Experimental statistics, 2020.
Givord P., Silhol J., « Confinement : des conséquences économiques inégales selon les ménages », Insee Première n° 1822, octobre 2020.
Guillaud E., Olckers M., Zemmour M., "Ouvrir dans un nouvel ongletFour levers of redistribution: The impact of tax and transfer systems on inequality reduction", Review of Income and Wealth, 2019.
Houdré C., Missègue N., Ponceau J., « Inégalités de niveau de vie et pauvreté en 2011 », in Les revenus et le patrimoine des ménages, coll. « Insee Références », édition 2014.
Insee, « Rapport du groupe d’experts sur la mesure des inégalités et de la redistribution », sous la direction de J.‑M. Germain, Insee Méthodes n° 138, février 2021.
Madec P., Malliet P., Plane M., Sampognaro R., Timbeau X., « Entre 2008 et 2016, les réformes sociales et fiscales ont pesé sur le revenu des ménages mais ont renforcé le rôle d’amortisseur social du système redistributif », in France, Portrait Social, coll. « Insee Références », édition 2018.
Piketty T., Saez E., Stantcheva S., "Ouvrir dans un nouvel ongletOptimal Taxation of Top Labor Incomes: A Tale of Three Elasticities.", American Economic Journal: Economic Policy, 6 (1): 230‑71, 2014.
Robin M., Guevara S., « 43 % des personnes à très haut revenu habitent en Île‑de‑France », Insee Focus, n° 192, mai 2020.
Rousselon J., Viennot M., « Ouvrir dans un nouvel ongletInégalités primaires, redistribution : comment la France se situe en Europe », Note d’analyse n° 97, France Stratégie, 2020.
Les résultats suivants sont issus de l’enquête Revenus fiscaux et sociaux. D’autres sources, détaillées en annexe, sont également mobilisées dans cette vue d’ensemble.
Seule la source Filosofi permet de mesurer les inégalités tout en haut de la distribution. Ici, les résultats donnés sur les 1 % ou 0,1 % les plus aisés sont issus de cette source et les données sur les déciles, l’indice de Gini et le ratio (100‑S80/S20) sont issues de l’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS).
Les séries présentées ici commencent en 1996, date à partir de laquelle les données sont complètes et harmonisées. Blasco et Picard (2018) mesurent les inégalités depuis 1975 sur un champ constant (mais partiel, hors revenus financiers non fiscalisés et allocation adulte handicapé) et obtiennent les mêmes résultats (voir fiche 1.9) : le point bas des inégalités aurait été en 2004 selon le rapport interdécile et en 1997‑1998 selon le rapport interquintile et l’indice de Gini. D’après Bozio et al. (2020), le point bas des inégalités mesurées par le ratio entre les 10 % les plus aisés et les 50 % les plus pauvres aurait été atteint en 2014, et le point bas de la part des 10 % les plus aisés aurait été atteint au début des années 1980. D’après toutes les analyses, les inégalités ont fortement diminué dans les années 1970, notamment avec le développement de la protection sociale qui a fait augmenter le niveau de vie des plus modestes plus fortement que celui du reste de la population.
En effet, en 2013, l’imposition des dividendes était passée d’un taux forfaitaire à une imposition au barème et une forte baisse des dividendes avait été observée, alors que la réforme inverse de 2018 mettant en place le prélèvement forfaitaire unique (PFU) a entrainé une forte hausse des dividendes. D’après Bach et al. (2019), les dividendes ont pu être mis en réserve dans les entreprises entre 2013 et 2017 en attendant une fiscalité plus favorable.
Ces individus sont définis en fonction de leur niveau de vie avant redistribution.
Le niveau de vie avant redistribution moyen des 10 % les plus modestes diminue quant à lui de 22,0 % entre 2008 et 2018.
Les données de la source Filosofi ne sont à méthodologie constante que depuis 2013. Les données précédemment citées pour les 10 % les plus aisés sont quant à elles calculées à partir de l’ERFS, à méthodologie constante depuis 1996.
Cette hausse a été initiée dans les années 1980 selon Bozio et al. (2020).
La baisse des inégalités après redistribution depuis 1900 serait liée pour les trois quarts à la baisse des inégalités avant redistribution selon Bozio et al. [2020]. Cela s’expliquerait notamment par la mise en place (et l’augmentation) du salaire minimum et de la protection sociale.
Si les comparaisons internationales varient beaucoup selon la définition du niveau de vie avant redistribution prise en compte (notamment selon l’intégration ou non des retraites et des cotisations sociales), elles convergent globalement vers le fait que la France serait dans une situation intermédiaire ou légèrement moins inégalitaire que les autres pays avant redistribution.
Le taux est de 8,7 % pour les personnes de plus de 75 ans. Mais ce chiffre n’est pas directement comparable aux taux de pauvreté aux âges moins avancés car au delà de 75 ans, une proportion non négligeable vit en Ehpad, ménages qui ne sont pas pris en compte ici.
Hors établissements pour personnes en grande difficulté sociale, dont le chiffrage est donné conjointement avec les sans‑abri, ci-après.
Les sans domicile hébergés dans un logement par une association ou vivant dans un hôtel sont susceptibles d’être interrogés dans les enquêtes ménages. Ils sont donc a priori compris dans les 9,3 millions de personnes vivant en logement ordinaire en situation de pauvreté.
Ce chiffrage est effectué avec le seuil de pauvreté classique (en ménage ordinaire). Il surestime donc légèrement le nombre de personnes pauvres. En effet, en prenant en compte les personnes vivant en communauté, qui ont en majorité des revenus plus faibles que la population totale, le niveau de vie médian serait plus bas, entraînant une baisse du seuil de pauvreté. Ce chiffre inclut aussi une partie des communautés qui sont dans les DOM.
Soit le seuil de 1 010 euros mesuré avec l’enquête Budget de famille en 2017, auquel on applique l’augmentation du niveau de vie médian entre 2017 et 2018 (+ 2,1 %).
On dispose ainsi des montants de prestations sur l’ensemble de l’année et non en fin d’année (comme c'était le cas dans Filosofi jusqu'en 2017).
Les données bancaires incluent a priori les étudiants personne de référence de leur logement par exemple, ou les personnes vivant en communauté, ce qui n’est pas le cas des données sur les niveaux de vie exploitées dans cette vue d’ensemble. De plus, elles n’incluent pas les personnes vivant en Corse.
Ces chiffres sont corrigés des effets de jours ouvrables. Ils ont été établis au 30 avril 2021 (première estimation des comptes trimestriels du T1 2021) et seront révisés le 28 mai 2021.
Si cet indicateur a des évolutions relativement proches de celles du niveau de vie moyen sur le passé, des différences conceptuelles existent (voir partie Sources et méthodes de l’ouvrage), conduisant à des évolutions parfois divergentes. La différence d’évolution annuelle entre les deux séries est en moyenne nulle entre 1997 et 2018 et de 0,6 point en valeur absolue. En 2018, la hausse du pouvoir d’achat était par exemple de 0,7 %, contre une hausse de 1,2 % du niveau de vie moyen des ménages.
Et non deux ans avant comme d’autres prestations telles que les allocations logement ou l’allocation adulte handicapé (AAH).
Données du Cnous (Centre national des œuvres universitaires et scolaires), mises à disposition par la Drees.
Les virements supérieurs à 40 000 euros ont été écartés, soit 0,13 % des observations, car ils correspondent plus vraisemblablement à un transfert entre comptes qu’à un revenu [Bonnet et al., 2021]. Les virements entre comptes d’un même ménage au sein du Crédit Mutuel Alliance Fédérale sont également exclus.
Ces différences sont liées au champ des personnes étudiées (les données bancaires incluent a priori les étudiants vivant avec leurs parents par exemple, ou les personnes vivant en communauté, ce qui n’est pas le cas des données sur les niveaux de vie exploitées dans cette vue d’ensemble), au fait que ces données bancaires intègrent une part des transferts entre ménages (ou avec d’autres comptes secondaires dans d’autres banques), ne sont pas complètement représentatives de la population française [Bonnet et al., 2021], et que les prélèvements fiscaux non prélevés à la source ne sont pas soustraits à ces revenus. De plus, le fait que les revenus ne sont pas rapportés aux unités de consommation conduit à ordonner les personnes différemment de ce qui est fait dans le reste de l’article : en particulier les personnes seules sont plus souvent classées en bas de la distribution qu’en haut.
Probablement liée aux mesures sanitaires entrées en vigueur le 5 octobre.
Voir annexe pour Camme. Epicov : Enquête Épidémiologie et conditions de vie, mise en place par la Drees, l’Inserm, Santé Publique France et l’Insee.
On obtient par exemple un taux de pauvreté de 83 % dans les cités universitaires et les établissements de soins et de 56 % dans les foyers de jeunes travailleurs.
Les résultats suivants sont issus de l’enquête Revenus fiscaux et sociaux. D’autres sources, détaillées en annexe, sont également mobilisées dans cette vue d’ensemble.
Seule la source Filosofi permet de mesurer les inégalités tout en haut de la distribution. Ici, les résultats donnés sur les 1 % ou 0,1 % les plus aisés sont issus de cette source et les données sur les déciles, l’indice de Gini et le ratio (100‑S80/S20) sont issues de l’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS).
Les séries présentées ici commencent en 1996, date à partir de laquelle les données sont complètes et harmonisées. Blasco et Picard (2018) mesurent les inégalités depuis 1975 sur un champ constant (mais partiel, hors revenus financiers non fiscalisés et allocation adulte handicapé) et obtiennent les mêmes résultats (voir fiche 1.9) : le point bas des inégalités aurait été en 2004 selon le rapport interdécile et en 1997‑1998 selon le rapport interquintile et l’indice de Gini. D’après Bozio et al. (2020), le point bas des inégalités mesurées par le ratio entre les 10 % les plus aisés et les 50 % les plus pauvres aurait été atteint en 2014, et le point bas de la part des 10 % les plus aisés aurait été atteint au début des années 1980. D’après toutes les analyses, les inégalités ont fortement diminué dans les années 1970, notamment avec le développement de la protection sociale qui a fait augmenter le niveau de vie des plus modestes plus fortement que celui du reste de la population.
En effet, en 2013, l’imposition des dividendes était passée d’un taux forfaitaire à une imposition au barème et une forte baisse des dividendes avait été observée, alors que la réforme inverse de 2018 mettant en place le prélèvement forfaitaire unique (PFU) a entrainé une forte hausse des dividendes. D’après Bach et al. (2019), les dividendes ont pu être mis en réserve dans les entreprises entre 2013 et 2017 en attendant une fiscalité plus favorable.
Ces individus sont définis en fonction de leur niveau de vie avant redistribution.
Le niveau de vie avant redistribution moyen des 10 % les plus modestes diminue quant à lui de 22,0 % entre 2008 et 2018.
Les données de la source Filosofi ne sont à méthodologie constante que depuis 2013. Les données précédemment citées pour les 10 % les plus aisés sont quant à elles calculées à partir de l’ERFS, à méthodologie constante depuis 1996.
Cette hausse a été initiée dans les années 1980 selon Bozio et al. (2020).
La baisse des inégalités après redistribution depuis 1900 serait liée pour les trois quarts à la baisse des inégalités avant redistribution selon Bozio et al. [2020]. Cela s’expliquerait notamment par la mise en place (et l’augmentation) du salaire minimum et de la protection sociale.
Si les comparaisons internationales varient beaucoup selon la définition du niveau de vie avant redistribution prise en compte (notamment selon l’intégration ou non des retraites et des cotisations sociales), elles convergent globalement vers le fait que la France serait dans une situation intermédiaire ou légèrement moins inégalitaire que les autres pays avant redistribution.
Le taux est de 8,7 % pour les personnes de plus de 75 ans. Mais ce chiffre n’est pas directement comparable aux taux de pauvreté aux âges moins avancés car au delà de 75 ans, une proportion non négligeable vit en Ehpad, ménages qui ne sont pas pris en compte ici.
Hors établissements pour personnes en grande difficulté sociale, dont le chiffrage est donné conjointement avec les sans‑abri, ci-après.
Les sans domicile hébergés dans un logement par une association ou vivant dans un hôtel sont susceptibles d’être interrogés dans les enquêtes ménages. Ils sont donc a priori compris dans les 9,3 millions de personnes vivant en logement ordinaire en situation de pauvreté.
Ce chiffrage est effectué avec le seuil de pauvreté classique (en ménage ordinaire). Il surestime donc légèrement le nombre de personnes pauvres. En effet, en prenant en compte les personnes vivant en communauté, qui ont en majorité des revenus plus faibles que la population totale, le niveau de vie médian serait plus bas, entraînant une baisse du seuil de pauvreté. Ce chiffre inclut aussi une partie des communautés qui sont dans les DOM.
Soit le seuil de 1 010 euros mesuré avec l’enquête Budget de famille en 2017, auquel on applique l’augmentation du niveau de vie médian entre 2017 et 2018 (+ 2,1 %).
On dispose ainsi des montants de prestations sur l’ensemble de l’année et non en fin d’année (comme c'était le cas dans Filosofi jusqu'en 2017).
Les données bancaires incluent a priori les étudiants personne de référence de leur logement par exemple, ou les personnes vivant en communauté, ce qui n’est pas le cas des données sur les niveaux de vie exploitées dans cette vue d’ensemble. De plus, elles n’incluent pas les personnes vivant en Corse.
Ces chiffres sont corrigés des effets de jours ouvrables. Ils ont été établis au 30 avril 2021 (première estimation des comptes trimestriels du T1 2021) et seront révisés le 28 mai 2021.
Si cet indicateur a des évolutions relativement proches de celles du niveau de vie moyen sur le passé, des différences conceptuelles existent (voir partie Sources et méthodes de l’ouvrage), conduisant à des évolutions parfois divergentes. La différence d’évolution annuelle entre les deux séries est en moyenne nulle entre 1997 et 2018 et de 0,6 point en valeur absolue. En 2018, la hausse du pouvoir d’achat était par exemple de 0,7 %, contre une hausse de 1,2 % du niveau de vie moyen des ménages.
Et non deux ans avant comme d’autres prestations telles que les allocations logement ou l’allocation adulte handicapé (AAH).
Données du Cnous (Centre national des œuvres universitaires et scolaires), mises à disposition par la Drees.
Les virements supérieurs à 40 000 euros ont été écartés, soit 0,13 % des observations, car ils correspondent plus vraisemblablement à un transfert entre comptes qu’à un revenu [Bonnet et al., 2021]. Les virements entre comptes d’un même ménage au sein du Crédit Mutuel Alliance Fédérale sont également exclus.
Ces différences sont liées au champ des personnes étudiées (les données bancaires incluent a priori les étudiants vivant avec leurs parents par exemple, ou les personnes vivant en communauté, ce qui n’est pas le cas des données sur les niveaux de vie exploitées dans cette vue d’ensemble), au fait que ces données bancaires intègrent une part des transferts entre ménages (ou avec d’autres comptes secondaires dans d’autres banques), ne sont pas complètement représentatives de la population française [Bonnet et al., 2021], et que les prélèvements fiscaux non prélevés à la source ne sont pas soustraits à ces revenus. De plus, le fait que les revenus ne sont pas rapportés aux unités de consommation conduit à ordonner les personnes différemment de ce qui est fait dans le reste de l’article : en particulier les personnes seules sont plus souvent classées en bas de la distribution qu’en haut.
Probablement liée aux mesures sanitaires entrées en vigueur le 5 octobre.
Voir annexe pour Camme. Epicov : Enquête Épidémiologie et conditions de vie, mise en place par la Drees, l’Inserm, Santé Publique France et l’Insee.
On obtient par exemple un taux de pauvreté de 83 % dans les cités universitaires et les établissements de soins et de 56 % dans les foyers de jeunes travailleurs.