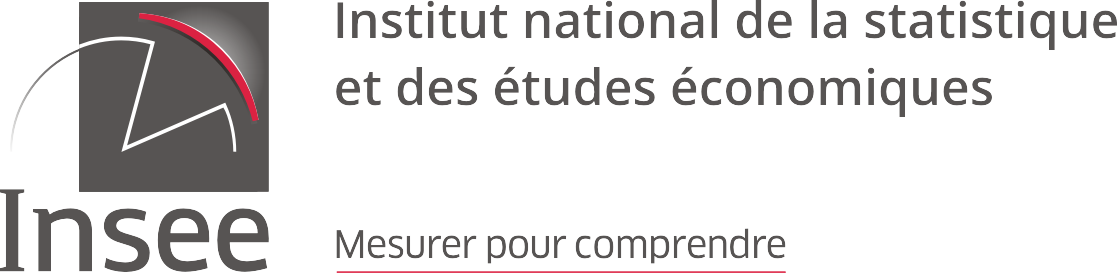La vie en communauté : 1,6 million de personnes en France
La vie en communauté : 1,6 million de personnes en France
En 2009, en France, 1,6 million de personnes, soit 1 habitant sur 40, vit au sein d’une communauté contre 1 sur 31 en 1990 (y compris militaires du contingent à l’époque). Les communautés sont de types très variés : maisons de retraites, cités universitaires, internats, foyers de travailleurs, prisons, communautés religieuses… Un tiers de la population des communautés est composée de jeunes de 15 à 24 ans, majoritairement des hommes, et un tiers de personnes âgées d’au moins 75 ans, dont les trois quarts sont des femmes. Les plus jeunes en communauté sont relativement moins nombreux en 2009 qu’en 1990 et les plus âgés le sont davantage. Les principales structures d’accueil restent les maisons de retraite (30 % de la vie en communauté) et les internats (26 %).
- En 2009, un habitant sur 40 vit dans une communauté
- Beaucoup de jeunes hommes et de femmes âgées
- Trois personnes sur dix en communauté vivent en maison de retraite
- Moins de jeunes en internat qu’il y a vingt ans
- 96 % des détenus sont des hommes
- Plus de maisons de retraite et d’internats dans le Limousin, plus de couvents en Bretagne
- En vingt ans, la population vivant en communauté a diminué
En 2009, un habitant sur 40 vit dans une communauté
En France, en 2009, 1 620 300 personnes vivent au sein d’une communauté, soit 1 habitant sur 40. Au sens du recensement de la population (sources), une communauté est un ensemble de locaux d’habitation gérés par un même organisme et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun comme la prise de repas. Que ce soit par choix ou par nécessité, à titre provisoire ou durable, ce type d’hébergement répond à des situations très variées et la population concernée est donc très hétérogène (graphique 1). Elle comprend en premier lieu les personnes âgées vivant en maison de retraite (488 600 personnes), les élèves et étudiants hébergés en internat (427 100) ou en cité universitaire (93 700) et les personnes hébergées dans un autre établissement sanitaire ou social de moyen ou long séjour (304 800). S’ajoutent 306 100 personnes vivant dans des communautés de types très divers : foyers de travailleurs, casernes, prisons, couvents… Depuis vingt ans, la population vivant dans les communautés a diminué, contrairement à l’ensemble de la population résidant en France (encadré).
graphiqueGraphique 1 – Répartition des personnes vivant en communauté en France en 2009

- Source : Insee, recensement de la population 2009.
Beaucoup de jeunes hommes et de femmes âgées
Si chacun peut être amené à séjourner en communauté au cours de sa vie, deux étapes sont particulièrement concernées : la post-adolescence et la vieillesse. Au fil des âges, la proportion de personnes vivant en communauté grimpe en effet à 9 % entre 15 et 19 ans et 4 % entre 20 et 24 ans, contre 2,5 % en moyenne tous âges confondus. Ne dépassant pas 2 % entre 25 ans et 74 ans, elle remonte ensuite progressivement, dépassant 7 % à partir de 80 ans et culminant à 52 % pour les centenaires. Les courbes diffèrent selon le sexe : les jeunes femmes sont un peu moins souvent en internat, mais les femmes âgées sont beaucoup plus souvent en maison de retraite, d’autant plus qu’elles avancent en âge. Vivant plus longtemps que les hommes, elles se retrouvent en effet plus souvent sans conjoint ou compagnon à ces âges. Par ailleurs, dans un couple, l’homme est souvent plus âgé que la femme. En 2009, parmi les 17 000 personnes de 100 ans ou plus vivant en France, 8 800 habitent dans une communauté. Les femmes représentent 85 % des centenaires et 91 % des centenaires en communauté. Ainsi, la pyramide des âges de la population vivant en communauté est très spécifique, avec un tiers de jeunes de 15 à 24 ans, majoritairement de jeunes hommes, et un tiers de personnes âgées d’au moins 75 ans, dont les trois quarts sont des femmes (graphique 2).
En moyenne, la population est plus âgée dans les communautés que dans l’ensemble du pays (49 ans contre 40 ans), avec un écart encore plus marqué pour les femmes (59 ans contre 41 ans). La population globale des communautés est aussi un peu plus masculine et moins diplômée, mais avec de fortes disparités selon les types d’institution (tableau 1). Notamment, les femmes sont très majoritaires dans les maisons de retraite et les communautés religieuses. Les membres des communautés religieuses sont par ailleurs plus diplômés en moyenne que l’ensemble de la population. Enfin, 1 personne sur 10 est étrangère en communauté, contre 1 sur 17 dans l’ensemble de la population.
graphiqueGraphique 2 – Pyramides des âges de la population vivant en communauté en 1990 et 2009

- Source : Insee, recensements de la population 1990 et 2009.
tableauTableau 1 – Caractéristiques de la population vivant en communauté en France
| Nombre de résidents | Âge moyen (ans) | Âge médian (ans) | Nombre de femmes | Part des femmes ( %) | Nombre d'étrangers | Part des étrangers ( %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison de retraite, hospice | 488 623 | 84 | 86 | 363 668 | 74 | 9 972 | 2 |
| Internat, hors cité universitaire | 427 064 | 18 | 17 | 171 142 | 40 | 15 911 | 4 |
| Autre établissement sanitaire ou social de moyen et long séjour | 304 756 | 50 | 49 | 153 279 | 50 | 23 119 | 8 |
| Foyer de travailleurs | 137 389 | 45 | 46 | 20 747 | 15 | 66 106 | 48 |
| Cité universitaire | 93 746 | 22 | 21 | 44 559 | 48 | 25 283 | 27 |
| Établissement militaire | 61 668 | 26 | 24 | 7 169 | 12 | 2 909 | 5 |
| Établissement pénitentiaire | 61 545 | 34 | 31 | 2 164 | 4 | 10 651 | 17 |
| Communauté religieuse | 36 979 | 66 | 71 | 27 204 | 74 | 5 544 | 15 |
| Établissement social de court séjour | 7 363 | 37 | 37 | 1 519 | 21 | 2 191 | 30 |
| Autre forme de communauté | 1 201 | 33 | 31 | 169 | 14 | 880 | 73 |
| Ensemble des communautés | 1 620 334 | 49 | 41 | 791 620 | 49 | 162 566 | 10 |
| Ensemble de la population | 64 304 500 | 40 | 39 | 33 179 616 | 52 | 3 771 141 | 6 |
- Source : Insee, recensement de la population 2009
Trois personnes sur dix en communauté vivent en maison de retraite
Les maisons de retraite sont les premières structures en termes d’accueil : 30 % de la population en communauté y vit, soit 488 600 personnes. L’âge moyen y est de 84 ans contre 80 ans en 1990. À cette date, 360 000 personnes résidaient dans une maison de retraite (elles représentaient alors 21 % de la population en communauté). Ce mode d’hébergement se développe, du fait du vieillissement de la population.
À partir de 50 ans, on commence à trouver les premiers pensionnaires en maison de retraite. Leur nombre augmente avec l’âge jusqu’à atteindre, à 87 ans, un maximum de 29 400 personnes, puis il diminue du fait de la mortalité. En proportion, toutefois, l’hébergement en maison de retraite augmente constamment avec l’avancée en âge : 14 % à 87 ans ; 26 % à 92 ans ; 29 % à 97 ans.
Ces dernières années, le maintien à domicile est devenu beaucoup plus systématique jusqu’à l’âge de 85 ans. À partir de 90 ans, au contraire, le placement en institution s’est fortement développé. À ces âges, l’entrée en maison de retraite fait souvent suite à une dégradation significative de l’état de santé et aux difficultés qui l’accompagnent, ne serait-ce que pour réaliser de simples gestes de la vie courante. Cela se conjugue également au fait que les enfants accueillent moins souvent leurs parents à leur domicile qu’auparavant.
Le profil professionnel passé des personnes en maison de retraite est sensiblement le même que celui de l’ensemble des retraités. Deux exceptions toutefois : tout d’abord, les anciens agriculteurs exploitants sont proportionnellement plus nombreux à vivre en maison de retraite, représentant 10 % des résidents de ces institutions contre 7 % des personnes âgées de 60 ans ou plus ; à l’inverse, les anciens cadres sont moins représentés en maison de retraite (3 %) que dans la population totale des seniors (7 %).
Avec 304 800 personnes, les autres établissements sanitaires ou sociaux de moyen ou long séjour constituent la troisième catégorie de communauté en termes d’importance de la population hébergée (après les internats). Ainsi, avec les maisons de retraite, les établissements de la sphère sanitaire et sociale rassemblent la moitié des personnes vivant en communauté.
Moins de jeunes en internat qu’il y a vingt ans
Les internats des établissements scolaires accueillent 427 100 élèves, soit le quart de la population vivant en communauté. Les garçons y sont plus nombreux que les filles. L’âge moyen des internes est de 18 ans. Parmi ceux dont l’adresse des parents est connue, la moitié étudie dans le même département que celui où résident leurs parents et huit sur dix dans la même région.
En vingt ans, le nombre d’internes a baissé de 125 000 élèves ; ils étaient plus de 550 000 en 1990. Cette baisse est à mettre en parallèle avec le déplacement des familles vers les grands centres urbains, se rapprochant ainsi des équipements scolaires. Plus des trois quarts de la population vit désormais dans une aire urbaine, espace composé d’un pôle urbain d’au moins 10 000 emplois et de sa couronne. Enfin, avec la réduction de la semaine de cours dans les établissements scolaires et l’assouplissement des conditions d’accueil en internat, certains établissements hébergent les élèves moins de quatre nuits par semaine. Ces établissements disparaissent ainsi du champ des communautés.
Les cités universitaires comptent 93 700 étudiants, chiffre en recul là aussi par rapport à 1990. Nombre d’étudiants prennent en effet des chambres en ville ou se logent dans des résidences universitaires, non comptabilisées en communautés. La moitié de ces étudiants a moins de 21 ans, ce sont en majorité des garçons (52 %) et plus d’un quart (27 %) sont des étrangers. Avec les internats et les cités universitaires, les hébergements de la sphère éducative rassemblent un tiers des personnes en communauté.
Les foyers de travailleurs abritent 137 400 personnes. À l’instar des cités universitaires, nombre de foyers de travailleurs se sont transformés en logements indépendants, perdant ainsi leur caractère de communauté et expliquant la baisse de cette population. Dans les foyers de travailleurs, les hommes représentent 85 % des individus hébergés ; ils ont en moyenne 45 ans et sont de nationalité étrangère pour près de la moitié d’entre eux. Parmi ces derniers, neuf sur dix sont originaires d’Algérie, du Mali ou du Maroc.
96 % des détenus sont des hommes
Parmi les personnes vivant en communauté, on recense aussi celles vivant en établissement pénitentiaire, soit 61 500 détenus en 2009 (carte 1). Il s’agit essentiellement d’une population masculine (à 96 %), jeune (la moitié a moins de 31 ans) et peu ou pas diplômée. Les étrangers sont plus nombreux dans ces structures : 17 % des prisonniers sont de nationalité étrangère contre 6 % de la population habitant en France.
61 700 personnes résident dans des établissements militaires (casernes, quartiers, bases, camps militaires ou assimilés). Ce décompte ne comprend pas les personnes (militaires et leur famille notamment) occupant des logements de fonction situés dans l’enceinte des casernes ou camps.
Les communautés religieuses, couvents et autres monastères − formes les plus anciennes de vie en communauté avec les casernements − accueillent 37 000 personnes. Leur population est plutôt âgée, avec une moyenne de 66 ans. Les femmes y sont majoritaires (74 %). On compte une assez forte proportion de diplômés, puisque 61 % possèdent un diplôme équivalent ou supérieur au baccalauréat, 42 % ayant même un diplôme universitaire au moins égal à celui du premier cycle.
Au niveau régional, le profil des communautés traduit, en grande partie, l’histoire des territoires et les caractéristiques sociales de leurs habitants.
graphiqueCarte 1 – Les établissements pénitentiaires en 2009

- Source : Insee - recensement de la population 2009 ; © IGN - Insee 2013.
Plus de maisons de retraite et d’internats dans le Limousin, plus de couvents en Bretagne
Les trois grandes agglomérations que sont Paris, Lyon, et Marseille, ainsi que la façade atlantique, accueillent à elles seules plus de la moitié des personnes vivant en communauté. Mais rapportées à la population régionale, les communautés sont particulièrement importantes dans le centre de la France, comprenant les régions Limousin, Auvergne et Bourgogne, ainsi que dans l’Ouest, avec la Basse-Normandie et Poitou-Charentes. Dans ces régions, plus de 1 habitant sur 30 vit en communauté, alors que cette proportion est de 1 sur 40, voire 1 sur 50, dans les autres régions (carte 2). Cette situation s’explique largement par l’importance de la population âgée dans les cinq régions, qui comptent toutes de 3 % à 4 % de personnes âgées de 75 ans ou plus.
La population des foyers de travailleurs est très présente en Île-de-France, Provence - Alpes - Côte d’Azur, Alsace et Lorraine. À l’opposé, les foyers de travailleurs migrants sont très peu nombreux en Bretagne et en Poitou-Charentes. La Bretagne, longtemps terre de pratique religieuse, compte la plus forte présence de communautés religieuses à l’opposé du Limousin, connu pour son caractère areligieux. Les établissements militaires se trouvent dans l’Est (Lorraine notamment) et beaucoup moins dans les régions normandes. Les internats sont plus présents dans les régions rurales du Limousin, de Poitou-Charentes et de Franche-Comté. À l’opposé, plus rares sont les Franciliens qui y vivent. Enfin, l’importance relative de la population carcérale est faible en Franche-Comté et plus forte en Nord - Pas-de-Calais.
graphiqueCarte 2 – La population vivant en communauté dans les régions en 2009

- Source : Insee - recensement de population 2009 ; © IGN - Insee 2013.
tableau – Tableau 2 - De la population recensée en communauté à la population vivant en communauté
| Catégories de population | Nombre de personnes concernées | Dans les résultats du recensement | Dans cette étude |
|---|---|---|---|
| Personnes habitant dans des ménages ordinaires | 62 554 107 | 62 818 715 comptabilisées en ménages « ordinaires » | 62 554 107 |
| Mineurs recensés en communauté mais ayant une résidence familiale | 264 608 | 1 620 334 recensées dans une communauté | |
| Autres résidents des communautés | 1 355 726 | 1 355 726 | |
| Habitations mobiles, mariniers, sans abri | 130 059 | 130 059 | 130 059 |
| Ensemble de la population vivant en France | 64 304 500 | 64 304 500 | 64 304 500 |
- Source : Insee, recensement de la population 2009.
En vingt ans, la population vivant en communauté a diminué
En 2009, 1 620 300 personnes vivent en communauté. En 1990, cette même population s’élevait à 1 897 400 personnes, mais ce nombre incluait à l’époque les militaires du contingent. Hors ces derniers, on recensait alors 1 645 600 personnes (en intégrant les internes alors comptabilisés chez leurs parents). Cette légère baisse depuis vingt ans (− 1 %) contraste avec l’accroissement global de la population (+ 13 %). Elle s’explique, entre autres, par la mise en œuvre de politiques sociales favorisant le maintien à domicile, notamment des plus âgés, par un rapprochement du lieu de domicile et du lieu d’études, ainsi que par des évolutions dans le mode de fonctionnement de certaines structures. Par exemple, des chambres en cité universitaire sont devenues des logements à part entière qui sortent du champ des communautés pour rejoindre celui des logements ordinaires. Par ailleurs, les foyers logements, qui n'appartiennent pas aux communautés, proposent une alternative au placement en maison de retraite.
À noter que depuis 2004, suite au changement de méthode de recensement, les élèves majeurs vivant en internat ainsi que les militaires vivant en caserne sans leur famille font partie de la population des communautés. Ils ne sont plus rattachés au ménage de leur famille et ne font donc plus partie de la population des ménages « ordinaires », comme lors des précédents recensements de la population.
Sources
Le recensement de la population permet de dénombrer l’ensemble de la population vivant en France. Les habitants sont répartis selon leur catégorie d’habitation ou leur mode de vie en trois catégories : les personnes qui vivent en logement « ordinaire » (97,3 % de la population en 2009), celles qui vivent en communauté, auxquelles s’intéresse cette étude (2,5 %) et les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers et les personnes sans abri (0,2 %).
La population vivant en communauté est recensée de manière exhaustive tous les cinq ans, à raison d’un cinquième par an. Pour cela, l’Insee gère un répertoire des communautés. En 2009, on compte environ 30 000 communautés en France. Les logements de fonction situés dans l’enceinte des communautés et les logements occupés par plusieurs personnes en colocation sont comptabilisés dans les ménages « ordinaires ».
Le choix a été fait de conserver les mineurs en communauté tout au long de cette étude. Ceci explique les différences avec les chiffres publiés sur insee.fr, où les mineurs sont réintégrés dans la population des ménages « ordinaires » (tableau 2).
Définitions
Une communauté est définie comme un ensemble de locaux d’habitation, relevant d’une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie en commun. Les différentes catégories de communautés sont définies par le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population.
Pour en savoir plus
Les personnes âgées, Insee Références, Édition 2005.
N. Blanpain, « 15 000 centenaires en 2010 en France, 200 000 en 2060 ? », Insee Première n° 1319, octobre 2010.
J. Perrin-Haynes, J. Chazal Ouvrir dans un nouvel onglet« L’hébergement offert en établissements pour personnes âgées », Dossier Solidarité et Santé n° 29, juin 2012.