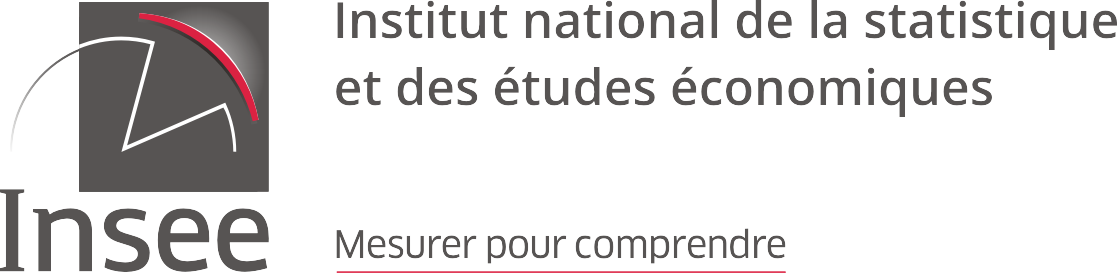Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes ·
Janvier 2022 · n° 137
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes ·
Janvier 2022 · n° 137 Vallée de l’Arve : une zone d’emploi industrielle atypique au cœur des Alpes, de plus
en plus ouverte sur l’extérieur
Vallée de l’Arve : une zone d’emploi industrielle atypique au cœur des Alpes, de plus
en plus ouverte sur l’extérieur
La Vallée de l’Arve est une zone d’emploi de montagne dense, centrée sur les activités industrielles et plus particulièrement sur le décolletage. Elle connaît une croissance démographique rapide soutenue par une population jeune et en activité. Après avoir connu des difficultés économiques dans les années 2000, l’économie locale a retrouvé le chemin de l’emploi dans la deuxième moitié de la décennie 2010, malgré des pertes d’emploi structurelles dans l’industrie. Le développement des activités de services, et notamment des activités touristiques, compense les difficultés de l’industrie. Dans le même temps, le territoire accroît ses échanges avec les zones d’emploi voisines, entraînant une intensification des déplacements.
- Une croissance démographique rapide pour un territoire industriel
- Une population jeune et en activité
- Un rebond de l’emploi après une décennie de restructuration économique
- Plus d’un tiers des emplois consacrés à l’industrie
- Des échanges croissants avec les zones d’emploi voisines
- Une intensification des déplacements
Située entre le massif du Mont-Blanc et le Genevois Français, la zone d’emploi de la Vallée de l’Arve est un bassin d’emploi industriel de 90 000 habitants et de 38 000 emplois. Composée de 28 communes dont la plus peuplée est Cluses (18 000 habitants), elle est partagée entre communes urbaines de fond de vallée et communes de montagne. 24 communes sur 28 sont classées en zone de montagne et l’altitude de la zone varie entre 428 m (Bonneville) et 3 098 m (Sixt-Fer-à-Cheval). Cette mixité géographique lui donne un caractère atypique : dans cet espace au relief exigeant se côtoient une dense activité industrielle et des activités touristiques liées notamment aux sports d’hiver. Comparable à celle de France métropolitaine, la densité moyenne de la zone (117 habitants par km²) est élevée pour un espace de haute montagne. Elle dépasse les 1 000 habitants par km² dans les communes du pôle de l’aire d’attraction des villes de Cluses et atteint jusqu’à 1 600 habitants au km² à Cluses même, une densité relativement élevée pour un pôle de cette taille.
graphiqueFigure 1 – Relief de la zone d’emploi de la Vallée de l’Arve

- Absence des données : carte topographique
- source : IGN.
Une croissance démographique rapide pour un territoire industriel
La Vallée de l’Arve enregistre une croissance démographique rapide, atypique pour un territoire industriel. Entre 2013 et 2018, la population a augmenté de 0,5 % par an, un rythme supérieur à la moyenne de France métropolitaine (0,4 % par an), alors qu’elle a stagné dans le territoire de référence constitué de l’ensemble des zones d’emploi spécialisées dans l’industrie. Cette dynamique s’inscrit dans le contexte plus large de la croissance démographique rapide du département de la Haute-Savoie (+ 1,2 % par an entre 2013 et 2018). Au sein de la vallée, Cluses perd cependant des habitants (– 600 en cinq ans), principalement au profit des communes alentour (phénomène de périurbanisation).
Le solde migratoire de la ville est fortement déficitaire (– 1 300 habitants), que ne compense pas l’excédent naturel important (+ 700). Bonneville connaît, dans une moindre mesure, le même type d’évolution (- 100 habitants en 5 ans) avec un excédent naturel (+ 500) qui ne compense pas tout à fait le déficit migratoire (– 600).
Dans l’ensemble de la Vallée de l’Arve, c’est l’excédent des naissances sur les décès qui explique, sur la période récente, la totalité de la croissance démographique. Ce solde naturel excédentaire est étroitement lié à la jeunesse de la population et notamment à la surreprésentation des personnes âgées de 30 à 44 ans (figure 2). Ces dernières représentent 21 % de la population de la Vallée de l’Arve, contre 17 % dans le référentiel et 19 % en France métropolitaine. À l’inverse, même s’il est compensé par le solde naturel, le solde des arrivées-départs est déficitaire sur la période. Ce déséquilibre est récent dans l’histoire démographique de la zone d’emploi. Depuis le début des années 1960, la croissance démographique de la zone s’appuyait sur les deux soldes, naturel et migratoire. Dans le courant des années 2000, l’attractivité de la zone a décru et les départs du territoire l’ont emporté sur les arrivées (figure 3). Ce renversement, qui occasionne un ralentissement de croissance démographique, résulte de deux phénomènes. D’une part, les pertes d’emploi subies au milieu des années 2000 ont engendré des départs de population « en âge d’être actif ». D’autre part, le vieillissement de la population s’est renforcé : la part des 65 ans et plus est ainsi passée de 12 % à 16 % entre 2008 et 2018. Les retraités sont pourtant nombreux à quitter le territoire ; ce sont eux qui contribuent le plus à son déficit migratoire. Ainsi, en 2018, 570 retraités qui vivaient dans la Vallée de l’Arve un an auparavant l’ont quitté et seulement 200 sont venus s’y installer.
tableauFigure 2 – Pyramide des âges
| Âge | Femmes - Vallée de l’Arve | Hommes - Vallée de l’Arve | Femmes - Zones d’emplois industrielles de France métropolitaine | Hommes - Zones d’emplois industrielles de France métropolitaine | Femmes - France métropolitaine | Hommes - France métropolitaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,517 | 0,626 | 0,458 | 0,487 | 0,516 | 0,542 |
| 1 | 0,583 | 0,614 | 0,491 | 0,508 | 0,530 | 0,550 |
| 2 | 0,591 | 0,651 | 0,514 | 0,530 | 0,547 | 0,570 |
| 3 | 0,557 | 0,628 | 0,531 | 0,560 | 0,562 | 0,588 |
| 4 | 0,613 | 0,660 | 0,558 | 0,588 | 0,577 | 0,600 |
| 5 | 0,646 | 0,698 | 0,578 | 0,609 | 0,591 | 0,613 |
| 6 | 0,648 | 0,725 | 0,599 | 0,626 | 0,595 | 0,623 |
| 7 | 0,642 | 0,637 | 0,600 | 0,642 | 0,602 | 0,629 |
| 8 | 0,666 | 0,696 | 0,620 | 0,637 | 0,602 | 0,631 |
| 9 | 0,683 | 0,681 | 0,632 | 0,663 | 0,607 | 0,637 |
| 10 | 0,680 | 0,746 | 0,631 | 0,671 | 0,606 | 0,635 |
| 11 | 0,614 | 0,684 | 0,633 | 0,662 | 0,604 | 0,633 |
| 12 | 0,640 | 0,719 | 0,635 | 0,662 | 0,601 | 0,627 |
| 13 | 0,636 | 0,722 | 0,630 | 0,674 | 0,598 | 0,626 |
| 14 | 0,667 | 0,697 | 0,644 | 0,666 | 0,599 | 0,627 |
| 15 | 0,708 | 0,663 | 0,632 | 0,666 | 0,602 | 0,633 |
| 16 | 0,651 | 0,654 | 0,630 | 0,668 | 0,602 | 0,637 |
| 17 | 0,618 | 0,649 | 0,615 | 0,656 | 0,602 | 0,637 |
| 18 | 0,412 | 0,486 | 0,431 | 0,524 | 0,599 | 0,637 |
| 19 | 0,319 | 0,558 | 0,378 | 0,470 | 0,581 | 0,614 |
| 20 | 0,383 | 0,458 | 0,363 | 0,440 | 0,562 | 0,594 |
| 21 | 0,380 | 0,529 | 0,360 | 0,445 | 0,552 | 0,573 |
| 22 | 0,444 | 0,532 | 0,377 | 0,430 | 0,548 | 0,559 |
| 23 | 0,504 | 0,494 | 0,393 | 0,432 | 0,545 | 0,557 |
| 24 | 0,531 | 0,665 | 0,406 | 0,445 | 0,552 | 0,554 |
| 25 | 0,542 | 0,564 | 0,425 | 0,442 | 0,556 | 0,554 |
| 26 | 0,600 | 0,565 | 0,431 | 0,450 | 0,566 | 0,561 |
| 27 | 0,604 | 0,609 | 0,455 | 0,474 | 0,581 | 0,572 |
| 28 | 0,624 | 0,650 | 0,478 | 0,481 | 0,595 | 0,576 |
| 29 | 0,638 | 0,674 | 0,486 | 0,499 | 0,606 | 0,586 |
| 30 | 0,631 | 0,656 | 0,510 | 0,507 | 0,615 | 0,589 |
| 31 | 0,617 | 0,675 | 0,524 | 0,519 | 0,619 | 0,590 |
| 32 | 0,651 | 0,631 | 0,530 | 0,536 | 0,620 | 0,592 |
| 33 | 0,675 | 0,759 | 0,551 | 0,542 | 0,628 | 0,599 |
| 34 | 0,717 | 0,660 | 0,568 | 0,567 | 0,634 | 0,606 |
| 35 | 0,677 | 0,740 | 0,573 | 0,575 | 0,640 | 0,615 |
| 36 | 0,673 | 0,697 | 0,586 | 0,581 | 0,641 | 0,616 |
| 37 | 0,707 | 0,667 | 0,588 | 0,596 | 0,645 | 0,620 |
| 38 | 0,663 | 0,782 | 0,586 | 0,594 | 0,636 | 0,615 |
| 39 | 0,731 | 0,712 | 0,582 | 0,588 | 0,630 | 0,614 |
| 40 | 0,621 | 0,741 | 0,579 | 0,587 | 0,615 | 0,602 |
| 41 | 0,633 | 0,721 | 0,587 | 0,595 | 0,618 | 0,606 |
| 42 | 0,687 | 0,711 | 0,611 | 0,614 | 0,633 | 0,619 |
| 43 | 0,695 | 0,695 | 0,630 | 0,643 | 0,648 | 0,638 |
| 44 | 0,691 | 0,756 | 0,645 | 0,666 | 0,669 | 0,656 |
| 45 | 0,800 | 0,713 | 0,680 | 0,689 | 0,680 | 0,672 |
| 46 | 0,727 | 0,729 | 0,672 | 0,697 | 0,686 | 0,677 |
| 47 | 0,762 | 0,857 | 0,672 | 0,689 | 0,683 | 0,673 |
| 48 | 0,744 | 0,791 | 0,677 | 0,683 | 0,680 | 0,661 |
| 49 | 0,863 | 0,884 | 0,682 | 0,703 | 0,677 | 0,661 |
| 50 | 0,743 | 0,734 | 0,660 | 0,698 | 0,675 | 0,657 |
| 51 | 0,781 | 0,783 | 0,678 | 0,705 | 0,680 | 0,659 |
| 52 | 0,664 | 0,755 | 0,676 | 0,693 | 0,681 | 0,660 |
| 53 | 0,747 | 0,793 | 0,683 | 0,695 | 0,681 | 0,654 |
| 54 | 0,707 | 0,771 | 0,688 | 0,697 | 0,679 | 0,651 |
| 55 | 0,609 | 0,711 | 0,684 | 0,679 | 0,675 | 0,645 |
| 56 | 0,641 | 0,670 | 0,686 | 0,683 | 0,668 | 0,634 |
| 57 | 0,582 | 0,668 | 0,692 | 0,692 | 0,663 | 0,625 |
| 58 | 0,645 | 0,556 | 0,686 | 0,676 | 0,658 | 0,617 |
| 59 | 0,627 | 0,607 | 0,689 | 0,673 | 0,656 | 0,609 |
| 60 | 0,594 | 0,596 | 0,693 | 0,674 | 0,652 | 0,600 |
| 61 | 0,552 | 0,578 | 0,685 | 0,687 | 0,646 | 0,590 |
| 62 | 0,561 | 0,507 | 0,689 | 0,672 | 0,639 | 0,585 |
| 63 | 0,553 | 0,514 | 0,678 | 0,663 | 0,636 | 0,579 |
| 64 | 0,508 | 0,468 | 0,678 | 0,654 | 0,633 | 0,571 |
| 65 | 0,570 | 0,565 | 0,676 | 0,660 | 0,631 | 0,568 |
| 66 | 0,475 | 0,473 | 0,686 | 0,642 | 0,631 | 0,563 |
| 67 | 0,493 | 0,472 | 0,685 | 0,656 | 0,632 | 0,566 |
| 68 | 0,535 | 0,499 | 0,678 | 0,647 | 0,621 | 0,559 |
| 69 | 0,506 | 0,455 | 0,672 | 0,633 | 0,620 | 0,551 |
| 70 | 0,496 | 0,439 | 0,629 | 0,580 | 0,576 | 0,507 |
| 71 | 0,386 | 0,473 | 0,576 | 0,530 | 0,535 | 0,468 |
| 72 | 0,368 | 0,366 | 0,535 | 0,485 | 0,495 | 0,428 |
| 73 | 0,369 | 0,333 | 0,475 | 0,420 | 0,449 | 0,382 |
| 74 | 0,359 | 0,299 | 0,429 | 0,371 | 0,400 | 0,339 |
| 75 | 0,306 | 0,290 | 0,413 | 0,349 | 0,383 | 0,316 |
| 76 | 0,310 | 0,279 | 0,412 | 0,333 | 0,373 | 0,302 |
| 77 | 0,251 | 0,241 | 0,407 | 0,332 | 0,362 | 0,289 |
| 78 | 0,302 | 0,204 | 0,411 | 0,329 | 0,358 | 0,276 |
| 79 | 0,282 | 0,204 | 0,425 | 0,333 | 0,361 | 0,269 |
| 80 | 0,266 | 0,205 | 0,428 | 0,318 | 0,359 | 0,259 |
| 81 | 0,283 | 0,181 | 0,418 | 0,305 | 0,350 | 0,246 |
| 82 | 0,253 | 0,155 | 0,409 | 0,299 | 0,343 | 0,231 |
| 83 | 0,240 | 0,169 | 0,404 | 0,270 | 0,332 | 0,216 |
| 84 | 0,219 | 0,150 | 0,389 | 0,252 | 0,320 | 0,198 |
| 85 | 0,230 | 0,115 | 0,381 | 0,235 | 0,311 | 0,181 |
| 86 | 0,223 | 0,130 | 0,354 | 0,201 | 0,288 | 0,161 |
| 87 | 0,179 | 0,080 | 0,325 | 0,182 | 0,268 | 0,141 |
| 88 | 0,178 | 0,066 | 0,296 | 0,152 | 0,242 | 0,120 |
| 89 | 0,146 | 0,048 | 0,263 | 0,137 | 0,216 | 0,102 |
| 90 | 0,149 | 0,060 | 0,233 | 0,107 | 0,189 | 0,083 |
| 91 | 0,126 | 0,055 | 0,203 | 0,086 | 0,164 | 0,067 |
| 92 | 0,078 | 0,016 | 0,171 | 0,068 | 0,139 | 0,053 |
| 93 | 0,065 | 0,020 | 0,140 | 0,051 | 0,118 | 0,041 |
| 94 | 0,059 | 0,021 | 0,115 | 0,040 | 0,095 | 0,031 |
| 95 | 0,046 | 0,013 | 0,093 | 0,027 | 0,076 | 0,022 |
| 96 | 0,037 | 0,011 | 0,064 | 0,018 | 0,054 | 0,015 |
| 97 | 0,025 | 0,005 | 0,044 | 0,011 | 0,037 | 0,009 |
| 98 | 0,020 | 0,006 | 0,028 | 0,007 | 0,023 | 0,005 |
| 99 | 0,009 | 0,001 | 0,017 | 0,003 | 0,014 | 0,003 |
| 100 | 0,018 | 0,005 | 0,030 | 0,006 | 0,026 | 0,006 |
- Lecture : les hommes âgés de 2 ans représentent 0,6 % de la population de la Vallée de l’Arve, 0,5 % de celle du référentiel, et 0,6 % de celle de France métropolitaine.
- Source : Insee, Recensement de la population de 2018.
graphiqueFigure 2 – Pyramide des âges

- Lecture : les hommes âgés de 2 ans représentent 0,6 % de la population de la Vallée de l’Arve, 0,5 % de celle du référentiel, et 0,6 % de celle de France métropolitaine.
- Source : Insee, Recensement de la population de 2018.
tableauFigure 3 – Variation de population annuelle moyenne et contributions des soldes
| Vallée de l’Arve 2021 (ZE2020) | Variation de population annuelle moyenne (en %) | due au solde naturel (en %) | due au solde des arrivées-départs (en %) |
|---|---|---|---|
| 1962-1968 | 3,06 | 1,12 | 1,93 |
| 1968-1975 | 2,17 | 0,90 | 1,26 |
| 1975-1982 | 1,40 | 0,85 | 0,55 |
| 1982-1990 | 1,63 | 0,87 | 0,75 |
| 1990-1999 | 1,24 | 0,86 | 0,38 |
| 1999-2008 | 1,23 | 0,83 | 0,40 |
| 2008-2013 | 0,69 | 0,79 | -0,10 |
| 2013-2018 | 0,50 | 0,64 | -0,14 |
- Lecture : entre 2013 et 2018, la population de la zone d’emploi de la Vallée de l’Arve a augmenté de 0,5 % en moyenne par an. Cette variation est liée à un léger déficit migratoire (– 0,1 %) que l’excédent naturel compense largement (+ 0,6 %).
- Source : Insee, Recensements de la population - État civil (base de données communales BDCOM 2021).
graphiqueFigure 3 – Variation de population annuelle moyenne et contributions des soldes

- Lecture : entre 2013 et 2018, la population de la zone d’emploi de la Vallée de l’Arve a augmenté de 0,5 % en moyenne par an. Cette variation est liée à un léger déficit migratoire (– 0,1 %) que l’excédent naturel compense largement (+ 0,6 %).
- Source : Insee, Recensements de la population - État civil (base de données communales BDCOM 2021).
Une population jeune et en activité
La Vallée de l’Arve est un territoire d’actifs, que de nombreuses personnes quittent à l’âge de la retraite. Du fait de cette émigration importante, les populations de seniors sont sous-représentées. Le solde migratoire des 60 ans ou plus est donc négatif. En conséquence, la population est majoritairement jeune et en activité. Le poids des populations « en âge d’être actif » (25-64 ans) est plus élevé qu’en moyenne de France métropolitaine (54 % contre 50 %). À l’inverse, comme dans tous les territoires ne comportant pas d’établissements d’enseignement universitaire, la part des jeunes âgés de 18 à 25 ans est nettement plus faible qu’au niveau national ; elle reste cependant proche de la moyenne constatée dans le territoire de référence.
Cette structure par âge, cumulée à un taux d’activité élevé des 20-64 ans (80,1 % contre 75,8 % dans le référentiel), amène les ménages de la Vallée de l’Arve à vivre majoritairement des revenus du travail. Les salaires et rémunérations du travail représentent plus des trois quarts du revenu disponible des ménages, contre 60 % dans le référentiel et 66 % en moyenne de France métropolitaine. Corrélativement, et malgré une surreprésentation des ouvriers (21 % contre 12 % en moyenne de France métropolitaine), le niveau de vie médian, situé à 24 150 euros par an, est supérieur de 2 420 euros à la moyenne de France métropolitaine et même de 4 300 euros à celui du territoire de comparaison. Le taux de pauvreté y est aussi nettement plus faible (9,8 % contre 14,6 % au niveau France métropolitaine et 12,5 % pour le référentiel). Les inégalités de revenus ne sont pas plus marquées qu’en moyenne métropolitaine, les niveaux de vie étant plus élevés que ce soit pour les 10 % des personnes les plus pauvres (13 200 euros contre 11 500 euros pour la France métropolitaine) ou pour les 10 % les plus riches (43 700 euros contre 39 500 euros).
En revanche, elles sont plus marquées que dans le territoire de comparaison avec, dans ce dernier, un premier décile un peu moins élevé mais un dernier décile beaucoup plus faible (35 410 euros).
Un rebond de l’emploi après une décennie de restructuration économique
En 2018, le taux de chômage au sens du BIT s’établit à 7,0 % dans la Vallée de l’Arve, un taux inférieur à celui de France métropolitaine (9,0 %), et à la médiane des zones d’emploi composant le référentiel (7,6 %). Entre 2013 et 2018, la croissance de l’emploi (+ 1,2 % par an) a été un peu plus rapide qu’en France métropolitaine (+ 0,6 %) et beaucoup plus rapide que dans le référentiel (+ 0,3 %).
Ce dynamisme de l’emploi sur la période récente intervient après une dizaine d’années de perturbations économiques, qui ont mis à mal la santé du marché du travail. Au milieu des années 2000, le secteur du décolletage, principal employeur de la zone, a subi les mutations technologiques de l’automobile, son principal débouché. Entre 1999 et 2008, l’appareil industriel de la zone a perdu un quart de ses emplois avant même que les conséquences de la crise financière de 2008 n’aggravent encore la situation au tournant des années 2010. Ces dernières ont été une période de restructuration économique pour la zone. L’industrie du décolletage a diversifié ses débouchés, vers l’aéronautique et le médical notamment, entamé un processus de concentration vers des unités de production de plus grande taille et ouvert ses marchés à l’international. Au final, la Vallée de l’Arve a retrouvé le chemin de la croissance de l’emploi en 2017 et 2018 (+ 1 000 emplois par an).
Plus d’un tiers des emplois consacrés à l’industrie
Avec 36 % de l’emploi consacré à l’industrie, la Vallée de l’Arve est l’une des zones d’emploi les plus industrielles de France (4ᵉ au niveau national et 2ᵉ de la région après la zone d’emploi d’Oyonnax). Comme ailleurs, la prépondérance de l’industrie s’effrite depuis un demi-siècle. En 1975, elle occupait plus d’un emploi sur deux (55 %). Entre 2008 et 2018, l’industrie a perdu 2 400 emplois soit une baisse de 1,9 % par an.
L’appareil productif est largement dominé par le secteur de la fabrication de produits métalliques, plus précisément par le décolletage. Cette activité historique de la vallée occupe deux emplois industriels sur trois et un emploi sur cinq. Elle est constituée d’un dense réseau de petites et moyennes entreprises, articulé autour de quelques grands établissements. De fait, une quinzaine de grands établissements de plus de 200 salariés côtoient près de 400 petits établissements. Sous l’effet des mutations du secteur, un mouvement de concentration de l’emploi dans les entreprises de taille intermédiaire s’est toutefois opéré entre 2008 et 2018. Celles-ci concentrent désormais 38,5 % des salariés, contre 25,8 % en 2008. La prépondérance des activités de décolletage dans l’économie locale a toutefois tendance à se réduire. Le secteur de la fabrication de produits métalliques a perdu 1 600 emplois sur la période. Autre secteur-clé de l’industrie locale, la fabrication d’équipements électriques a perdu la moitié de ses emplois en 10 ans (- 540 emplois). À un moindre niveau, la fabrication de produits en caoutchouc et plastique a subi une évolution analogue (– 180 emplois). Au final, seuls quelques secteurs de l’industrie ont gagné des emplois entre 2008 et 2018 : l’agroalimentaire, la chimie, la fabrication et distribution d’électricité et de gaz et la fabrication de machines et équipements. Toutefois, les faibles gains dans ces quatre industries (+ 230 emplois) ne compensent pas les lourdes pertes des deux principaux secteurs de la zone.
Avec une croissance démographique soutenue, le développement du secteur tertiaire contribue le plus largement à compenser les pertes d’emplois de l’industrie. Le secteur de l’hébergement-restauration occupe 2 600 postes, soit 7 % de l’emploi avec une progression de 31 % en 10 ans. Cette activité reflète le développement touristique de la zone, notamment de ses communes de montagne : Arraches-la-Frasse, Samoëns, Taninges et Morillon. Ces quatre communes concentrent 71 % de la capacité d’hébergement touristique. Par ailleurs, au regard du référentiel, la Vallée de l’Arve se caractérise par une forte surreprésentation des activités immobilières. Leur développement est favorisé par la croissance démographique du territoire qui s’accompagne de constructions (+ 1,2 % de croissance annuelle moyenne du nombre de logements entre 2013 et 2018, contre + 1,0 % en France métropolitaine et + 0,6 % dans le référentiel). 30 % du parc des logements sont des résidences secondaires.
Des échanges croissants avec les zones d’emploi voisines
Les navettes domicile-travail entre la Vallée de l’Arve et les zones d’emploi voisines s’intensifient. Depuis 2008, la part des actifs en emploi résidant dans la zone et travaillant en dehors augmente, passant de 24 % en 2008 à 29 % en 2013 et à 32 % en 2018. Ce taux est seulement de 22 % pour le référentiel. La proportion d’actifs qui travaillent en Suisse augmente également mais à un rythme moins soutenu. Globalement, la part d’actifs en emploi travaillant à l’étranger passe de 6,7 % en 2008 à 8,8 % en 2013 et à 9,9 % en 2018. Parmi les sortants, moins de 30 % travaillent en Suisse. Pour le reste, les principales communes de travail des actifs sortants sont Saint-Pierre-en-Faucigny, Sallanches, Annemasse, La Roche-sur-Foron, Contamine-sur-Arve et Annecy. Ces six communes accueillent plus du tiers des navetteurs sortants.
Sous l’effet de la densification de la zone, les actifs se tournent de plus en plus vers des emplois en dehors du territoire, vers des zones d’emploi (majoritairement vers celle du Genevois Français mais aussi vers celle du Mont Blanc ; figure 4) qui connaissent aussi les mêmes phénomènes de densification et de saturation urbaine.
tableauFigure 4 – Navettes domicile-travail entre la Vallée de l’Arve et les zones d’emploi voisines
| Zone d’emploi | Départs | Arrivées |
|---|---|---|
| Le Genevois Français | 5 890 | 4 500 |
| Le Mont Blanc | 1 830 | 2 180 |
| Annecy | 1 030 | 1 400 |
| Le Chablais | 500 | 290 |
- Lecture : en 2018, 5 890 habitants de la Vallée de l’Arve vont travailler dans le Genevois Français. À l’inverse, 4 500 actifs vivant dans le Genevois Français travaillent dans la Vallée de l’Arve.
- Champ : seuls sont représentés les flux domicile-travail supérieurs à 100.
- Source : Insee, Recensement de la population de 2018.
graphiqueFigure 4 – Navettes domicile-travail entre la Vallée de l’Arve et les zones d’emploi voisines

- Lecture : en 2018, 5 890 habitants de la Vallée de l’Arve vont travailler dans le Genevois Français. À l’inverse, 4 500 actifs vivant dans le Genevois Français travaillent dans la Vallée de l’Arve.
- Champ : seuls sont représentés les flux domicile travail supérieurs à 100
- Source : Insee, Recensement de la population de 2018
Parmi les navetteurs sortants, 11 % travaillent dans le domaine de la santé humaine, alors que ce secteur ne concerne que 3 % des personnes en emploi travaillant et résidant sur le territoire. La présence de grands centres hospitaliers à proximité de la zone d’emploi explique ce déséquilibre.
Si, parmi les actifs résidents en emploi, les femmes sont proportionnellement moins nombreuses à travailler en dehors de la zone que les hommes (31 % contre 34 %), l’écart est moins important qu’en moyenne régionale (1,1 fois plus faible contre 1,3 fois). Cela s’explique notamment par un taux de féminisation de l’emploi industriel plus important dans les industries locales. Le taux de féminisation des emplois d’ouvrier est en effet de 31 % dans la Vallée de l’Arve, contre 20 % en France métropolitaine et 25 % dans le territoire de référence.
Une intensification des déplacements
À l’intérieur comme à l’extérieur de la zone, les déplacements s’intensifient et l’éloignement grandit entre domicile et lieu de travail, même si les temps de trajets moyens observés (hors navettes transfrontalières) sont inférieurs aux moyennes de France métropolitaine et du référentiel. Le nombre de navettes domicile-travail en dehors de la commune de résidence augmente comme les kilomètres parcourus. Le nombre d’actifs en emploi qui sortent de leur commune pour travailler a augmenté annuellement de 1 % entre 2008 et 2013 et de 1,7 % entre 2013 et 2018. Les distances moyennes parcourues par les actifs résidant dans la zone (hors navettes transfrontalières) sont passées de 12,4 km en 2008 à 13,6 km en 2013 et 14,6 km en 2018.
Malgré la présence de quatre gares ferroviaires et des liaisons vers Annemasse, Annecy, La Roche-sur-Foron et Sallanches, une large majorité (86,4 %) des trajets domicile-travail des actifs en emploi résidents se font en véhicule individuel motorisé. Ce taux s’élève à 93,2 % pour les navetteurs entrants. En conséquence, les émissions de CO2 par personne et par an (720 kg), dues aux navettes domicile-travail et domicile-études, sont supérieures à la moyenne de France métropolitaine (650 kg). Elles restent toutefois inférieures à la moyenne des zones d’emploi du référentiel (770 kg). Par ailleurs, le territoire, traversé de part en part par l’autoroute A40, enregistre une circulation de transit particulièrement importante.
Cette intensification des déplacements est plus marquée que la tendance observée en France métropolitaine. Cela s’explique d’une part par le positionnement de la zone au carrefour entre la France, la Suisse et l’Italie, mais aussi par la partition de la zone d’emploi en deux espaces aux fonctions économiques et sociales bien distinctes. Les communes de fond de vallée, structurées autour de Cluses et de Bonneville, hébergent la quasi-totalité des activités industrielles et des services aux résidents alors que les communes de montagne, plus résidentielles, vivent majoritairement des activités d’hébergement-restauration et du tourisme (figure 5).
graphiqueFigure 5 – Localisation de l’emploi industriel et des lits touristiques

- Les informations concernant ces cartes sont disponibles dans le fichier DONNÉES.
- Lecture : la commune de Cluses compte 2 050 emplois industriels en 2018 et 790 lits touristiques en 2021.
- Source : Insee, Recensement de la population 2018 exploitation complémentaire lieu de travail, Pôle de compétence tourisme – données 2021.
Définitions
Le périmètre retenu dans cette étude pour délimiter la Vallée de l’Arve est celui de la zone d’emploi, espace à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent.
Le découpage en zones d’emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur le marché du travail. Il sert de référence pour la diffusion des taux de chômage localisés et des estimations d’emplois. Ce zonage est défini à la fois pour la France métropolitaine et les DOM.
Le découpage actualisé se fonde sur les flux de déplacement domicile-travail des actifs observés lors du Recensement de 2016.
La zone d’emploi de la Vallée de l’Arve est comparée dans cette étude à un territoire dit de « référence ». Ce référentiel est constitué des zones d’emploi de France métropolitaine spécialisées dans l’industrie, au nombre de 37, et déterminé à partir d’une typologie nationale des zones d’emploi (cf. Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes n° 102). Plus particulièrement, au sein de la région, les zones d’emploi d’Oyonnax, d’Issoire, du Livradois, des Sources de la Loire, de Bollène-Pierrelatte et bien sûr de la Vallée de l’Arve sont concernées.
Le solde migratoire (ou solde des arrivées-départs) est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l’année. On parle d’excédent migratoire lorsque le nombre des entrées est supérieur au nombre des sorties. Dans le cas contraire on parle de déficit migratoire.
Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d’une période donnée. On parle d’accroissement naturel ou d’excédent naturel lorsque le nombre de naissances est supérieur à celui des décès. Dans le cas contraire on parle de déficit naturel.
Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (personnes en emploi et chômeurs) et l’ensemble de la population correspondante.
Le revenu disponible est le revenu à la disposition d’un ménage pour consommer et épargner. Il comprend les revenus d’activité (salaires) nets des cotisations sociales, les indemnités de chômage, les retraites et pensions, les revenus du patrimoine (fonciers et financiers) et les autres prestations sociales perçues, nets des impôts directs.
Pour en savoir plus
« Les nouvelles zones d’emploi mettent en avant la diversité du tissu économique de la région », Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes n° 102, septembre 2020
« Les Territoires d’industrie hébergent près d’un emploi industriel sur deux », Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes n° 128, septembre 2021.
« L’orientation économique des zones d’emploi : entre spécialisation et diversification des économies locales », Insee Première n° 1814, septembre 2020