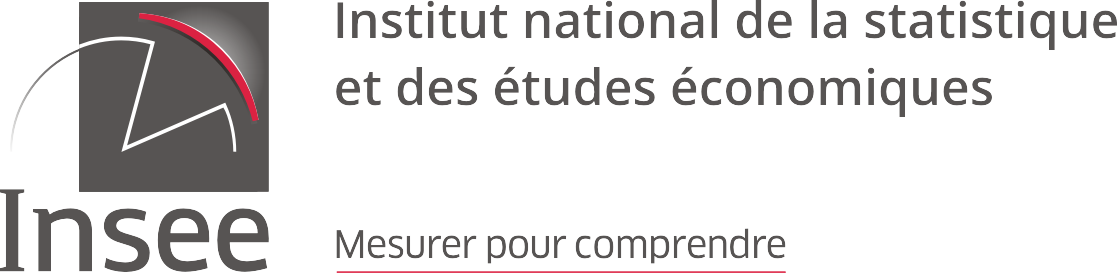Insee Analyses Réunion ·
Décembre 2021 · n° 66
Insee Analyses Réunion ·
Décembre 2021 · n° 66 Les défis économiques, sociaux et environnementaux du XXIᵉ siècle à La Réunion Nouveaux indicateurs de richesse et autres indicateurs de convergence
Les défis économiques, sociaux et environnementaux du XXIᵉ siècle à La Réunion Nouveaux indicateurs de richesse et autres indicateurs de convergence
Malgré son dynamisme au cours des dernières décennies, le développement économique et social de La Réunion marque encore le pas par rapport à celui de la France métropolitaine. Ainsi, la richesse créée par habitant est-elle encore inférieure de 37 % à celle de la métropole. La pauvreté, monétaire ou au sens des privations matérielles et sociales, touche trois fois plus de personnes sur l’île. L’emploi y est en effet plus rare : seules 46 % des personnes de 15 à 64 ans ont un emploi, soit 20 points de moins que dans l’Hexagone, ce qui engendre des inégalités de revenus plus élevées qu’au niveau national. Pour autant, La Réunion est moins éloignée du niveau national en termes de satisfaction dans la vie exprimée par ses habitants ou d’espérance de vie sans incapacité. Le développement de l’île à plus long terme dépend en outre du niveau de formation et de la capacité de l’économie à innover. Or un quart des jeunes sortent du système scolaire sans diplôme qualifiant et l’effort en recherche et développement est nettement inférieur à la moyenne nationale, à La Réunion comme dans les autres DOM. Le développement économique pose aussi la question de sa soutenabilité environnementale, avec notamment l’enjeu de contenir l’artificialisation des sols, déjà particulièrement élevée sur la bande littorale.
- Des revenus encore inférieurs à la moyenne nationale et inégalement répartis
- Quatre Réunionnais sur dix en situation de privation matérielle et sociale
- Satisfaction dans la vie : La Réunion à un niveau intermédiaire entre l’Hexagone et les Antilles
- Innovation et formation : les clés du développement sur le long terme
- Un développement économique soutenable ?
- Encadré - Les dix nouveaux indicateurs de richesse
Depuis la départementalisation de 1946, La Réunion comble progressivement son retard par rapport à la France métropolitaine en matière de développement économique et social. Le rattrapage n’est néanmoins pas encore terminé, d’autant plus qu’il a été freiné par la crise économique et financière de 2008. Dans ce contexte, accroître le niveau des richesses créées constitue toujours une priorité des acteurs socio-économiques de l’île, plus encore que pour les régions métropolitaines et d’autres pays très développés.
Promulguée en février 2017, la loi sur l’égalité réelle Outre-mer (Erom) vise d’ailleurs à accélérer la convergence des Outre-mer avec la métropole en matière de développement socio-économique. Elle prévoit que le produit intérieur brut (PIB) par habitant, indicateur permettant de mesurer le niveau de richesses créées, fasse l’objet d’un suivi régulier pour mesurer à quel rythme les Outre-mer convergent vers l’Hexagone. Cette loi ajoute néanmoins qu’il est nécessaire, plus largement, de suivre si les Outre-mer sont bien sur le bon chemin en matière de développement durable. Elle prévoit donc l’actualisation régulière d’un tableau de bord constitué d’une douzaine d’indicateurs complémentaires du PIB par habitant, dont les dix « nouveaux indicateurs de richesse » définis par la loi dite Sas d’avril 2015.
Des revenus encore inférieurs à la moyenne nationale et inégalement répartis
À La Réunion, le PIB par habitant s’élève à 22 360 euros en 2018, soit 37 % de moins que dans l’Hexagone (figure 1). Il s’agit du niveau enregistré dans l’Hexagone en 1998, soit vingt ans auparavant. C’est plus qu’en Guyane et à Mayotte, mais moins qu’aux Antilles. Le taux de pauvreté monétaire, régulièrement cité dans le débat public et suivi dans le cadre de la loi Erom, reflète aussi cet écart encore important en matière de développement : il atteint 39 % en 2018 contre 15 % dans l’Hexagone [Grangé, 2021]. La cible « zéro exclusion » est ainsi encore assez loin d’être atteinte : il s’agit de l’une des cinq cibles de la stratégie « Trajectoire Outre-mer 5.0 » définie par le ministère des Outre-mer pour donner une orientation au développement et à la transformation des 12 territoires ultra-marins français.
tableauFigure 1 – PIB par habitant en 2018 selon le territoire
| PIB/hab. | |
|---|---|
| La Réunion | 22 359 |
| Martinique | 24 110 |
| Guadeloupe | 24 350 |
| Hauts-de-France | 27 823 |
| Province* | 30 266 |
- * France métropolitaine, hors Île-de-France.
- Note : la région des Hauts-de-France est la région métropolitaine au PIB par habitant le plus faible.
- Source : Insee, comptes économiques régionaux.
graphiqueFigure 1 – PIB par habitant en 2018 selon le territoire

- * France métropolitaine, hors Île-de-France.
- Note : la région des Hauts-de-France est la région métropolitaine au PIB par habitant le plus faible.
- Source : Insee, comptes économiques régionaux.
Pour autant, le niveau de richesses créées sur un territoire ne traduit pas le fait que le marché du travail local mobilise une part plus ou moins importante de personnes en âge de travailler. De fait, il ne suffit pas à déterminer dans quelle mesure les revenus qui en résultent sont inégalement distribués.
Or à La Réunion, les inégalités de revenus sont particulièrement fortes. Ainsi, en 2018, les revenus perçus par les 20 % des ménages les plus aisés sont 5,4 fois plus élevés que ceux des 20 % les plus modestes. En métropole, ce rapport est plus réduit (4,0) : seuls quelques départements de la région parisienne se situent à un niveau supérieur à celui de La Réunion. Les inégalités de revenus sont néanmoins plus fortes encore dans les autres départements et régions d’Outre-mer (Drom). La lutte contre les inégalités est un objectif en soi, qui va dans le même sens que l’enjeu d’efficacité économique : l’accroissement des inégalités peut en effet avoir un impact négatif sur le développement économique de tous, au-delà du sentiment d’injustice qu’il peut générer dans la population.
À La Réunion, les inégalités de revenus s’expliquent par des inégalités d’accès à l’emploi plus que par des inégalités d’accès à l’éducation, à la formation, à la santé ou au logement. La part de personnes en âge de travailler qui disposent d’un emploi y est ainsi nettement inférieure à la moyenne nationale : en 2019, le taux d’emploi des 15-64 ans s’élève à 46 %, soit 20 points de moins que dans l’Hexagone (figure 2) [Audoux et Mallemanche, 2019]. Ce niveau est très éloigné de l’objectif de développement durable visant à parvenir d’ici à 2030 au plein emploi productif et de la cible de 75 % retenue par la stratégie « Europe 2020 ». Le taux d’emploi révèle, à la fois, la capacité des structures productives à mobiliser la main-d’œuvre potentielle et la capacité de l’économie à favoriser l’inclusion sociale des personnes par l’emploi. À La Réunion, il est en outre particulièrement faible pour les femmes et les jeunes, qui sont ainsi très exposés au risque de pauvreté lorsqu’ils ne vivent pas au sein d’un ménage comprenant d’autres personnes percevant des revenus d’activité.
tableauFigure 2 – Taux d’emploi en 2019 selon le territoire
| La Réunion | Guadeloupe | Martinique | Métropole | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 46 | 50 | 57 | 66 |
| Femmes | 42 | 46 | 57 | 63 |
| Hommes | 51 | 54 | 58 | 69 |
| 15-29 ans | 26 | 23 | 26 | 45 |
- Source : Insee, enquête Emploi.
graphiqueFigure 2 – Taux d’emploi en 2019 selon le territoire

- Source : Insee, enquête Emploi.
Quatre Réunionnais sur dix en situation de privation matérielle et sociale
Définir un indicateur de pauvreté opérationnel est une condition essentielle pour cibler et réduire le phénomène. Mesurant une pauvreté « absolue », le taux de pauvreté en conditions de vie correspond à l’image de la pauvreté communément admise, à savoir l’exclusion de pratiques et de consommations de base.
La part de Réunionnais en situation de privation matérielle et sociale est semblable au taux de pauvreté monétaire : quatre personnes sur dix en 2018 (figure 3). Ils sont privés d’au moins cinq éléments parmi treize considérés comme nécessaires à une vie décente : ne pas avoir les moyens de se constituer une épargne, de s’acheter des vêtements neufs ou d’avoir une activité de loisir régulière, etc. En lien avec un niveau de vie nettement moins élevé, ces privations touchent trois fois plus de personnes à La Réunion qu’en métropole (13 %). Aux Antilles, la privation matérielle et sociale est autant présente qu’à La Réunion, alors que le niveau de vie médian de la population réunionnaise est plus faible.
tableauFigure 3 – Privations matérielles et sociales et satisfaction dans la vie selon le territoire
| La Réunion | Guadeloupe | Martinique | Métropole | |
|---|---|---|---|---|
| Part de la population en privation matérielle ou sociale | 40 | 41 | 36 | 13 |
| Note moyenne de satisfaction dans la vie* | 68 | 63 | 64 | 73 |
- * Note moyenne sur 10 rapportée à un total de 100.
- Lecture : en 2018, à La Réunion, 40 % de la population est en situation de privation matérielle et sociale. Les Réunionnais estiment, par une note moyenne de 68 sur 100 soit 6,8 sur 10, leur degré de satisfaction dans la vie.
- Source : Insee, enquête SRCV 2018.
graphiqueFigure 3 – Privations matérielles et sociales et satisfaction dans la vie selon le territoire

- * Note moyenne sur 10 rapportée à un total de 100.
- Lecture : en 2018, à La Réunion, 40 % de la population est en situation de privation matérielle et sociale. Les Réunionnais estiment, par une note moyenne de 68 sur 100 soit 6,8 sur 10, leur degré de satisfaction dans la vie.
- Source : Insee, enquête SRCV 2018.
Satisfaction dans la vie : La Réunion à un niveau intermédiaire entre l’Hexagone et les Antilles
L’indicateur de privation matérielle et sociale est fondé sur des facteurs objectifs, comme la plupart des autres indicateurs de richesse nationale, qui visent d’abord à mesurer la soutenabilité et la qualité du développement économique. Mais, comme l’ont rappelé notamment Joseph Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi en 2009 dans leur rapport sur la mesure des performances économiques et du progrès social, « les dimensions objective et subjective du bien-être sont toutes deux importantes ». Le bien-être n’est en effet pas uniquement matériel. Il englobe diverses dimensions de l’existence (relations sociales, participation à la vie publique, sécurité, confiance dans les autres et dans les institutions, etc.), susceptibles d’être affectées par le mode de développement économique. L’augmentation du niveau de vie n’implique pas nécessairement une augmentation du sentiment de bien-être sur le long terme. Un indicateur subjectif de bien-être est donc nécessaire pour vérifier si le ressenti des habitants d’un territoire est en phase avec les indicateurs « objectifs ».
C’est l’objet de l’indicateur de satisfaction dans la vie résultant d’une note de 0 à 10 que les personnes interrogées ont attribuée à leur bien-être. À La Réunion, cet indicateur est relativement mieux positionné que ne le sont les indicateurs objectifs de pauvreté : il se situe à mi-chemin entre l’Hexagone et les Antilles. Davantage de personnes que dans les autres Drom sont en effet très satisfaites de leur vie (note d’au moins 8 sur 10) : 42 %, contre 51 % en métropole et 33 % en Martinique.
Un autre indicateur s’avère particulièrement pertinent pour évaluer le bien-être d’une population : l’espérance de vie sans incapacité. En effet, comme l’a déclaré en 1997 le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé : « sans la qualité de la vie, une longévité accrue ne présente guère d’intérêt (...) l’espérance de santé est plus importante que l’espérance de vie ». En 2018, les Réunionnais comme les Réunionnaises peuvent espérer vivre 62 ans en bonne santé. Les habitants de l’île pouvant disposer de structures de santé assez semblables à celles des régions métropolitaines, leur espérance de vie en bonne santé est proche de la moyenne nationale. Elle est néanmoins un peu inférieure du fait de la forte prévalence de maladies chroniques comme le diabète principalement [Merceron et Thibault, 2021], en particulier pour les femmes : 2,5 ans de moins que dans l’Hexagone contre 1,5 an de moins pour les hommes.
Innovation et formation : les clés du développement sur le long terme
Sur le long terme, pour développer ou maintenir les richesses favorisant le bien-être d’une population, l’investissement dans la formation est primordial. Dans son Agenda 2030, l’ONU fixe ainsi comme objectif d’augmenter nettement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat. Un diplôme d’enseignement secondaire de second cycle constitue ainsi pour l’Union européenne un bagage scolaire minimum pour une société de la connaissance. En 2018, à La Réunion, l’échec scolaire reste élevé : 25 % des jeunes de 20 à 24 ans sont sortis du système scolaire sans diplôme qualifiant, c’est-à-dire sans disposer a minima d’un CAP ou d’un BEP. C’est 8 points de plus que dans l’Hexagone et qu’aux Antilles.
La recherche et développement (R&D) est par ailleurs source d’innovations permettant d’accroître la compétitivité des territoires dans le contexte de la société de la connaissance. Elle est l’un des moyens de répondre aux grands défis sociétaux (énergie, climat, santé) et de favoriser une croissance durable. Le suivi des dépenses de R&D répond à l’un des objectifs de la stratégie de l’Union européenne d’atteindre à l’horizon 2020 un effort de recherche équivalent à au moins 3 % du PIB, dont les deux tiers réalisés par les entreprises. Le Livre bleu Outre-mer ambitionne en outre de faire des Outre-mer des territoires « pionniers et d’innovation ».
Cependant, en matière de R&D, La Réunion est très en retard par rapport aux régions hexagonales, tout comme les autres Drom et en dépit d’un ensemble de dispositifs de soutien à l’innovation. Plusieurs facteurs structurels (taille du marché, prédominance des très petites entreprises, importance des coûts, etc.) limitent en effet les innovations de produit et de procédé dans les entreprises. Aussi, l’essentiel de la R&D est-elle portée par le secteur public, contrairement à la situation de l’Hexagone. L’effort global ne dépasse pas 0,6 % du PIB dans l’ensemble des Outre-mer, contre 2,2 % en moyenne nationale en 2017.
Néanmoins, au regard de leurs homologues des autres Outre-mer, les entreprises privées réunionnaises participent davantage au financement de la R&D, ce qui se traduit par un recours plus important au crédit d’impôt-recherche et par davantage de brevets déposés [Ouvrir dans un nouvel ongletIedom, 2020]. La Réunion dispose d’un pôle de compétitivité labellisé en 2019, Qualitropic, et a obtenu le label thématique French HealthTech en 2016 pour son dynamisme dans le domaine de la santé et le statut de communauté FrenchTech en avril 2019. Par ailleurs, ces données relatives aux dépenses en R&D ne prennent pas en compte celles de certaines sociétés dont le centre de recherches est situé en dehors des Outre-mer, alors que des projets de recherches portent sur ces territoires et ont été menés en partie sur place.
Un développement économique soutenable ?
Pour rester soutenable, le développement économique doit avoir un impact limité sur le plan environnemental. La stratégie Trajectoire Outre-mer 5.0 prévoit ainsi d’atteindre l’objectif de « zéro carbone ». Les émissions de gaz à effet de serre constituent le seul nouvel indicateur de richesse pour lequel La Réunion se situe dans une position plus favorable que la moyenne nationale, et même que l’ensemble des régions de l’Hexagone et des Antilles. Ainsi, en 2018, les émissions de gaz à effet de serre par habitant étaient inférieures de 18 % à celles de l’Hexagone. Mais cette bonne performance apparente s’explique avant tout par les spécificités du territoire : peu d’activités industrielles fortement émettrices, dépendances aux produits importés, très peu de chauffage des logements, moins de véhicules motorisés en circulation.
Au contraire, les sols de La Réunion sont en moyenne deux fois plus artificialisés que ceux de l’Hexagone : 12 % contre 6 % en 2018. Sur l’île, l’artificialisation des sols est particulièrement élevée sur la bande littorale, à l’exception de la zone volcanique. Sur cette surface limitée, sur laquelle se concentrent la moitié de la population, les grands ouvrages structurants de l’île et les principales activités économiques, plus de 40 % des sols étaient déjà artificialisés au début des années 2010. Or l’artificialisation a des conséquences sur l’environnement, ce qui a amené le Gouvernement à inscrire un objectif de « zéro artificialisation nette » dans le Plan Biodiversité en 2018. Elle engendre en effet une perte de ressources en sol pour l’usage agricole et pour les espaces naturels, elle peut accélérer le ruissellement des eaux pluviales en imperméabilisant certains sols, accroître la vulnérabilité aux inondations et dégrader la qualité chimique et écologique des eaux. La destruction et la fragmentation des espaces naturels constituent également une menace pour la biodiversité, qui est un atout majeur d’un territoire insulaire comme La Réunion. En outre, l’étalement urbain affecte la qualité de vie des personnes qui doivent davantage emprunter leurs véhicules motorisés, consomment plus d’énergie et amplifient leurs émissions de gaz à effets de serre et de polluants dans l’air.
Encadré - Les dix nouveaux indicateurs de richesse
Le tableau de bord des « nouveaux indicateurs de richesse » présente dix indicateurs phares de développement durable - compatibles avec un cadre théorique international - et complète le PIB dans trois domaines : social, économique et environnemental (figure). Ces indicateurs concernent non seulement le bien-être présent et futur de la Nation, mais également le bien-être « ailleurs », c’est-à-dire celui des autres régions du monde, impactées par notre mode de vie. Faisant partie des indicateurs retenus pour suivre la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 de l’Organisation des Nations unies (ONU), ces indicateurs ont été choisis dans un souci de simplicité, de lisibilité et de pérennité. Ce tableau de bord fait suite à l’adoption de la loi 2015-411 du 13 avril 2015 qui invite à la prise en compte de nouveaux indicateurs de richesse dans l’évaluation et la définition des politiques publiques. Il résulte d’une large concertation réunissant experts et citoyens, organisée par le Conseil économique social et environnemental et France Stratégie, en collaboration avec le Conseil national de l’information statistique (Cnis) et le service statistique public.
La loi sur l’égalité réelle Outre-mer du 28 février 2017 invite de son côté à élaborer une stratégie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière d’infrastructures, d’environnement, de développement économique et d’implantation des entreprises, de développement social et culturel, d’égalité entre les femmes et les hommes, de santé et d’accès aux soins, d’éducation, de lutte contre l’illettrisme, de formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accès à la justice, de sécurité, de télécommunications, d’accès aux services publics, à l’information, à la mobilité, à la culture et au sport. Elle fait l’objet de mesures à partir de l’évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, du taux de pauvreté monétaire, ainsi que des nouveaux indicateurs de richesse figurant dans la loi d’avril 2015. Ces indicateurs intègrent des données relatives au sexe et sont ajustés par rapport au niveau des prix et à l’inflation spécifiques à chaque territoire.
Lancée le 8 avril 2019 par le ministère des Outre-mer, la « Trajectoire Outre-mer 5.0 » donne un cap au développement et à la transformation des 12 territoires ultra-marins français. La priorité est donnée au développement durable. Cette stratégie se décline à travers cinq grands objectifs « zéro » : zéro exclusion, zéro carbone, zéro déchet, zéro polluant agricole et zéro vulnérabilité.
tableauNouveaux indicateurs de richesse et autres indicateurs de convergence
| Indicateurs | La Réunion | Métropole | Guadeloupe | Martinique |
|---|---|---|---|---|
| Nouveaux indicateurs de richesse (loi n° 2015-411 du 13 avril 2015) | ||||
| Taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans (2019 – en %) | 46 | 66 | 50 | 57 |
| Effort de recherche (DIRD / PIB – 2017 – en %) | 0,6 (*) | 2,2 | / | / |
| Espérance de vie sans incapacité (2018 – en années) | ||||
| - hommes | 61,9 | 63,5 | 59,5 | 62,5 |
| - femmes | 62,1 | 64,5 | 61 | 62,7 |
| Satisfaction dans la vie (2018 – note moyenne sur 10) | 6,8 | 7,3 | 6,3 | 6,4 |
| Écart de revenus (rapport entre la rémunération totale des 20 % des ménages les plus aisés, et celle des 20 % des ménages les plus modestes – 2018) | 5,4 | 4 | 5,9 | 5,7 |
| Privations matérielles et sociales (2018 – en %) | 40 | 12,9 | 41,1 | 36,3 |
| Part des 20-24 ans sortis du système scolaire sans diplôme qualifiant (2018 – en %) | 25 | 17 | 17 | 17 |
| Quantité de gaz à effet de serre hors UTCATF émis par habitant (2018 – en tCO2eq) | 5,46 | 6,66 | 8,58 | 8,10 |
| Artificialisation des sols (2018 – en % de la surface) | 12 | 6 | 15 | 17 |
| Autres indicateurs de convergence (loi n° 2017-256 du 28 février 2017) | ||||
| Produit intérieur brut par habitant (2018 – en euros) | 22 359 | 35 763 | 24 350 | 24 110 |
| Taux de chômage (2019 – en %) | 21 | 8 | 21 | 15 |
| Taux de pauvreté monétaire à 60 % du revenu médian (2018 – en %) | 39 | 14 | 35 | 30 |
- (*) ensemble des départements et régions d’outre-mer.
- Sources : Insee, Recensement de la population 2018 - enquête Emploi 2019 – Comptes économiques régionaux et nationaux 2018 – enquête SRCV 2018 – enquête Budget de famille 2017 – Filosofi 2018 ; ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, enquête annuelle sur les moyens consacrés à la RetD dans les entreprises 2017 ; Citepa, décembre 2020 - Format Outre-mer ; SDES, Corine Land Cover 2018.
Pour comprendre
L’indicateur de la loi du 13 avril 2015 sur les nouveaux indicateurs de richesse relatif à l’endettement n’est pas disponible à l’échelle régionale. D’autres ne le sont pas mais ont été remplacés par des indicateurs proches : la part des 20-24 ans sortis du système scolaire sans diplôme qualifiant à la place du taux de sortants précoces du système scolaire et la quantité de gaz à effet de serre émis par habitant à la place de l’empreinte carbone.
L’indicateur d’artificialisation des sols retenu ici s’appuie sur la source Corine Land Cover , qui permet de comparer les territoires entre eux. Cette source est en revanche peu appropriée pour mesurer l’évolution de l’artificialisation des sols de La Réunion au cours du temps : il convient de lui préférer l’évolution de la tâche urbaine, ainsi que celle des sols ni agricoles ni naturels [Coudrin et Fleuret, 2021].
Le calcul d’espérance de vie sans incapacité s’appuie ici sur l’enquête Statistiques et ressources sur les conditions de vie (SRCV). Cet indicateur est assez fragile à l’échelle infra-nationale et les résultats peuvent varier de façon substantielle selon la source utilisée. Cependant, cela ne remet pas en cause le fait que l’espérance de vie sans incapacité est un peu plus faible à La Réunion qu’en moyenne nationale.
Pour en savoir plus
Insee, « Indicateurs de richesse nationale », Chiffres détaillés, décembre 2021.
Coudrin C., Fleuret A., « À La Réunion, améliorations économiques et sociales, dégradation environnementale – Objectifs et indicateurs de développement durable à La Réunion : évolutions depuis 20 ans », Chiffres détaillés, octobre 2021.
Durand J., Lavergne H., Boulin P., Vey F., « Spécificités des départements français au regard du développement durable », in « La France et ses territoires – édition 2021 », Insee Références, avril 2021.
Insee et Sdes, « Indicateurs territoriaux de développement durable », avril 2021.
Audoux L., Mallemanche C., « Dans les DOM, une insatisfaction plus fréquente vis-à-vis des conditions matérielles amoindrit la satisfaction dans la vie », Insee Focus n° 220, décembre 2020.
Robin M., « Enquête Statistiques sur les ressources et les conditions de vie en 2018 - Quatre Réunionnais sur dix sont en situation de privation matérielle et sociale », Insee Analyses La Réunion n° 53, décembre 2020.
Deal, « Ouvrir dans un nouvel ongletLe profil environnemental de La Réunion », Deal, février 2014.