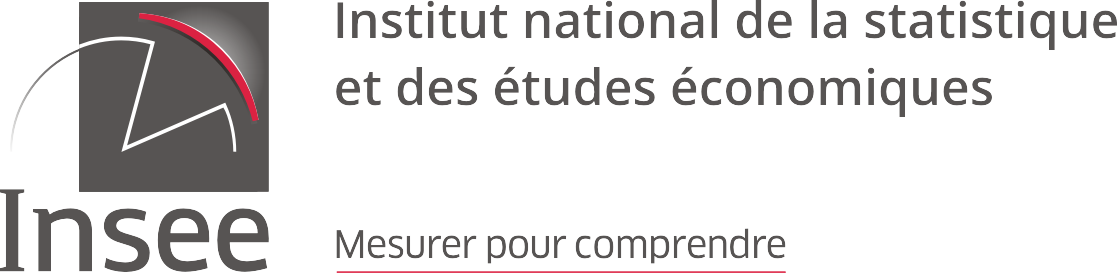Insee Analyses Occitanie ·
Septembre 2021 · n° 110
Insee Analyses Occitanie ·
Septembre 2021 · n° 110 Pas d'accentuation des disparités résidentielles entre communes entre 1990 et 2017 Aires d'attraction de Toulouse, Montpellier, Perpignan et Nîmes
Pas d'accentuation des disparités résidentielles entre communes entre 1990 et 2017 Aires d'attraction de Toulouse, Montpellier, Perpignan et Nîmes
En 2017, plus de la moitié des actifs occupés de la région Occitanie résident, dans une des aires d’attraction des villes de Toulouse, Montpellier, Perpignan et Nîmes. Dans les aires de Toulouse et de Montpellier, les cadres sont très présents parmi la population des pôles ou des communes situées à leur proximité, alors que les ouvriers sont plus nombreux à résider aux franges de ces aires. Les pôles de Perpignan et Nîmes accueillent en proportion moins de cadres. Depuis des décennies, de profondes mutations de l’économie sont à l’œuvre, avec en particulier un essor des cadres et un recul de l’emploi ouvrier. Ces évolutions n’ont pas accentué les disparités résidentielles entre communes. Entre 1990 et 2017, les distances domicile-travail se sont allongées. Ce sont toujours les ouvriers qui parcourent les plus grandes distances, et la voiture est de loin le mode de transport privilégié par tous.
- De nombreux cadres résident dans ou à proximité des pôles de Toulouse et Montpellier
- Plus de mixité sociale dans les pôles de Perpignan et Nîmes
- Les mutations sociales ne s’accompagnent pas d’une hausse de la ségrégation résidentielle
- Des trajets plus longs pour les ouvriers pour se rendre au travail dans les plus grandes aires
- Avec l’allongement des distances domicile-travail, les modes « doux » de transport peinent à se développer
Près de 1,2 million d’actifs en emploi résident dans l’aire d’attraction de l’une des quatre plus grandes villes de la région Occitanie en 2017. Ces territoires, qui offrent de nombreux services et concentrent une majorité d’emplois, hébergent une part de plus en plus grande des actifs occupés de la région : à périmètre constant, 45 % y habitaient en 1990 contre 52 % aujourd’hui. Ces actifs choisissent leur commune de résidence, en lien avec leur trajectoire de vie, en procédant à des arbitrages entre leurs aspirations (appartement ou maison, facilité d’accès à l’emploi, proximité de certains services ou un environnement plus vert…) et les contraintes liées en particulier au coût d’accès au logement et à la localisation de leur travail. Des différences sociales en résultent sur les territoires.
De nombreux cadres résident dans ou à proximité des pôles de Toulouse et Montpellier
Par rapport à la moyenne observée sur chaque aire, certaines catégories socioprofessionnelles sont plus présentes sur certains territoires de ces aires (figure 1) ou au contraire plus rares. Sur les aires d’attraction de Toulouse et de Montpellier, les cadres sont très présents dans les deux villes-centres et plus largement dans les deux pôles. Le vaste pôle de Toulouse, qui s’étend sur 18 communes de Castelginest à Villeneuve-Tolosane du nord au sud et de Plaisance-du-Touch à Saint-Jean d’ouest en est, compte 32 % de cadres parmi ses habitants en activité contre 27 % dans l’ensemble de l’aire. Sur certaines communes comme Tournefeuille, Balma ou Ramonville-Saint-Agne, ces derniers représentent jusqu’à 35 à 40 % des actifs occupés.
graphiqueFigure 1 – Actifs en emploi au lieu de résidence dans les communes des quatre principales aires d’attraction des villes (AAV) d’OccitanieAAV de Toulouse

- Cartes d’autocorrélation spatiale
- Lecture : sur l’aire de Toulouse, les communes figurées en bleu (respectivement en rouge) abritent, comme leurs voisines, une part élevée de cadres (respectivement d’ouvriers) parmi leurs actifs en emploi résidents comparativement à la moyenne observée sur l’ensemble de l’aire. Elles forment ensemble un espace de similitude pour cet indicateur, et identifient ainsi une zone de disparité spatiale et sociale (autocorrélation spatiale).
- Source : Insee, recensement de la population 2017, actifs en emploi au lieu de résidence
Le pôle de Montpellier est composé de 6 communes (Montpellier, Castelnau-le-Lez, Lattes, Saint-Jean-de-Védas, Le Crès et Grabels) : parmi ses habitants actifs occupés, 26 % sont cadres contre 22 % en moyenne sur l’aire montpelliéraine.
Mais la part de cadres est également élevée dans des communes de la couronne situées à proximité de ces pôles. Ainsi, des espaces où les cadres sont plus nombreux s’étendent à l’ouest et au sud-est du pôle toulousain : des communes comme Lauzerville, Lacroix-Falgarde, Auzeville-Tolosane, Péchabou au sud ou Pibrac et Brax à l’ouest comptent plus de 40 % de cadres parmi leurs habitants. Ces communes sont proches de la ville-centre mais aussi des autres principaux pôles d’emplois hautement qualifiés de l’agglomération (Labège au sud, Blagnac et Colomiers à l’ouest). Au nord du pôle montpelliérain, la part des cadres dépasse 30 % dans les communes de Saint-Clément-de-Rivière, Montferrier-sur-Lez, Clapiers et Saint-Gély-du-Fesc, qui bénéficient d’un cadre de vie préservé et d’une proximité immédiate avec Montpellier.
En revanche, les cadres sont moins nombreux parmi les actifs occupés résidant dans les communes plus éloignées du pôle, hormis quelques îlots identifiés en particulier au nord-est de l’aire d’attraction de Toulouse, autour de Montastruc-la-Conseillère par exemple, et situés sur des axes de communication rapide avec le pôle d’emplois toulousain.
Plus de mixité sociale dans les pôles de Perpignan et Nîmes
Les aires d’attraction de Nîmes et de Perpignan comptent 14 % et 12 % de cadres parmi les actifs en emploi qui y résident. Cette proportion est respectivement de 17 % et 14 % dans les pôles de ces deux aires, qui sont de taille réduite (ville de Nîmes pour le premier et les trois communes de Perpignan, Saint-Estève et Cabestany pour le second). Les cadres sont plus nombreux parmi les actifs en emploi habitant au sud-ouest de Nîmes, dans des communes telles que Calvisson, Vergèse, Clarensac ou Aigues-Vives où les accès en transports en commun sont facilités avec la métropole voisine de Montpellier grâce au développement des interconnexions entre modes de transport. Sur Perpignan, un quart de la population habite dans l'un des neuf quartiers prioritaires de la ville et l'habitat majoritairement ancien y est peu prisé par les ménages les plus aisés.
Au sein des quatre aires d’attraction, les espaces où les cadres sont plus rares sont souvent ceux où les ouvriers sont nombreux parmi les actifs occupés résidents. Ils sont généralement éloignés des villes-centres. C’est le cas dans des communes situées autour de Villemur-sur-Tarn au nord de l’aire toulousaine, autour d'Aimargues, Lunel, Marsillargues ou encore Gigean dans l’aire montpelliéraine, Saint-Gilles et Vauvert dans l’aire de Nîmes et autour de Millas dans l’aire perpignanaise.
Enfin, la répartition spatiale des employés est dans l’ensemble plus homogène sur les quatre aires. Seule exception, un ensemble de communes situées au sud de l’aire toulousaine autour de Saverdun où ils sont relativement plus nombreux, en lien avec la nature des emplois offerts sur ce territoire.
Les mutations sociales ne s’accompagnent pas d’une hausse de la ségrégation résidentielle
Depuis des décennies, de profondes mutations s’opèrent dans l’économie : hausse des qualifications, tertiarisation des activités, avec pour conséquence la diminution de l’emploi ouvrier et l’augmentation des postes de cadres, de professions intermédiaires et d’employés. De plus, l’emploi augmente plus fortement dans les couronnes que dans les pôles, qui en concentrent néanmoins toujours une majorité.
Ces évolutions ne s’accompagnent pas d’une hausse des disparités sociales entre communes dans les territoires étudiés. Si les cadres constituent toujours la population la plus inégalement répartie sur chacune des aires (figure 2), la ségrégation résidentielle a tendance à diminuer depuis 1990. En effet, alors que 22 % des cadres auraient dû changer de commune de résidence en 1990 pour que leur répartition soit homogène sur l’aire de Toulouse, cette proportion passe à 19 % en 2017. Le recul des disparités est encore plus net pour les cadres sur l’aire de Perpignan. La ségrégation spatiale des ouvriers a fortement reculé, en particulier sur l’aire de Montpellier (passant de 17 % à 13 %). Les employés sont les actifs occupés les mieux répartis sur l’ensemble des aires. Cette répartition des employés, moins inégale que celle des cadres ou des ouvriers, gagne encore en homogénéité au cours du temps, excepté sur l’aire de Toulouse où l’indicateur de ségrégation des employés progressent légèrement entre 1990 et 2017. Les lieux de vie des employés sont ainsi plus diversifiés, en lien avec l’étalement urbain qui a conduit au développement de l’économie présentielle dans les couronnes, et sans doute aussi en raison des difficultés d’accéder financièrement au foncier dans les pôles.
tableauFigure 2 – Indicateur de ségrégation par catégorie socioprofessionnelle
| 2017 | 1990 | Évolution 2017 / 1990 (% annuel moyen pour le nombre d’actifs – Écart total en points pour les indices) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAV de Toulouse | AAV de Montpellier | AAV de Perpignan | AAV de Nîmes | AAV de Toulouse | AAV de Montpellier | AAV de Perpignan | AAV de Nîmes | AAV de Toulouse | AAV de Montpellier | AAV de Perpignan | AAV de Nîmes | |
| Nombre d’actifs occupés | 625 800 | 304 300 | 136 100 | 126 200 | 378 800 | 179 200 | 97 300 | 94 800 | + 1,9 | + 2,0 | + 1,3 | + 1,1 |
| dont (%) : cadres | 27 | 22 | 12 | 14 | 16 | 16 | 10 | 10 | + 3,9 | + 3,2 | + 2,0 | + 2,2 |
| employés | 24 | 27 | 32 | 31 | 26 | 28 | 29 | 27 | + 1,5 | + 1,8 | + 1,7 | + 1,5 |
| ouvriers | 14 | 14 | 19 | 18 | 23 | 21 | 26 | 29 | + 0,1 | + 0,4 | + 0,1 | - 0,7 |
| Indice de ségrégation (%) | ||||||||||||
| cadres | 19 | 17 | 12 | 14 | 22 | 19 | 17 | 16 | - 2,2 | - 2,5 | - 4,4 | - 1,8 |
| employés | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | + 0,5 | - 1,3 | - 5,0 | - 4,4 |
| ouvriers | 15 | 13 | 9 | 13 | 16 | 17 | 10 | 14 | - 0,9 | - 4,2 | - 1,5 | - 1,6 |
- Lecture : en 2017, 304 300 actifs occupés résident dans l’aire d’attraction de la ville (AAV) de Montpellier. Parmi eux, 14 % sont ouvriers. 13 % des ouvriers devraient changer de commune de résidence pour avoir une répartition homogène de cette catégorie socioprofessionnelle sur l’ensemble de l’aire. Entre 1990 et 2017, sur l'AAV de Montpellier, le nombre de cadres résidents a augmenté de 3,2 % par an en moyenne ; sur l'ensemble de la période, l'indice de ségrégation des cadres a reculé de - 2,5 points.
- Source : Insee, recensements de la population 1990 et 2017, actifs en emploi au lieu de résidence
Des trajets plus longs pour les ouvriers pour se rendre au travail dans les plus grandes aires
Les cadres et dans une moindre mesure les ouvriers ne résident pas de façon homogène au sein de chacune des quatre principales aires d'attraction des villes de la région. Cela découle au moins en partie de l'inégale répartition des emplois au sein de ces aires, en fonction notamment de leur nature.
L’aire de Toulouse, plus étendue que les trois autres, comprend des pôles d’emploi secondaires importants tels que Blagnac, Colomiers ou Labège, quand l’emploi est davantage concentré dans la ville-centre à Montpellier, Perpignan ou Nîmes. Les emplois de cadres sont davantage concentrés dans les villes-centres, alors que les postes de niveau ouvrier ou employé sont localisés plus souvent que les autres dans les couronnes, sauf à Montpellier et Perpignan. Ces inégales répartitions des populations selon leur catégorie sociale et des emplois selon leur nature induisent des déplacements entre les lieux de domicile et de travail, plus ou moins longs et mobilisant différents modes de transport.
Sur les aires d’attraction de Toulouse et de Montpellier, les ouvriers parcourent plus de distance que les cadres pour aller travailler (figure 3). Dans l’aire de Nîmes, les distances parcourues par les cadres sont parfois très élevées, traduisant le fait que nombre d’entre eux occupent un emploi situé en dehors de l’aire, à Montpellier ou à Arles par exemple. Un cadre sur dix résidant sur l’aire de Perpignan est domicilié à au moins 25 km de son lieu de travail. Sur l’aire de Nîmes, 10 % des cadres parcourent 52 km ou plus pour aller travailler. Les employés sont les actifs qui ont le moins de distance à parcourir, en lien avec la meilleure répartition géographique de leurs emplois.
tableauFigure 3 – Distance parcourue lors du déplacement domicile-travail par les actifs selon le type de trajet et la qualification
| AAV de Toulouse | AAV de Montpellier | AAV de Perpignan | AAV de Nîmes | |
|---|---|---|---|---|
| Distance médiane parcourue (en km) par l’ensemble des actifs occupés | 10,0 | 7,6 | 7,7 | 9,0 |
| par ceux se déplaçant : | ||||
| - de pôle à pôle | 6,1 | 4,2 | 3,6 | 3,4 |
| - de couronne à couronne | 7,5 | 5,5 | 4,7 | 3,7 |
| - de pôle vers couronne | 14,4 | 12,1 | 13,1 | 12,5 |
| - de couronne vers pôle | 22,7 | 16,3 | 13,0 | 14,6 |
| par les cadres | 10,1 | 8,0 | 8,5 | 11,0 |
| par les employés | 8,6 | 6,7 | 7,1 | 7,3 |
| par les ouvriers | 11,3 | 8,4 | 8,0 | 10,0 |
| Distance parcourue (en km) | ||||
| maximale par les 10 % se déplaçant le moins | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,2 |
| parmi les cadres | 2,7 | 1,9 | 1,4 | 1,5 |
| parmi les employés | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
| parmi les ouvriers | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 1,5 |
| minimale par les 10 % se déplaçant le plus | 33,8 | 31,4 | 22,5 | 36,4 |
| parmi les cadres | 34,4 | 35,8 | 25,3 | 52,1 |
| parmi les employés | 30,4 | 26,3 | 20,8 | 26,8 |
| parmi les ouvriers | 35,7 | 31,3 | 22,3 | 35,4 |
- Lecture : la moitié des actifs occupés vivant dans l’aire d’attraction de la ville (AAV) de Perpignan parcourent au moins 7,7 km pour aller travailler. Parmi ceux qui se déplacent de la couronne vers le pôle, la moitié parcourent au moins 13 km. Par ailleurs, la moitié des cadres vivant sur l’aire de Perpignan parcourent au moins 8,5 km. Les 10 % des cadres qui se déplacent le moins parcourent au plus 1,4 km tandis que les 10 % des cadres se déplaçant le plus parcourent au moins 25,3 km.
- Champ : actifs en emploi de 15 ans ou plus, qui déclarent se déplacer pour aller travailler dans une limite de 150 kilomètres.
- Source : Insee, recensement de la population 2017, actifs en emploi au lieu de résidence, © les contributeurs d’OpenStreetMap
Les actifs qui font les trajets domicile-travail les plus longs sont ceux qui habitent la couronne et viennent travailler dans le pôle, et de loin. Ceux qui habitent et travaillent dans la couronne d’une des quatre aires ne se déplacent guère plus loin que ceux qui restent au sein d’un pôle. C’est sur l’aire de Toulouse que l’écart est le plus fort et il n’est que de 1,4 km. Les déplacements de couronne à couronne se font donc majoritairement entre communes proches plutôt qu’entre communes éloignées situées de part et d’autre du pôle.
Avec l’allongement des distances domicile-travail, les modes « doux » de transport peinent à se développer
La voiture est le mode de transport privilégié pour 7 actifs en emploi sur 10 sur les aires de Toulouse et de Montpellier et 8 sur 10 sur les aires de Perpignan et Nîmes. Les actifs qui résident dans la couronne privilégient la voiture en raison d’une offre de transport moins développée que celle disponible au sein du pôle. Les transports en commun sont davantage utilisés dans les aires de Toulouse et de Montpellier, qui bénéficient toutes deux d’une offre plus diversifiée avec le métro ou le tramway. Ce sont les employés qui les utilisent le plus. À l’échelle des quatre aires d’attraction, moins de 4 % des actifs en emploi utilisent principalement le vélo pour se rendre au travail, avec une proportion supérieure pour les cadres, et également sur les communes de Toulouse et Montpellier qui concentrent davantage de cadres.
Les distances domicile-travail se sont allongées entre 1990 et 2017, particulièrement pour les actifs qui résident dans les couronnes des aires de Toulouse et Montpellier, en lien avec l’étalement urbain et en raison d’une forte concentration des emplois dans les deux pôles (figure 4). Ce n’est pas le cas sur Perpignan, car la distribution des emplois y est plus équilibrée entre pôle et couronne. Les distances ont ici tendance à augmenter davantage pour les navetteurs résidant sur le pôle. Sur l’aire de Nîmes, la hausse de la distance parcourue est importante à la fois pour les résidents de la ville de Nîmes et pour ceux habitant la couronne. Dans les aires de Toulouse, Montpellier et Perpignan, les trajets des ouvriers sont ceux qui se sont le plus allongés. Sur l’aire de Nîmes, ce sont les trajets des cadres.
tableauFigure 4 – Évolution des distances parcourues par les navetteurs entre 1990 et 2017 selon leur qualification et leur lieu de résidence
| AAV de Toulouse | AAV de Montpellier | AAV de Perpignan | AAV de Nîmes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cadres | pôle | - 1,2 | 1,0 | 3,4 | 11,5 |
| couronne | 3,1 | 4,1 | 2,2 | 5,5 | |
| Ensemble | 0,6 | 2,6 | 2,3 | 6,2 | |
| Employés | pôle | - 0,3 | 1,7 | 2,7 | 7,1 |
| couronne | 0,2 | 2,3 | 1,4 | 2,4 | |
| Ensemble | 0,0 | 1,7 | 2,1 | 2,8 | |
| Ouvriers | pôle | 0,3 | 1,6 | 3,2 | 13,9 |
| couronne | 2,9 | 3,9 | 2,2 | - 4,4 | |
| Ensemble | 1,7 | 3,3 | 2,5 | 4,9 | |
| Ensemble | pôle | - 0,4 | 1,9 | 3,3 | 3,9 |
| couronne | 2,1 | 3,4 | 1,9 | 3,5 | |
| Ensemble | 0,8 | 2,8 | 2,1 | 4,3 | |
- Lecture : entre 1990 et 2017, la distance parcourue par la moitié des cadres navetteurs résidant sur l’aire d’attraction de la ville (AAV) de Nîmes a augmenté de 6,2 km.
- champ : actifs en emploi de 15 ans ou plus déclarant se déplacer dans une autre commune pour aller travailler (navetteurs) dans une limite de 150 kilomètres. Sont exclus les actifs en emploi qui habitent et travaillent dans la même commune.
- Source : Insee, recensements de la population 1990 et 2017, navetteurs au lieu de résidence
Définitions
L’aire d’attraction d’une ville définit l’étendue de son influence sur les communes environnantes, mesurée par les déplacements domicile-travail. Une aire est composée d’un pôle, défini à partir de critères de densité de population et d’emploi, et d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Ce zonage permet d’étudier les disparités territoriales selon une approche fonctionnelle de la ville.
L'autocorrélation spatiale est utilisée pour réaliser la figure 1. La méthode d’association spatiale employée permet de regrouper des communes contiguës possédant une part élevée d’actifs en emploi qui y résident pour une catégorie socioprofessionnelle (CSP) donnée. Cette part doit être significativement plus forte que la part moyenne sur l’ensemble de l’aire. Les cartes produites ont pour finalité de faire ressortir des zones de forte présence d’une CSP pour un seuil de significativité fixé. Les communes figurent en blanc si la part de la CSP étudiée n’y est pas significativement plus élevée qu’en moyenne sur l’ensemble de l’aire, ou si elles se trouvent dans une situation isolée, à savoir que la part de la CSP étudiée y est élevée au seuil de significativité fixé, mais qu’elle ne l’est pas dans les communes avoisinantes.
La notion de ségrégation résidentielle considérée dans cette étude renvoie à l’idée d’une répartition non homogène des populations dans les différentes communes de l’aire d’attraction d’une ville en fonction de leurs catégories socioprofessionnelles. L’indicateur utilisé est l’indice de dissimilarité, qui évalue la part d’une catégorie socioprofessionnelle qui devrait changer de commune pour que la part de cette catégorie soit la même d’une commune à l’autre.
Pour cette analyse en évolution, les actifs en emploi qui habitent et travaillent dans la même commune sont exclus, car les déplacements en infra-communal n’étaient pas comptabilisés en 1990.
Pour en savoir plus
« Aires d’attraction des villes : des profils d’habitats et d’habitants variés », Insee Flash Occitanie n° 103, novembre 2020
« Toulouse, Montpellier, Perpignan, Nîmes : des schémas de déplacements domicile-travail différents d’une agglomération à l’autre », Insee Analyses Occitanie n° 89, décembre 2019
« La voiture, omniprésente pour les trajets domicile-travail, même les plus courts », Insee Analyses Occitanie n° 102, janvier 2021
« Ouvrir dans un nouvel ongletL’évolution de la ségrégation résidentielle en France : 1990-2015 », Document de travail France Stratégie n° 2020-09 juillet