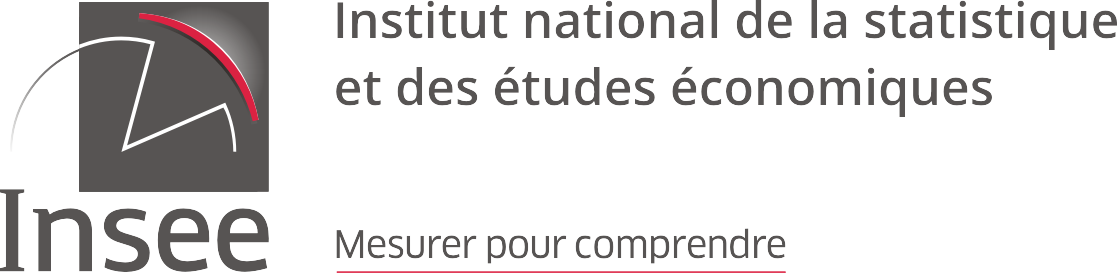Les territoires de la région face au défi du développement durable
Les territoires de la région face au défi du développement durable
Face au défi du développement durable, chaque territoire de la région est confronté à des problématiques différentes. Les grandes agglomérations sont ainsi particulièrement exposées à la pollution industrielle. D’autres espaces urbains, moins denses, sont davantage concernés par des enjeux liés aux déplacements ou à des tensions sur le logement. La région abrite également un patrimoine naturel riche qu’il s’agit de préserver. Enfin, de vastes espaces ruraux agricoles, exposés à une certaine pauvreté, posent des questions spécifiques en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
- Les grandes agglomérations, sensibles à la pollution industrielle et aux inégalités sociales
- Une zone urbanisée à enjeux autour des déplacements
- Des territoires résidentiels plutôt aisés, confrontés à des difficultés de logement
- Un patrimoine naturel en haute montagne à préserver
- Des territoires ruraux attractifs, exposés à la précarité et moins accessibles
- Un espace rural d’élevage bovin présentant des signes de fragilité sociale
- Un ensemble à dominante résidentielle plus dispersé géographiquement
- Les Objectifs de développement durable
La région Auvergne-Rhône-Alpes est structurée par deux principaux massifs montagneux (Alpes et Massif central) au patrimoine naturel riche, et quatre grandes agglomérations (Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand). Elle est traversée par des axes de circulation majeurs situés dans les vallées et plaines, où se concentrent de nombreux pôles d’emplois. Elle est ainsi particulièrement concernée par les trois dimensions du développement durable : environnementale, économique et sociale.
La diversité des territoires de la région suggère une approche locale du développement durable, à l’échelon des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Bien qu’hétérogènes, ils sont de taille suffisante pour faire ressortir les disparités territoriales, et constituent un espace de décision publique apte à porter des projets de développement.
À partir de plusieurs indicateurs éclairant certains des Objectifs de développement durable (ODD) (encadré) disponibles à cette échelle (méthodologie), sept types de territoires sont distingués au regard de leurs enjeux, reflétant en partie ces objectifs. L’ODD n° 11 concerne en revanche chacun des territoires.
Les grandes agglomérations, sensibles à la pollution industrielle et aux inégalités sociales
Les grandes agglomérations constituent un premier ensemble de territoires comprenant les quatre métropoles ainsi que l’agglomération d’Annemasse (sous influence de Genève) et celle de Villefranche Beaujolais Saône (figure 1). Ces intercommunalités, qui concentrent le tiers de la population régionale, se distinguent par un habitat très dense (figure 3). Les emplois offerts localement, largement tournés vers le secteur tertiaire, sont très qualifiés. Les cadres de fonctions métropolitaines (tels les chercheurs, avocats, ingénieurs d’étude...) totalisent 14 % de l'emploi, soit 4 points de plus que dans la région. Ces territoires concentrent également une intense activité industrielle à l'exception de l'agglomération d'Annemasse. Cette activité engendre notamment l'émission de divers gaz à effet de serre (GES) dont le CO2, entraînant à long terme des effets sur le climat. Les émissions sont en particulier élevées dans les agglomérations lyonnaise et grenobloise, où se situent des établissements de l’industrie pétrolière et chimique. L'activité industrielle expose ces zones à des risques pour l'environnement et la population très nombreuse qui y réside. On y trouve le tiers des établissements Seveso de la région, et la même proportion de déchets dangereux produits, en particulier à Villefranche où sont implantées des entreprises de l'industrie chimique et plastique.
tableauFigure 1 – Sept familles de territoires au regard des problématiques de développement durableTypologie des intercommunalités de la région Auvergne-Rhône-Alpes au regard d’indicateurs du développement durable
| Indicatrice | Epci | Classe | Typologie |
|---|---|---|---|
| 1 | 200029999 | 2 | Une zone urbanisée à enjeu autour des déplacements |
| 2 | 200040459 | 2 | |
| 3 | 200040491 | 2 | |
| 4 | 200040574 | 2 | |
| 5 | 200041010 | 2 | |
| 6 | 200042497 | 2 | |
| 7 | 200042901 | 2 | |
| 8 | 200059392 | 2 | |
| 9 | 200065894 | 2 | |
| 10 | 200066587 | 2 | |
| 11 | 200067627 | 2 | |
| 12 | 200067817 | 2 | |
| 13 | 200068542 | 2 | |
| 14 | 200068567 | 2 | |
| 15 | 200068781 | 2 | |
| 16 | 200069177 | 2 | |
| 17 | 200069193 | 2 | |
| 18 | 200070118 | 2 | |
| 19 | 200070431 | 2 | |
| 20 | 200070555 | 2 | |
| 21 | 200070753 | 2 | |
| 22 | 200070852 | 2 | |
| 23 | 200071199 | 2 | |
| 24 | 200071371 | 2 | |
| 25 | 200072098 | 2 | |
| 26 | 200073096 | 2 | |
| 27 | 240100610 | 2 | |
| 28 | 240100800 | 2 | |
| 29 | 240100883 | 2 | |
| 30 | 240100891 | 2 | |
| 31 | 242600252 | 2 | |
| 32 | 243800455 | 2 | |
| 33 | 243800604 | 2 | |
| 34 | 243800778 | 2 | |
| 35 | 243800844 | 2 | |
| 36 | 243800935 | 2 | |
| 37 | 243800984 | 2 | |
| 38 | 243801073 | 2 | |
| 39 | 243801255 | 2 | |
| 40 | 244200614 | 2 | |
| 41 | 244200630 | 2 | |
| 42 | 246301097 | 2 | |
| 43 | 246900575 | 2 | |
| 44 | 246900633 | 2 | |
| 45 | 246900740 | 2 | |
| 46 | 246900765 | 2 | |
| 47 | 247300528 | 2 | |
| 48 | 247300668 | 2 | |
| 49 | 247300676 | 2 | |
| 50 | 247400112 | 2 | |
| 51 | 200066637 | 4 | Un espace rural d’élevage bovin présentant des signes de fragilité sociale |
| 52 | 200066660 | 4 | |
| 53 | 200066678 | 4 | |
| 54 | 200069169 | 4 | |
| 55 | 200070761 | 4 | |
| 56 | 200071140 | 4 | |
| 57 | 200071215 | 4 | |
| 58 | 200071389 | 4 | |
| 59 | 200071405 | 4 | |
| 60 | 200071470 | 4 | |
| 61 | 200071496 | 4 | |
| 62 | 200071512 | 4 | |
| 63 | 200072080 | 4 | |
| 64 | 200073393 | 4 | |
| 65 | 200073401 | 4 | |
| 66 | 240300491 | 4 | |
| 67 | 240300558 | 4 | |
| 68 | 240300566 | 4 | |
| 69 | 240300657 | 4 | |
| 70 | 241500255 | 4 | |
| 71 | 241500271 | 4 | |
| 72 | 241501055 | 4 | |
| 73 | 241501089 | 4 | |
| 74 | 241501139 | 4 | |
| 75 | 244200820 | 4 | |
| 76 | 244301123 | 4 | |
| 77 | 246300966 | 4 | |
| 78 | 200035202 | 1 | Un ensemble à dominante résidentielle plus dispersé géographiquement |
| 79 | 200035731 | 1 | |
| 80 | 200040111 | 1 | |
| 81 | 200040350 | 1 | |
| 82 | 200040566 | 1 | |
| 83 | 200040657 | 1 | |
| 84 | 200042935 | 1 | |
| 85 | 200065886 | 1 | |
| 86 | 200068997 | 1 | |
| 87 | 200070407 | 1 | |
| 88 | 200070712 | 1 | |
| 89 | 200071082 | 1 | |
| 90 | 200071363 | 1 | |
| 91 | 200071751 | 1 | |
| 92 | 200072015 | 1 | |
| 93 | 200073419 | 1 | |
| 94 | 200073427 | 1 | |
| 95 | 240100578 | 1 | |
| 96 | 240700716 | 1 | |
| 97 | 240700815 | 1 | |
| 98 | 241500230 | 1 | |
| 99 | 244200622 | 1 | |
| 100 | 244200895 | 1 | |
| 101 | 244300307 | 1 | |
| 102 | 244301016 | 1 | |
| 103 | 244301032 | 1 | |
| 104 | 244301099 | 1 | |
| 105 | 244301107 | 1 | |
| 106 | 247300262 | 1 | |
| 107 | 200000172 | 5 | Des territoires résidentiels plutôt aisés, confrontés à des difficultés de logement |
| 108 | 200018166 | 5 | |
| 109 | 200033116 | 5 | |
| 110 | 200034098 | 5 | |
| 111 | 200034882 | 5 | |
| 112 | 200041366 | 5 | |
| 113 | 200066793 | 5 | |
| 114 | 200067551 | 5 | |
| 115 | 200068674 | 5 | |
| 116 | 200069110 | 5 | |
| 117 | 200071967 | 5 | |
| 118 | 240100750 | 5 | |
| 119 | 243801024 | 5 | |
| 120 | 244301131 | 5 | |
| 121 | 246900625 | 5 | |
| 122 | 246900724 | 5 | |
| 123 | 246900757 | 5 | |
| 124 | 247400047 | 5 | |
| 125 | 247400567 | 5 | |
| 126 | 247400583 | 5 | |
| 127 | 247400617 | 5 | |
| 128 | 247400666 | 5 | |
| 129 | 247400682 | 5 | |
| 130 | 247400690 | 5 | |
| 131 | 247400724 | 5 | |
| 132 | 247400740 | 5 | |
| 133 | 247400773 | 5 | |
| 134 | 200016905 | 6 | Des territoires ruraux attractifs mais exposés à la précarité et moins accessibles |
| 135 | 200030658 | 6 | |
| 136 | 200039808 | 6 | |
| 137 | 200039824 | 6 | |
| 138 | 200039832 | 6 | |
| 139 | 200040509 | 6 | |
| 140 | 200041465 | 6 | |
| 141 | 200067767 | 6 | |
| 142 | 200068229 | 6 | |
| 143 | 200071413 | 6 | |
| 144 | 200072007 | 6 | |
| 145 | 200073245 | 6 | |
| 146 | 240700302 | 6 | |
| 147 | 240700617 | 6 | |
| 148 | 240700864 | 6 | |
| 149 | 242600492 | 6 | |
| 150 | 242600534 | 6 | |
| 151 | 200011773 | 7 | Les grandes agglomérations, sensibles à la pollution industrielle et aux inégalités sociales |
| 152 | 200040590 | 7 | |
| 153 | 200040715 | 7 | |
| 154 | 200046977 | 7 | |
| 155 | 244200770 | 7 | |
| 156 | 246300701 | 7 | |
| 157 | 200023299 | 3 | Un patrimoine naturel en haute montagne à préserver |
| 158 | 200023372 | 3 | |
| 159 | 200040798 | 3 | |
| 160 | 200070340 | 3 | |
| 161 | 200070464 | 3 | |
| 162 | 243800745 | 3 | |
| 163 | 247300015 | 3 | |
| 164 | 247300254 | 3 | |
| 165 | 247300361 | 3 | |
| 166 | 247300452 | 3 | |
| 167 | 247300817 | 3 |
- Note : Les communes de la CC Enclave des Papes-Pays de Grignan, dont le siège est hors de la région, ne sont pas prises en compte. Pour les autres EPCI comprenant des communes de différentes régions, seuls les EPCI composés de communes majoritairement situées dans la région sont pris en compte ; pour ces EPCI, seules les communes de la région sont considérées.
- Sources : Insee (Recensement de la population, Base permanente des équipements, DADS, REE, Filosofi), Dreal, OREGES Auvergne-Rhône-Alpes, SDES, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), Office national des forêts (ONF), Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), Agences de l'eau, ADEME, MTES Direction générale de la prévention des risques - Registre français des émissions polluantes et base GASPAR
graphiqueFigure 1 – Sept familles de territoires au regard des problématiques de développement durableTypologie des intercommunalités de la région Auvergne-Rhône-Alpes au regard d’indicateurs du développement durable

- Note : Les communes de la CC Enclave des Papes-Pays de Grignan, dont le siège est hors de la région, ne sont pas prises en compte. Pour les autres EPCI comprenant des communes de différentes régions, seuls les EPCI composés de communes majoritairement situées dans la région sont pris en compte ; pour ces EPCI, seules les communes de la région sont considérées.
- Sources : Insee (Recensement de la population, Base permanente des équipements, DADS, REE, Filosofi), Dreal, OREGES Auvergne-Rhône-Alpes, SDES, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), Office national des forêts (ONF), Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), Agences de l’eau, ADEME, MTES Direction générale de la prévention des risques - Registre français des émissions polluantes et base GASPAR.
Relativement au nombre d’actifs impliqués, les émissions de CO2 liées aux déplacements domicile-travail sont toutefois en retrait, grâce à la densité du réseau de transports publics. Contrairement aux GES, les polluants émis sont susceptibles d’altérer la qualité de l’air au niveau local, même s’il n’y a pas de lien systématique entre les lieux de production et de stagnation des polluants. Selon l’indice ATMO, qui mesure la concentration journalière de quatre polluants caractéristiques des pollutions urbaines, la qualité de l’air est la plus dégradée à Lyon et Grenoble.
Les grandes agglomérations sont par ailleurs exposées à un enjeu en matière de cohésion sociale propre à la ville. Les inégalités de niveau de vie sont marquées et le taux de pauvreté élevé (15,2 % contre 12,7 % au niveau régional). Les écarts de niveaux de vie sont élevés à Annemasse, où le rapport entre le niveau de vie plancher des 10 % les plus aisés et celui plafond des 10 % les plus pauvres s’élève à 5,8 (contre 3,4 pour la région).
tableauFigure 3 – Des contrastes territoriaux au regard des différentes dimensions du développement durableQuelques indicateurs de développement durable
| Grandes agglomérations | Zones urbanisées à enjeux de déplacements | Territoires résidentiels plutôt aisés | Un patrimoine naturel en haute montagne | Territoires ruraux attractifs | Espaces ruraux d'élevage bovin | Territoires résidentiels dispersés | Auvergne-Rhône-Alpes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’EPCI | 6 | 50 | 27 | 11 | 17 | 27 | 29 | 167 |
| Part dans la population régionale ( en %) | 34 | 25 | 15 | 1 | 3 | 5 | 15 | 100 |
| Densité de population (habitants/km²) | 1 124 | 128 | 183 | 26 | 31 | 24 | 80 | 112 |
| Part de la population en zone de montagne (en %) | 22 | 21 | 65 | 100 | 69 | 50 | 54 | 37 |
| Part de la surface en Znieff (en %) | 34 | 42 | 55 | 83 | 64 | 49 | 49 | 51 |
| CO2 émis par les entreprises polluantes en tonnes/km² | 1 709 | 275 | 83 | 273 | 8 | 101 | 35 | 178 |
| Temps d'accès en minutes au plus près du trajet domicile-travail | 4 | 4,7 | 5,1 | 10 | 11,8 | 10 | 6,2 | 6,9 |
| Part modale de la voiture dans les déplacements domicile-travail (en %) | 60 | 83 | 79 | 66 | 80 | 78 | 82 | 74 |
| Part des cadres des fonctions métropolitaines dans l'emploi total (en %) | 14 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 |
| Taux de pauvreté (en %) | 15 | 11 | 9 | 11 | 18 | 16 | 13 | 13 |
| Rapport interdécile de niveau de vie* | 3,8 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 3,4 |
- * Rapport interdécile : rapport du niveau de vie plancher des 10 % les plus aisés et celui plafond des 10 % les plus pauvres
- Sources : Insee - Recensement de la Population, Insee/DGFiP/Cnaf/Cnav/CCMSA - Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), Dreal, MTES Direction générale de la prévention des risques - Registre français des émissions polluantes, Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)
Une zone urbanisée à enjeux autour des déplacements
Un deuxième ensemble est constitué d’intercommunalités également urbanisées, situées le long des axes de communication majeurs. Il couvre le quart du territoire et abrite autant d’habitants. Ces derniers résident pour moitié en couronne des grands pôles, notamment autour des métropoles lyonnaise et clermontoise. L’autre moitié réside principalement dans des pôles urbains, en particulier le long de la vallée du Rhône, comme dans les communautés d’agglomération (CA) de Valence, Montélimar, Romans et Vienne.
Dans ces territoires, les déplacements domicile-travail sont importants, et s’accompagnent d’un usage accru de la voiture. En outre, le transport de fret et la logistique pèsent dans l’économie locale, notamment sur la frange Est de la vallée du Rhône (CA de Montélimar), traversée par des axes autoroutiers. L’ensemble du secteur routier totalise 38 % des émissions de GES (figure 2) dans la zone, soit 5 points de plus que dans l’ensemble de la région.
À l’Est de l’agglomération lyonnaise, la zone est constituée de territoires comportant des zones humides ou les bassins versants des affluents du Rhône. Ces lieux d’accumulation des surplus générés par la fertilisation des cultures sont vulnérables à la pollution par les nitrates (43 % des surfaces sont concernées, contre 14 % dans la région).
Les activités à finalité environnementale, qui désignent un éventail d'activités incluant le traitement de l'eau et la collecte et traitement des déchets dangereux, sont également plus développées qu'ailleurs. Ces dernières totalisent 3 % de l’emploi dans les communautés de communes (CC) du Roussillonnais, du Pays Bellegardien et d’Entre Dore et Allier (contre 0,8 % dans la région). Plus généralement, la zone profite de créations d’entreprises dynamiques, en particulier dans l’Est lyonnais (Lyon-Saint Exupéry, CC des Vals du Dauphiné). Le taux de pauvreté est globalement assez faible et les niveaux de vie plutôt élevés et homogènes.
tableauFigure 2 – L'origine des émissions de gaz à effet de serre reflète la fonction économique des territoiresRépartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur (en %)
| Grandes agglomérations | Zones urbanisées à enjeux de déplacements | Territoires résidentiels plutôt aisés | Un patrimoine naturel en haute montagne | Territoires ruraux attractifs | Espaces ruraux d'élevage bovin | Territoires résidentiels dispersés | Auvergne-Rhône-Alpes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | 2 | 14 | 10 | 5 | 23 | 51 | 27 | 18 |
| Transport routier | 35 | 38 | 38 | 15 | 34 | 19 | 31 | 33 |
| Tertiaire | 14 | 6 | 17 | 12 | 9 | 3 | 9 | 9 |
| Résidentiel | 27 | 13 | 27 | 14 | 23 | 8 | 21 | 19 |
| Industrie et autres secteurs* | 23 | 28 | 9 | 53 | 11 | 19 | 12 | 22 |
- * Ensemble composé essentiellement des secteurs de l'industrie, de l'énergie, du traitement des déchets, du transport autre que routier.
- Source : OREGES Auvergne-Rhône-Alpes, 2015
Des territoires résidentiels plutôt aisés, confrontés à des difficultés de logement
Un autre ensemble homogène se compose d’intercommunalités situées majoritairement en Haute-Savoie, plus au Sud jusqu’au Grésivaudan, et en périphérie de grandes agglomérations. Cet ensemble de territoires très urbanisé se distingue par un environnement économique et social favorable. Il compte 15 % de la population régionale.
Les emplois proposés sont très qualifiés. La part des cadres des fonctions métropolitaines avoisine 11 % dans le Grand Annecy et atteint 18 % dans le Grésivaudan. Parallèlement, le niveau de vie moyen des ménages est élevé (24 000 € annuels, soit 3 000 € de plus qu’en moyenne) et le taux de pauvreté est faible. Toutefois, la zone est marquée par des inégalités de niveau de vie, en particulier dans la partie genevoise, en lien avec le travail transfrontalier. La présence de ces très hauts revenus contribue à la tension du foncier, avec un enjeu en matière de ségrégation sociale. Cela se traduit par des situations de sur-occupation de logements plus fréquentes qu’ailleurs, notamment dans le Genevois (CC de Faucigny-Glières, Cluses-Arve et Montagnes et du Genevois). Toutefois, le secteur de la construction est légèrement plus dynamique que dans l’ensemble de la région.
Exposée à des risques d’inondation (CC du Haut-Chablais, des Vallées de Thônes et des Montagnes du Giffre), plus d’une commune sur deux dans cette zone fortement urbanisée est pourvue d’un plan de prévention. Plus localement, la vallée de l’Arve est soumise à une pollution due à l’intense trafic routier, au chauffage à bois, aux transports et à l’industrie. De plus, la topographie ne favorise pas la dispersion des polluants dans cette zone. Celle-ci est encadrée par un plan de protection de l’atmosphère, comme les quatre métropoles régionales.
Un patrimoine naturel en haute montagne à préserver
Des intercommunalités, situées en altitude dans les Alpes du Nord, présentent des caractéristiques communes. Principalement constitué d’espaces naturels à protéger, ce territoire est classé pour 83 % de sa surface en zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (Znieff). Il abrite notamment deux parcs nationaux, la Vanoise et une partie des Écrins. Toutefois, la topographie de la zone l’expose à différents risques naturels (inondations, avalanches, mouvements de terrain, etc.). Près d’une commune sur deux est couverte par au moins un plan de prévention des risques d’inondation ou de mouvement de terrain pour réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.
Si la zone ne concentre que 1,4 % de la population régionale, elle connaît d’importants flux touristiques. Au total, 40 % de l’emploi local est consacré à ce secteur (et jusqu’à 61 % en Tarentaise). Cependant, l’industrie concentre plus de la moitié des émissions de GES. Relativement au nombre d’habitants, celles-ci sont très élevées dans les CC des Vallées d'Aigueblanche, de Cœur de Maurienne Arvan, de l’Oisans et de Maurienne Galibier. On y dénombre beaucoup d’emplois industriels, notamment dans la métallurgie (un tiers des emplois de l’industrie). Au nord de la zone, la CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, traversée par le tunnel éponyme, connaît un intense trafic routier. Le secteur des transports émet 41 % des GES sur cette zone.
Des territoires ruraux attractifs, exposés à la précarité et moins accessibles
Un autre groupe de territoires, où vit 3 % de la population régionale, est principalement composé d'intercommunalités de Drôme et d’Ardèche. Cette zone, majoritairement montagneuse, est soumise à un risque d’inondation, en particulier le versant ardéchois exposé aux épisodes cévenols.
Au sein de ce territoire à dominante rurale, l’activité agricole concentre 7 % de l’emploi, principalement autour de la culture viticole et fruitière et de l’élevage d’ovins, dont des filières de production et de consommation responsables. Le patrimoine naturel est un atout du territoire (deux tiers de sa surface sont classés en Znieff). Le Massif du Vercors, les Monts d’Ardèche ou les Gorges de l’Ardèche sont engagés dans des démarches de développement d’un tourisme durable. Ces sites d’intérêt concentrent jusqu’à 30 % d’emploi touristique. Ce patrimoine constitue un facteur d’attractivité comme le reflète l’installation de nombreuses personnes dans la région, notamment lors de leur retraite.
Le caractère rural et montagneux du territoire l’expose à des difficultés d’accessibilité. Le temps d’accès aux principaux équipements est plus élevé qu’ailleurs (en particulier dans les montagnes d’Ardèche, du Diois et des Baronnies), et la distance parcourue sur le trajet domicile-travail est légèrement supérieure à la moyenne régionale. Par ailleurs, la précarité est plus présente. Le taux de pauvreté s’élève à 18 % (soit 5 points de plus que dans la région). En effet, le taux de chômage et le recours au temps partiel sont importants. De plus, les ressources des ménages actifs les plus modestes appartiennent le plus souvent à des secteurs à revenus peu rémunérateurs (agriculture, artisanat, commerce).
Un espace rural d’élevage bovin présentant des signes de fragilité sociale
L’Ouest auvergnat constitue un autre espace rural, de très faible densité, regroupant 5 % des habitants de la région. L’élevage bovin y est prédominant et plus de la moitié des émissions de GES sont d’origine agricole. Relativement au nombre d’habitants, ces émissions sont très élevées, comme dans les CC des Pays de Salers, du Tronçais et d’Huriel. Toutefois, tout comme les autres secteurs, les émissions d’origine agricole ne peuvent s’apprécier qu’à un échelon global. En effet, sont comptabilisées pour le compte des espaces agricoles les émissions d’origine agricole nécessaires aux besoins en consommation alimentaire des zones les plus urbanisées.
Avec son pôle urbain, l’économie de l’agglomération de Moulins est plus diversifiée. Toutefois, elle comprend un territoire de bocage et d’élevage où la proportion d’émissions de GES liées au secteur agricole atteint 42 %. En revanche, dans la CC d’Ardèche Rhône Coiron, qui n’a pas de vocation agricole, le volume élevé de GES provient de sa spécialisation dans la production de ciment.
Outre sa fonction agricole, le territoire dispose d’un potentiel touristique, avec notamment trois stations de ski (Super-Besse, le Mont-Dore et le Lioran) situées dans le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, engagé dans la Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés. Le tourisme représente 5 % de l’emploi local, soit 1 point de plus que dans la région.
La population du territoire présente des signes de fragilité sociale à l’instar des autres territoires ruraux. Le niveau de formation des actifs est plus faible (24 % sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, soit 13 points de moins que dans la région). Le chômage de longue durée est également plus important, comme les situations de pauvreté. Enfin, les personnes de 65 ans ou plus sont plus nombreuses que les moins de 20 ans, provoquant un déséquilibre générationnel.
Un ensemble à dominante résidentielle plus dispersé géographiquement
Le dernier groupe rassemble des intercommunalités moins concentrées géographiquement et également moins spécifiques que les autres. Elles représentent 15 % de la population, majoritairement répartie dans des pôles urbains, à l’instar des CA du bassin de Bourg-en-Bresse, de Montluçon et du Roannais. Les autres intercommunalités de ce groupe, à dominante plus rurale, se trouvent principalement en couronne de pôles urbains (Loire Forez et Haut-Bugey notamment). Dans ces territoires, aucun enjeu fort de développement durable ne ressort particulièrement. Les niveaux de vie sont plus faibles que dans la région et les inégalités aussi. De manière générale, l'habitat, composé aux deux tiers de maisons, est assez diffus. Les situations de vacance de logement y sont plus fréquentes que dans la région (11 %, soit 3 points de plus). Dans ce contexte, la voiture est plus souvent utilisée pour les déplacements domicile-travail, mais les distances parcourues sont légèrement plus courtes qu’en moyenne. Le caractère résidentiel de la zone explique que 21 % des émissions de GES proviennent de l’habitat (principalement liées au mode de chauffage). Cette proportion dépasse 30 % dans les EPCI de la Matheysine, de Montluçon et du Plateau d'Hauteville. L’activité agricole, principalement due à l’élevage (EPCI du Haut-Lignon, du Pays de Montfaucon et du Bassin d’Aurillac), totalise plus du quart des émissions de GES, soit 9 points de plus que dans la région. Toutefois, relativement à la population résidente, les volumes d’émissions en jeu restent modérés dans la plupart des intercommunalités de la zone.
Les Objectifs de développement durable
Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) et leurs 169 cibles, ou sous-objectifs, ont été adoptés par les 193 États membres de l’ONU en septembre 2015. Ils rendent le concept de développement durable plus opérationnel et permettent de suivre les progrès dans ce domaine. Désormais, les trois dimensions du développement durable (environnementale, économique et sociale) sont intégrées de manière transversale. Les ODD couvrent l’intégralité des enjeux du développement durable tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation, etc.
Cette nouvelle feuille de route universelle sera le cadre structurant de la mise en œuvre du développement durable en France au cours des 15 prochaines années. Le suivi des indicateurs nationaux est coordonné par l’Insee. Seule une partie des ODD internationaux ont été retenus pour cette analyse (ODD n° 1, 4 à 12 et 15).

Pour comprendre
Méthodologie
Le regroupement des EPCI résulte d’une classification ascendante hiérarchique précédée d’une analyse en composantes principales. Cette méthode consiste à agréger deux à deux selon un processus itératif les EPCI dont le profil est le plus proche.
Les résultats de la typologie sont dépendants des indicateurs retenus dans l’analyse. L’ambition de ce découpage régional consiste à proposer un éclairage multidimensionnel du développement durable sous l’angle innovant des ODD. Il est toutefois limité par le fait que toutes les données ne sont pas disponibles à l’échelle communale : ainsi, certaines thématiques ne sont pas couvertes comme la consommation en ressources naturelles telle que l’eau, la production d’énergie, les énergies renouvelables, la biodiversité, la qualité de l’eau et celle de l’air. Pour cette dernière, quelques éléments peuvent être apportés en complément de la classification.
Pour en savoir plus
« Le Grand Lyon et le développement durable : synthèse et enjeux », Les Dossiers de l’Insee Rhône-Alpes, janvier 2014
« Pays du Mont-Blanc : des enjeux liés au logement et au développement durable », La Lettre Analyses, Insee Rhône-Alpes n° 208, novembre 2013
« Les indicateurs du développement durable en Auvergne », Insee Auvergne Repères, n° 41, septembre 2012