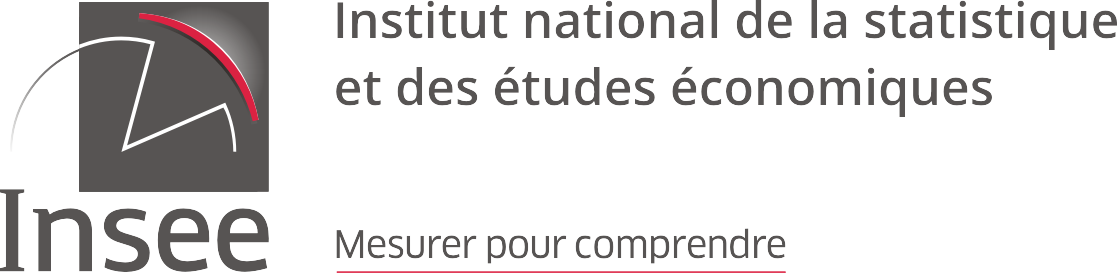Un ménage francilien sur quatre concerné par une forme de pauvreté
Un ménage francilien sur quatre concerné par une forme de pauvreté
En Île-de-France, la pauvreté monétaire touche 15,6 % de la population, soit 1,8 million de personnes au niveau de vie inférieur à 1 000 € par mois. Par ailleurs, la pauvreté administrative mesurée à travers le revenu de solidarité active (RSA) concerne 5,3 % de la population francilienne. La pauvreté peut également être appréhendée par les conditions de vie. Ainsi, 15,9 % des ménages franciliens déclarent des privations matérielles. Au global, un quart des ménages franciliens est touché par au moins une forme de pauvreté, et près de 2 % cumulent les trois formes. Les familles monoparentales, les personnes seules, en particulier les hommes, et les locataires font partie des ménages les plus concernés par la pauvreté. Depuis la fin des années 2000, la pauvreté a fortement augmenté dans la région.
- Les différentes formes de pauvreté
- 15,6 % de la population francilienne vit au-dessous du seuil de pauvreté
- Les jeunes et les familles monoparentales sont les plus exposés à la pauvreté monétaire
- Une pauvreté monétaire qui s’accentue
- Une augmentation de la pauvreté administrative quasi continue depuis 20 ans
- La pauvreté en conditions de vie touche près d’un ménage francilien sur six
- Un ménage francilien sur quatre est touché par une forme de pauvreté
- De fortes inégalités de revenus en Île-de-France
- Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (PPLPIS)
Les différentes formes de pauvreté
La notion de pauvreté recouvre différentes acceptions. Selon le Conseil européen de décembre 1984, sont considérées comme pauvres « les personnes dont les ressources (matérielles, culturelles et sociales) sont si faibles qu’elles sont exclues des modes de vie minimaux acceptables dans la société ». Or, la pauvreté est souvent mesurée du seul point de vue monétaire : une personne est considérée comme pauvre si son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté (définitions). La pauvreté peut également être étudiée sous un angle administratif par le biais des prestations sociales touchées, telles que le revenu de solidarité active (RSA), qui ont vocation à soutenir les personnes les plus démunies et ainsi atténuer les inégalités sociales. Enfin, une troisième approche, basée sur les conditions de vie, consiste à mesurer les difficultés que rencontrent les ménages dans leur vie quotidienne : payer les factures, trouver un logement ou encore se priver de certains biens matériels.
Ces trois approches peuvent être appréhendées en Île-de-France, en évolution temporelle et à travers les caractéristiques des personnes touchées par ces différentes formes de pauvreté.
15,6 % de la population francilienne vit au-dessous du seuil de pauvreté
D’un point de vue monétaire, en 2014, 1 876 000 Franciliens, soit 15,6 % de la population régionale, vivent sous le seuil de pauvreté (1 008 € par mois et par unité de consommation). La part des ménages pauvres est du même ordre. Le taux de pauvreté est supérieur d’un point à celui de la France métropolitaine et inférieur de deux points à celui des régions pour lesquelles ce taux est maximum (Corse et Hauts-de-France). L’Île-de-France se situe en 5e position parmi les 13 régions métropolitaines classées selon la part de personnes pauvres ; elle y occupait la 9e position cinq ans auparavant. Le taux de pauvreté francilien a augmenté de trois points depuis 2009, année de récession économique marquée par une hausse du chômage (figure 1).
Spécificité de la région, l’intensité de la pauvreté y est forte : le niveau de vie médian des personnes pauvres est seulement de 780 € par mois contre 800 € en France métropolitaine. Parmi la population pauvre, la moitié la plus défavorisée dispose ainsi de ressources plus faibles en Île-de-France qu’au niveau national. Dans la région, les populations très pauvres côtoient des populations aisées. Les disparités de revenus sont particulièrement marquées dans la région francilienne (De fortes inégalités de revenus en Île-de-France).
tableauFigure 1 – Les pauvretés progressent depuis 2009Évolution de la part des différents types de pauvreté depuis 2009 (en %)
| Pauvreté monétaire | Pauvreté monétaire (données France métropolitaine) | Pauvreté administrative (part de la population francilienne couverte par le RSA) | Pauvreté en conditions de vie (données France métropolitaine) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 12,5 | 13,5 | 4,1 | 12,6 | ||||
| 2010 | 13,27 | 14 | 4,3 | 13,3 | ||||
| 2011 | 13,55 | 14,3 | 4,4 | 12,5 | ||||
| 2012 | 14,97 | 14,2 | 4,7 | 11,9 | ||||
| 2013 | 15,37 | 13,8 | 5 | 12,6 | ||||
| 2014 | 15,6 | 14 | 5,2 | 12,8 | ||||
| 2015 | 14,2 | 5,4 | ||||||
| 2016 | 5,3 |
- Sources : Insee, revenus disponibles localisés 2009-2011, FiLoSoFi 2012-2014, Enquête revenus fiscaux et sociaux 2009 à 2015, statistiques sur les ressources et conditions de vie 2009-2014, Caisses d'Allocations Familliales 2009-2016.
graphiqueFigure 1 – Les pauvretés progressent depuis 2009Évolution de la part des différents types de pauvreté depuis 2009 (en %)

- Sources : Insee, revenus disponibles localisés 2009-2011, FiLoSoFi 2012-2014, Enquête revenus fiscaux et sociaux 2009 à 2015, statistiques sur les ressources et conditions de vie 2009-2014, Caisses d'Allocations Familliales 2009-2016.
Les jeunes et les familles monoparentales sont les plus exposés à la pauvreté monétaire
La pauvreté monétaire touche les différentes catégories de population de manière hétérogène. Les jeunes de moins de 30 ans sont les plus exposés (19,3 %) alors que les plus âgés le sont moins (7,3 % pour les 75 ans ou plus) (figure 2). Parmi les ménages pauvres, le niveau de vie médian des moins de 30 ans est de 740 € par mois, alors que celui des 75 ans ou plus est de 830 € par mois, soit un niveau légèrement supérieur au minimum vieillesse (792 € par mois pour une personne seule). Les jeunes font en effet face à des difficultés sur le marché du travail, favorisant les situations de précarité : le taux de chômage des jeunes est élevé et l’accès à un contrat stable s’opère souvent plus tard dans le cycle de vie.
Des disparités s’observent également selon la composition du ménage. Ainsi, une famille monoparentale sur quatre est pauvre. En effet, un seul revenu ne permet pas toujours au parent isolé de subvenir aux besoins de la famille. Les couples avec enfant(s) peuvent se retrouver également en situation de vulnérabilité lorsqu’un parent perd son emploi. De fait, la pauvreté monétaire concerne 13,8 % des couples avec enfant(s), contre 6,0 % des couples sans enfant. Cette dernière catégorie de ménages, dans laquelle figurent les couples de retraités, est la plus protégée face à la pauvreté. Enfin, le taux de pauvreté des hommes vivant seuls dépasse de près de quatre points celui des femmes seules (15,2 % contre 11,3 %). Les hommes vivant seuls sont plus fréquemment en situation de vulnérabilité que les femmes seules du fait de leur plus jeune âge. Ces dernières sont plus âgées et bénéficient notamment plus souvent d’une retraite ou d’une pension de réversion de leur conjoint décédé. Parmi la population pauvre, les hommes vivant seuls ont un niveau de vie médian à peine supérieur à 700 € par mois (figure 3).
S’agissant des conditions de logement, la pauvreté monétaire concerne 25,4 % des locataires en Île-de-France et seulement 5,7 % des propriétaires. Le niveau de vie médian de ces locataires pauvres, de 777 € par mois, est le plus faible des régions métropolitaines. Les locataires franciliens disposant de faibles ressources doivent de surcroît faire face à la cherté des loyers et au risque d’expulsion qui découle de la difficulté à payer. Entre 2013 et 2015, le nombre d’expulsions locatives a augmenté de 4 % dans la région. En Île-de-France, l’ensemble des locataires du parc privé consacrent 23 % de leurs revenus (incluant le versement des aides au logement) au paiement du loyer, mais 10 % d’entre eux y consacrent presque la moitié de leurs revenus.
Enfin, le chômage est moins élevé en Île-de-France qu’en France métropolitaine, mais avoir un emploi ne protège pas de la pauvreté : 12,9 % de la population des ménages ayant des revenus principalement constitués de salaires sont pauvres.
tableauFigure 2 – Les familles avec enfants plus exposées à la pauvretéTaux de pauvreté en Île-de-France (en %)
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Ensemble | 15,6 | 15,4 | 15,0 |
| Hommes seuls | 15,2 | 14,6 | 14,1 |
| Femmes seules | 11,3 | 11,6 | 11,1 |
| Propriétaires | 5,7 | 5,6 | 5,4 |
| Locataires | 25,4 | 25,1 | 24,5 |
| Couples sans enfant | 6,0 | 5,9 | 5,9 |
| Couples avec enfants | 13,8 | 13,5 | 12,9 |
| familles monoparentales | 24,9 | 25,0 | 24,0 |
| Ménages dont le référent fiscal a : | |||
| moins de 30 ans | 19,3 | 19,5 | 18,5 |
| 75 ans ou plus | 7,3 | 7,3 | 8,0 |
| Ménages dont la ressource principale est : | |||
| indemnités chômage | 53,2 | 51,5 | 50,0 |
| salaires | 12,9 | 12,7 | 12,3 |
| revenus non salariaux | 19,7 | 18,8 | 17,7 |
| pensions, retraites et rentes | 11,7 | 11,6 | 12,3 |
- Source : Insee, FiLoSoFi, 2012 à 2014.
tableauFigure 3 – Les hommes seuls ont les revenus les plus faibles parmi les personnes pauvresMédiane des niveaux de vie mensuels des ménages pauvres en Île-de-France, en euros
| Médiane | |
|---|---|
| Ensemble | 778 |
| Femmes seules | 762 |
| Hommes seuls | 706 |
| Familles monoparentales | 787 |
| Couples sans enfant | 796 |
| Couples avec enfants | 784 |
| 75 ans ou plus | 832 |
| Moins de 30 ans | 738 |
- L’âge des personnes correspond à celui du référent fiscal du ménage.
- Lecture : la moitié des hommes seuls pauvres perçoit moins de 706 € mensuels tandis que la moitié des femmes seules pauvres perçoit moins de 762 € mensuels.
- Source : Insee, FiLoSoFi 2014.
graphiqueFigure 3 – Les hommes seuls ont les revenus les plus faibles parmi les personnes pauvresMédiane des niveaux de vie mensuels des ménages pauvres en Île-de-France, en euros

- L’âge des personnes correspond à celui du référent fiscal du ménage.
- Lecture : la moitié des hommes seuls pauvres perçoit moins de 706 € mensuels tandis que la moitié des femmes seules pauvres perçoit moins de 762 € mensuels.
- Source : Insee, FiLoSoFi 2014.
Une pauvreté monétaire qui s’accentue
Entre 2012 et 2014, la pauvreté monétaire a progressé de 0,6 point en Île-de-France, alors qu’elle a légèrement reculé au niveau de la France métropolitaine (- 0,2 point). Elle s’est surtout accentuée pour les hommes seuls, les couples avec enfant(s) et les familles monoparentales. Les retraités ne sont pas concernés par cette hausse de la pauvreté, contrairement aux actifs. Dans le même temps, la part des ménages contributeurs à l’impôt sur le revenu a baissé de 5 points (68,4 % contre 73,6 %), traduisant une certaine fragilisation de leur situation financière. Le système de redistribution (exonération d’impôts et taxes, allocations) permet toutefois de réduire les situations de pauvreté.
Une augmentation de la pauvreté administrative quasi continue depuis 20 ans
Les minima sociaux versés aux plus démunis constituent le principal marqueur administratif de la pauvreté. Ainsi, le RSA socle est versé aux personnes n’ayant aucune activité (545 € pour une personne seule). Les travailleurs pauvres peuvent percevoir un complément de revenu : la prime d’activité qui remplace depuis le 1er janvier 2016 le RSA activité et la prime pour l’emploi.
En décembre 2014, le RSA socle a été versé par les Caf d’Île-de-France à près de 328 200 allocataires, représentant 5,7 % des ménages franciliens. En prenant en compte les personnes couvertes par cette prestation au sein du foyer (conjoint, enfants), cela concerne 627 700 personnes, soit 5,3 % de la population francilienne, contre 5,5 % en France métropolitaine. En 20 ans, la part de la population couverte par cette prestation (RMI puis RSA socle) a augmenté de deux points. Après une stabilisation au milieu des années 2000, le nombre de bénéficiaires du RSA socle augmente de nouveau depuis 2009, malgré la mise en place du plan de lutte contre la pauvreté (Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale).
La pauvreté en conditions de vie touche près d’un ménage francilien sur six
La pauvreté est un phénomène multidimensionnel pouvant être appréhendé par les conditions de vie. Percevoir un revenu minimum ou disposer de plus de 1 000 € par mois pour une personne seule ne permet pas toujours de se nourrir et de se soigner correctement, d’autant plus que le non-recours à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) est assez fréquent en Île-de-France.
En 2014, 15,9 % des ménages franciliens se déclarent pauvres en conditions de vie, soit trois points de plus qu’en France métropolitaine (figure 4). Les prix, plus élevés de 9 % en Île-de-France que dans les autres régions de métropole, augmentent les risques de privations matérielles. Ainsi, un quart des Franciliens déclarent disposer de ressources insuffisantes (remboursements supérieurs à un tiers des revenus, fréquence élevée de découverts bancaires, absence d’épargne, recours aux économies...) et sont contraints à des économies pour équilibrer leur budget. Plus d’un Francilien sur dix déclare devoir restreindre sa consommation, par exemple renoncer à financer une semaine de vacances dans l’année ou remplacer des meubles abîmés. Par ailleurs, les Franciliens ont plus fréquemment des difficultés de logement que dans d’autres régions : habiter dans un logement trop petit ou bruyant sont des contraintes fréquemment citées. Les loyers impayés ou les retards de paiement sont plus fréquents en Île-de-France qu’en moyenne en France métropolitaine.
La pauvreté en conditions de vie évolue peu depuis 2005, alors que les pauvretés monétaire et administrative ont fortement augmenté sur la période. La privation, notion plus subjective, peut être ressentie différemment selon le contexte économique ou selon les normes de la société. Toutefois, la part des ménages déclarant avoir des ressources insuffisantes s’est accrue sur la période.
graphiqueFigure 4 – Les trois types de pauvreté concernent un quart des ménages franciliensPart des ménages franciliens touchés par une forme de pauvreté (en %)

- Lecture : le nombre de ménages percevant le RSA n'est pas un indicateur couramment utilisé par les Caf, il peut cependant être estimé par l'enquête statistique sur les ressources et conditions de vie.
- Sources : Insee, enquête statistique sur les ressources et conditions de vie 2014, FiLoSoFi 2014.
Un ménage francilien sur quatre est touché par une forme de pauvreté
En Île-de-France, un quart des ménages est touché par une forme de pauvreté, que ce soit au sens monétaire, administratif ou en conditions de vie.
Les trois formes de pauvreté ne se recouvrent pas totalement. À titre d’illustration, les deux tiers des ménages franciliens pauvres en conditions de vie disposent de revenus supérieurs au seuil de pauvreté. Il peut s’agir par exemple de ménages endettés ou ayant des remboursements supérieurs à un tiers de leur revenu. À l’inverse, un peu plus de la moitié des ménages franciliens ayant un niveau de vie inférieur à 1 000 € ne se considère pas pauvre en conditions de vie. Ce peut être des ménages n’ayant pas de loyers à payer, ni de crédits à rembourser. Ils disposent alors de ressources suffisantes pour satisfaire leurs besoins matériels. La pauvreté administrative est, quant à elle, souvent synonyme d’une autre forme de pauvreté : cinq ménages sur six percevant le RSA ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté ou sont confrontés à des difficultés matérielles. Les conditions restrictives d’attribution du RSA et le non-recours à cette prestation expliquent qu’une partie de la population pauvre n’est pas identifiée au sens administratif alors qu’elle peut l’être en pauvreté monétaire ou en conditions de vie. Par ailleurs, la pauvreté administrative appréhendée dans cette étude concerne uniquement le RSA socle alors qu’il existe d’autres prestations sociales destinées à des personnes en situation de précarité.
Pour autant, de manière générale, les profils de population touchés par les trois formes de pauvreté sont les mêmes : les personnes seules, les familles monoparentales, les locataires et les moins diplômés sont les plus exposés. Toutefois, les locataires et les familles monoparentales sont plus forte- ment représentés dans la pauvreté en conditions de vie que dans la pauvreté monétaire. Leurs difficultés monétaires se traduisent par des restrictions matérielles fortes. À l’inverse, les propriétaires sont moins concernés par la pauvreté en conditions de vie. Ils disposent généralement de revenus plus élevés et, lorsqu’ils n’ont plus d’emprunt en cours, leur budget est moins contraint.
Les familles avec trois enfants ou plus sont également moins représentées parmi les pauvres en conditions de vie. Outre les prestations familiales, elles peuvent bénéficier des avantages liés aux familles nombreuses pour certaines dépenses.
Comme au niveau national, seulement moins de 2 % des ménages franciliens cumulent les trois formes de pauvreté : monétaire, conditions de vie et administrative (bénéficiaires du RSA). Il s’agit essentiellement de personnes locataires de leur logement, d’inactifs et de personnes sans diplôme.
De fortes inégalités de revenus en Île-de-France
La moitié de la population francilienne vit avec moins de 1 880 € par mois et par unité de consommation. Ce niveau de vie médian est supérieur au niveau national (1 700 €). Toutefois, il masque de fortes inégalités. En Île-de-France, le niveau de vie au-dessus duquel se situent les 10 % des personnes les plus aisées est 4,5 fois supérieur à celui au-dessous duquel se trouvent les 10 % les plus modestes (respectivement 3 870 € et 850 € par mois). À titre de comparaison, ce rapport interdécile est de 3,5 en France métropolitaine.
Ces disparités de revenus ont encore été accentuées après la crise de 2008. Entre 2007 et 2014, le niveau de vie des 10 % des personnes les plus pauvres a stagné tandis que celui des 10 % les plus aisées a augmenté de 10,7 %. Cet écart s’est creusé plus particulièrement en 2010 et 2011.
Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (PPLPIS)
Le Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (PPLPIS) a été adopté le 21 janvier 2013 lors du Comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE), à l’issue d’une vaste concertation et d’un diagnostic partagé sur les causes de la pauvreté et les moyens de venir en aide aux plus fragiles. Ce plan, qui vise à la fois à répondre à l’urgence sociale du moment et à structurer la politique de lutte contre la pauvreté sur le long terme, s’articule autour de trois grands axes : réduire les inégalités et prévenir les ruptures, venir en aide et accompagner vers l’insertion, coordonner l’action sociale et valoriser ses actions. Il repose sur six principes directeurs : objectivité, non-stigmatisation, participation, juste droit, décloisonnement des politiques sociales et accompagnement des personnes. Une mission d’évaluation et de suivi de la mise en œuvre du plan a été mise en place afin de mesurer l’impact des mesures proposées, à travers la mise en place d’un tableau de bord d’indicateurs à même de rendre compte de la montée en charge du plan et de son impact sur les populations concernées.
À l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère (17 octobre 2017), le Président de la République vient de lancer une nouvelle politique de lutte contre la pauvreté qui ciblera l’enfance et la jeunesse en particulier.
Définitions
Niveau de vie : revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d’un même ménage. Le nombre d’UC est calculé selon l’échelle d’équivalence dite de l’OCDE modifiée : le premier adulte compte pour 1, les autres personnes de 14 ans ou plus pour 0,5 et les enfants de moins de 14 ans pour 0,3.
Revenu disponible : il comprend les revenus déclarés à l’administration fiscale (revenus d’activité, retraites et pensions, indemnités de chômage et certains revenus du patrimoine), les revenus financiers non déclarés, qui sont imputés, les prestations sociales perçues et la prime pour l’emploi. Tous ces revenus sont nets des impôts directs (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, contribution sociale généralisée, contribution à la réduction de la dette sociale et autres prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine).
Pauvreté monétaire : un individu (ou un ménage) est considéré comme pauvre lorsque son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Ce seuil est fixé à 60 % du niveau de vie médian en métropole. Il est évalué à partir de FiLoSoFi (Fichier localisé social et fiscal) à près de 1 008 € par mois en 2014.
Intensité de la pauvreté : elle permet d’apprécier à quel point le niveau de vie de la population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté (écart relatif entre le niveau de vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté).
Pauvreté administrative : elle correspond à une reconnaissance institutionnelle de la pauvreté, à travers les minima sociaux versés aux personnes en situation de précarité, comme le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation adulte handicapé (AAH), le minimum vieillesse ou l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Dans cette étude, la pauvreté administrative est restreinte au RSA socle.
Ce dispositif, entré en vigueur le 1er juin 2009 en France métropolitaine, se substitue au revenu minimum d’insertion (RMI créé en 1988) et à l’allocation de parent isolé (API). Le revenu de solidarité active est une allocation qui complète les ressources initiales du foyer pour qu’elles atteignent le niveau d’un revenu garanti. Le RSA socle peut être majoré, sous certaines conditions, pour les parents isolés.
Pauvreté en conditions de vie : le taux de pauvreté en conditions de vie est un indicateur qui permet d’identifier l’absence de bien-être matériel ou la présence de difficultés dans la vie quotidienne, à l’échelle d’un ménage. 27 indicateurs de privations issus de l’enquête SRCV (statistiques sur les ressources en conditions de vie) ont été retenus pour mesurer le taux de pauvreté en conditions de vie.
Un ménage est considéré comme pauvre en conditions de vie s’il déclare cumuler au moins 8 difficultés sur les 27 retenues. Ces indicateurs de privations sont répartis en 4 groupes : les contraintes budgétaires, les retards de paiement, les restrictions de consommation et les difficultés de logement.
Pour en savoir plus
« Taux de pauvreté en conditions de vie et de difficultés par grandes dimensions en 2016 », Insee Chiffres-Clés, octobre 2017.
Argouarc’h J., Cazenave-Lacrouts M.-C., « Les niveaux de vie en 2015 », Insee Première n° 1665, septembre 2017.
Chemineau D., Fayard B., « Ouvrir dans un nouvel ongletDonnées statistiques allocataires relatives à la pauvreté et à la précarité en Île-de-France en 2015 », Ctrad, août 2016.