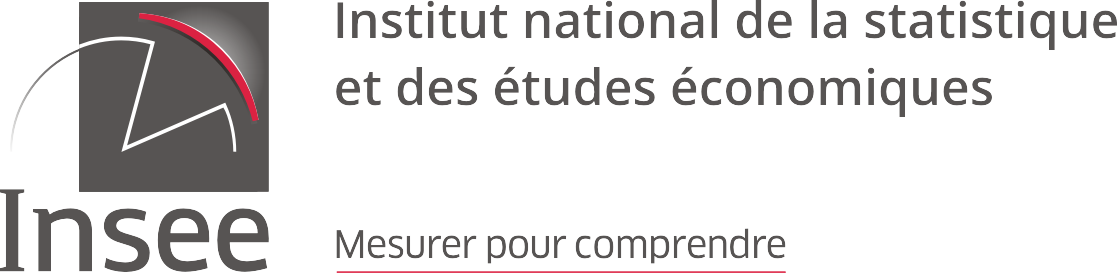Les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France La pauvreté comme dénominateur commun, mais des profils socio-démographiques différents
Les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France La pauvreté comme dénominateur commun, mais des profils socio-démographiques différents
La réforme de la politique de la ville cible de façon précise les quartiers les plus en difficulté socio-économique à partir des revenus de leurs habitants. Aujourd’hui, 1,6 million de personnes résident dans les 272 quartiers de la politique de la ville franciliens, dont plus du tiers vit sous le seuil de pauvreté. Si tous les QPV sont touchés par la précarité monétaire, ils présentent pourtant des réalités diverses en matière d’inégalités de revenus, de taille des territoires, de localisation géographique et d’accès aux équipements. Ces caractéristiques ont permis de les classer en six groupes homogènes favorisant la mise en œuvre d’actions publiques différenciées.
- Davantage d’étrangers et beaucoup de familles nombreuses dans les QPV franciliens
- La fragilité sociale est plus présente dans les QPV que dans leur environnement proche
- Des petits quartiers au sein de grandes villes, moins en difficulté que la moyenne des QPV franciliens (groupe A)
- Des quartiers vieillissants aux franges de Paris (groupe B)
- Des quartiers parisiens avec plus de mixité, mais aussi une grande intensité de la pauvreté (groupe C)
- Des quartiers de familles en grande difficulté et éloignés du cœur de l’agglomération parisienne (groupe D)
- Les grands quartiers « historiques » de la politique de la ville (groupe E)
- Des petits quartiers homogènes en termes de revenu, situés dans des territoires moins urbanisés et plutôt jeunes (groupe F)
- La réforme de la politique de la ville
La nouvelle géographie prioritaire recentre la politique de la ville au profit des territoires les plus en difficulté. Elle est définie sur la base du critère unique de la concentration urbaine de la pauvreté, appréhendée par le niveau de revenu des habitants sur un périmètre géographique d’au moins 1 000 habitants. Cette refonte uniformise l’identification des quartiers politique de la ville et resserre leurs contours. Ainsi, 272 quartiers politique de la ville (QPV) ont été retenus dans 160 communes franciliennes (La réforme de la politique de la ville) alors que la région comptait 157 zones urbaines sensibles (ZUS) avant la révision de la géographie prioritaire. Aujourd’hui, 1,6 million de Franciliens vivent dans un quartier politique de la ville, soit 13 % de la population régionale (contre 8 % en France métropolitaine). Cette part atteignait 11 % avant la réforme.
Les quartiers de la politique de la ville franciliens, de tailles diverses, sont présents dans l’ensemble de la région, mais sont néanmoins concentrés au nord de la métropole parisienne, en cohérence avec la distribution spatiale des revenus. La Seine-Saint-Denis comprend un quart de ces QPV et 40 % de la population francilienne vivant dans ces quartiers (figure 1). Dans ce département où les revenus des ménages sont les plus bas de France, quatre habitants sur dix vivent dans un QPV contre deux sur dix auparavant dans les ZUS. C’est aussi le seul département francilien où l’ensemble des communes contenant auparavant une ZUS a conservé au moins un quartier politique de la ville. De plus, la commune du Bourget est entrée dans le dispositif. A contrario, seuls 6 % de la population des QPV résident désormais dans les Hauts-de-Seine, essentiellement dans le nord du département, soit deux fois moins que la part que représentaient les habitants des Hauts-de-Seine dans la population des anciennes ZUS.
tableauFigure 1 – Parmi les habitants des QPV franciliens, deux sur cinq résident en Seine-Saint-Denis
| Nombre de QPV | Population vivant dans un QPV | Ensemble de la population | Part de la population vivant en QPV (en %) | Part de la population vivant en ZUS en 2006 (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 20 | 147 000 | 2 229 600 | 7 | 6 |
| Hauts-de-Seine | 21 | 103 000 | 1 591 400 | 6 | 11 |
| Seine-Saint-Denis | 63 | 602 000 | 1 552 500 | 39 | 21 |
| Val-de-Marne | 42 | 140 000 | 1 354 000 | 10 | 11 |
| Seine-et-Marne | 24 | 91 000 | 1 365 000 | 7 | 6 |
| Yvelines | 22 | 107 000 | 1 418 500 | 8 | 8 |
| Essonne | 39 | 149 000 | 1 253 900 | 12 | 14 |
| Val-d'Oise | 41 | 208 000 | 1 211 100 | 17 | 16 |
| Île-de-France | 272 | 1 547 000 | 11 976 000 | 13 | 11 |
- Source : Insee, recensements de la population 2006 et 2013.
Davantage d’étrangers et beaucoup de familles nombreuses dans les QPV franciliens
Par définition, les contours des QPV correspondent aux zones où le revenu médian par unité de consommation est le plus faible d’Île-de-France. La plupart d’entre eux sont par conséquent situés dans des communes ou des espaces plus restreints où les revenus sont parmi les plus bas de la région (figure 2). Le niveau de vie mensuel médian (définitions) dans les QPV franciliens s’élève à 1 140 euros, soit 150 euros au-dessus du seuil de pauvreté, mais 710 euros au-dessous du niveau de vie médian de la région. Il correspond au seuil du niveau de vie en deçà duquel se trouvent les 20 % de Franciliens les plus pauvres. Le niveau de vie médian des QPV franciliens est légèrement supérieur à celui des QPV de France métropolitaine (de 66 euros par mois), mais cet écart est peu significatif au regard du surcoût de la vie en Île-de-France, notamment celui du logement. Le taux de pauvreté dans les QPV franciliens (37 %) est également plus faible que dans l’ensemble des QPV métropolitains (42 %). Toutefois, sur ce critère, les QPV franciliens présentent, eux aussi, un fort contraste par rapport à leur environnement.
À l’instar du niveau de vie médian, les revenus disponibles sont plus élevés dans les QPV franciliens qu’en province, en raison notamment d’une meilleure insertion de la population résidente sur le marché du travail, en particulier pour les femmes. En effet, 51 % des femmes âgées de 15 à 64 ans habitant dans les QPV franciliens ont un emploi (contre 42 % des femmes des QPV métropolitains), en lien avec un niveau de formation plus élevé. Parmi la population non scolarisée âgée de plus de 15 ans habitant les QPV franciliens, 69 % n’ont aucun diplôme ou ont un diplôme inférieur au bac (contre 75 % dans l’ensemble des QPV métropolitains).
À l’image des caractéristiques de la région, la part des résidents de nationalité étrangère est plus élevée dans les QPV franciliens (25 % contre 19 % dans l’ensemble des QPV métropolitains). De même, la part des familles nombreuses (ménages de 5 personnes ou plus), est également supérieure en région parisienne (19 % contre 14 % dans l’ensemble des QPV métropolitains).
graphiqueFigure 2 – Les QPV de la métropole du Grand Paris sont situés dans des zones où le niveau de vie est faible

- * Carreaux de 200 m, rayon de lissage de 800 m. L'information représentée provient d'au moins 200 ménages.
- Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2012.
La fragilité sociale est plus présente dans les QPV que dans leur environnement proche
En 2012, le niveau de vie médian des habitants des QPV franciliens n’atteint que les deux tiers de celui des habitants des communes englobant ces quartiers. La part des ménages non imposés dans les QPV franciliens (53 %) dépasse largement celle observée en moyenne au sein de ces communes (27 %).
La population des quartiers prioritaires, par rapport à celle de la commune dans laquelle elle se situe, est dans l’ensemble plus jeune et plus souvent confrontée à des situations économiques et sociales difficiles. Ainsi, la part des familles monoparentales, des familles nombreuses et des bénéficiaires de l’allocation chômage y est plus élevée. Le taux de pauvreté (37 %) dépasse de 15 points celui des communes englobantes. Les personnes bénéficiant de dispositifs sous conditions de ressources (couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), aides au logement, RSA) sont surreprésentées dans ces quartiers.
Toutefois, si les QPV partagent, par définition, la caractéristique d’être fortement exposés à la précarité monétaire, ils ne forment pas pour autant un ensemble totalement homogène. À l’aune d’un ensemble de critères portant sur le revenu, les équipements disponibles dans les communes englobantes, la superficie des quartiers et leur population (Méthodologie : typologie des QPV franciliens), les 272 QPV franciliens peuvent être classés en six groupes (figure 3 et figure 4 et données complémentaires).
graphiqueFigure 3 – Six types de quartiers prioritaires de la ville au sein de la métropole du Grand Paris

- Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier Localisé Social et Fiscal 2012 ; Insee, recensement de la population 2013, estimation démographique 2010 ; Caisse Nationale d'Allocations Familiales (31/12/2014), Base Permanente des Équipements 2014.
tableauFigure 4 – Des réalités nuancées dans les différents groupes de quartiers politique de le ville
| Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D | Groupe E | Groupe F | Ensemble des QPV franciliens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structure des ménages des QPV | |||||||
| Part des familles monoparentales dans les ménages | 17 | 16 | 11 | 17 | 16 | 14 | 16 |
| Part des ménages imposés | 51 | 47 | 39 | 38 | 46 | 47 | 47 |
| Part des ménages de 5 personnes ou plus | 20 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 19 |
| Part des ménages d'1 personne | 28 | 36 | 15 | 26 | 28 | 26 | 30 |
| Structure par âge | |||||||
| Part des moins de 15 ans | 26 | 22 | 19 | 28 | 25 | 28 | 25 |
| Part des 15-24 ans | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| Part des 25-59 ans | 46 | 47 | 51 | 44 | 46 | 47 | 47 |
| Part des 60 ans ou plus | 12 | 17 | 16 | 12 | 13 | 10 | 13 |
| Composition du revenu disponible | |||||||
| Part des revenus d'activités dans le revenu disponible | 78 | 72 | 81 | 70 | 75 | 79 | 76 |
| Part des pensions et rentes dans le revenu disponible | 16 | 21 | 16 | 16 | 17 | 13 | 17 |
| Part des revenus du patrimoine dans le revenu disponible | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Part de l'ensemble des prestations sociales | 14 | 14 | 10 | 21 | 15 | 16 | 15 |
| dont part des prestations familiales | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| dont part des minima sociaux | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| dont part des prestations logement | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Part des impôts | -11 | -11 | -14 | -9 | -11 | -11 | -11 |
| Prestations sociales | |||||||
| Part de la population bénéficiant de prestations sociales | 65 | 59 | 53 | 68 | 65 | 65 | 64 |
| Part de la population bénéficiant de la CMU-C | 13 | 13 | 10 | 17 | 15 | 11 | 14 |
| Part des allocataires dont le revenu est constitué à plus de 50 % de prestations sociales | 61 | 68 | 60 | 79 | 70 | 59 | 67 |
| Part des allocataires dont le revenu est constitué à 100 % de prestations sociales | 35 | 44 | 39 | 47 | 44 | 34 | 41 |
| Indicateurs de revenu annuel (en euros) | |||||||
| Médiane du revenu disponible | 32 200 | 28 600 | 31 200 | 28 800 | 31 100 | 31 600 | 30 900 |
| Médiane du niveau de vie | 14 500 | 13 800 | 14 000 | 12 700 | 13 400 | 14 000 | 13 700 |
| 1er quartile du niveau de vie | 10 900 | 9 900 | 9 400 | 9 500 | 9 900 | 10 600 | 10 000 |
| 3e quartile du niveau de vie | 18 700 | 18 600 | 20 500 | 16 500 | 17 900 | 18 000 | 18 200 |
| Médiane du niveau de vie des ménages pauvres | 9 400 | 8 800 | 8 400 | 9 100 | 9 000 | 9 300 | 9 000 |
| Indicateurs de pauvreté | |||||||
| Taux de pauvreté à 60 % | 31 | 37 | 38 | 43 | 39 | 34 | 37 |
| Rapport interdécile | 2,9 | 3,4 | 4,8 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 3,2 |
| Intensité de la pauvreté | 21,0 | 25,8 | 29,2 | 23,7 | 24,0 | 21,6 | 24,0 |
- Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2012 ; Insee, recensement de la population 2013, estimation démographique 2010 ; Caisse Nationale d'Allocations Familiales (31/12/2014).
Des petits quartiers au sein de grandes villes, moins en difficulté que la moyenne des QPV franciliens (groupe A)
Ce premier ensemble compte 93 QPV totalisant 295 000 habitants, soit 19 % de la population francilienne concernée.
Les habitants de ce groupe sont plutôt moins défavorisés sur le plan économique et social que ceux des autres groupes. Les deux tiers de la population en âge de travailler occupent un emploi.
Le niveau de vie des habitants y est en moyenne plus élevé que dans les autres QPV franciliens. La moitié d’entre eux disposent de plus de 14 500 euros par an pour subvenir à leurs besoins, soit près de 800 euros de plus que pour la moyenne des QPV. Les inégalités de revenus y sont également moins prononcées, les 10 % les plus aisés ayant un niveau de vie 2,9 fois supérieur aux 10 % les plus pauvres. Le taux de pauvreté (31 %) y est le plus faible des six groupes. Les communes dans lesquelles sont situés ces quartiers sont par ailleurs relativement bien pourvues en équipements destinés aux jeunes et aux seniors. Il s’agit le plus souvent de communes de grande taille, telles que Évry, Bagneux, Argenteuil et Noisy-le-Grand.
Des quartiers vieillissants aux franges de Paris (groupe B)
Un deuxième groupe, composé de 44 QPV et peuplé de 144 000 habitants (soit 9 % de la population vivant dans les QPV franciliens) se caractérise par une population plus âgée qu’en moyenne. En effet, les personnes de 60 ans ou plus et celles vivant seules y sont surreprésentées.
Par conséquent, la part des pensions et retraites dans le revenu disponible y est plus importante. Un peu plus de la moitié de la population en âge de travailler y occupe un emploi. Le niveau de vie médian des habitants de ces quartiers (13 800 euros) est proche de la moyenne des QPV franciliens et c’est aussi le cas du taux de pauvreté (37 %). La dispersion des niveaux de vie est assez élevée : les 10 % les plus aisés ont un niveau de vie 3,4 fois supérieur aux 10 % les plus pauvres.
Ces quartiers sont en majorité situés dans la ceinture parisienne, quartiers faubouriens aux portes de Paris, et dans des communes de la petite couronne, bien équipées pour les jeunes et les seniors (Nanterre, Colombes, Saint-Denis, Drancy, Bagnolet).
Des quartiers parisiens avec plus de mixité, mais aussi une grande intensité de la pauvreté (groupe C)
Un troisième ensemble est formé de 33 QPV, en moyenne un peu plus peuplés que les précédents (150 000 habitants, soit 10 % de la population des QPV franciliens). Il a la particularité de présenter une plus grande mixité sociale que dans les autres groupes, avec à la fois des ménages très modestes (six ménages sur dix ne sont pas imposés) et des ménages plus favorisés disposant même d’un certain patrimoine.
Les niveaux de vie au sein de ce groupe sont ainsi les plus hétérogènes. Si la moitié de la population dispose d’un niveau de vie de plus 14 000 euros par an, les inégalités sont plus prononcées : les 10 % les plus aisés disposent d’un revenu 4,8 fois plus élevé que les 10 % les plus pauvres. La proportion d’enfants de moins de 15 ans est assez faible alors que les 25-59 ans sont surreprésentés. De ce fait, 81 % du revenu disponible des ménages provient des revenus d’activité et 60 % de la population en âge de travailler occupe un emploi.
Malgré ces disparités, le taux de pauvreté (38 %) est comparable à celui de l’ensemble des QPV franciliens. Toutefois, la moitié de la population pauvre vit avec moins de 8 400 euros par an, niveau inférieur à celui de la population pauvre des autres groupes.
La part des familles monoparentales est par ailleurs moins importante que dans l’ensemble des QPV.
La majorité des quartiers « politique de la ville » parisiens figure dans cette classe. Ces quartiers situés dans la capitale (Goutte d’or, « cités » du 13e arrondissement notamment), représentent presque un quart de la population de ce groupe.
Des quartiers de familles en grande difficulté et éloignés du cœur de l’agglomération parisienne (groupe D)
Le quatrième ensemble se compose de 31 QPV, peuplés de 137 000 habitants, soit 9 % de la population vivant dans les QPV franciliens. Dans ces quartiers, souvent éloignés du cœur de l’agglomération parisienne, vivent des familles fortement exposées à la pauvreté et aux difficultés sociales. Les habitants y sont plutôt jeunes : plus du quart d’entre eux a moins de 15 ans. Les familles nombreuses et les bénéficiaires de prestations sociales y sont surreprésentées.
Un peu plus du tiers seulement de la population en âge de travailler est en emploi mais, parmi ces actifs occupés, 19 % sont des travailleurs précaires. Dans ce contexte de difficultés économiques, la population bénéficie largement de la CMU-C et de prestations sociales (prestations familiales, minima sociaux et prestations logement). Celles-ci représentent plus de la moitié du revenu disponible pour huit allocataires sur dix.
Le niveau de vie des habitants (12 700 euros par an) est le plus faible des six groupes. Le taux de pauvreté (43 %) y est également le plus prononcé.
Les QPV de ce groupe appartiennent en majorité à des communes de Seine-et-Marne : Meaux, Melun, Provins ou encore Nemours.
Les grands quartiers « historiques » de la politique de la ville (groupe E)
Le plus peuplé de ces six ensembles compte 42 QPV, totalisant 731 000 habitants, soit 47 % de la population vivant dans les QPV franciliens.
Ce groupe est composé des grands quartiers « historiques » de la politique de la ville, tant en termes de population que de superficie, dans des communes bien équipées pour les seniors.
Les caractéristiques socio-démographiques des habitants de ces quartiers sont assez proches de celles de l’ensemble des QPV franciliens, avec toutefois une part un peu plus importante de grands ménages (21 % contre 19 % pour l’ensemble des QPV franciliens).
Dans ces quartiers, 39 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. La moitié de la population en âge de travailler occupe un emploi.
On retrouve, entre autres, dans ce groupe les quartiers du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie, du Parc à Nanterre, les cinq quartiers des Mureaux, de la Grande Borne et de Grigny 2 à Grigny. Ces quartiers ont été classés d’intérêt national par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et bénéficient du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Dans ce groupe figurent aussi de nombreux grands quartiers de la Seine-Saint-Denis et de l’est du Val-d’Oise, mais également deux grands quartiers parisiens regroupant 23 % de la population des quartiers prioritaires de Paris : les Portes du Vingtième, composé de plusieurs sous-quartiers avec de nombreuses coupures urbaines (périphérique, échangeur) et le quartier « Porte Montmartre-Porte des Poissonniers-Moskova », constitué de trois secteurs distincts.
Des petits quartiers homogènes en termes de revenu, situés dans des territoires moins urbanisés et plutôt jeunes (groupe F)
Enfin, le dernier groupe rassemble 29 QPV et 89 000 habitants, soit 6 % de la population vivant dans les QPV franciliens.
Comme pour le quatrième groupe, les quartiers prioritaires de cet ensemble sont en majorité situés en grande couronne, dans des communes moins bien équipées pour les jeunes et les seniors. C’est le cas notamment du quartier de la Renardière à Roissy-en-Brie, Bois de l’Étang à La Verrière, les Lévriers à Montmagny. La population de ce groupe est plutôt jeune : la part des moins de 15 ans y est importante (28 %). Les niveaux de vie des habitants des quartiers de ce groupe sont dans la moyenne des QPV franciliens et faiblement dispersés. Les 10 % des habitants les plus aisés ont un niveau de vie 2,9 fois supérieur à celui des 10 % les plus pauvres. Dans ces quartiers, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Aux âges actifs, 57 % de la population occupe un emploi.
La réforme de la politique de la ville
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a introduit une nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville. Celle-ci a pour objectif de recentrer l’action publique sur les quartiers les plus en difficulté. Les quartiers de la politique de la ville ont été définis au sein des unités urbaines de 10 000 habitants ou plus sur la base de deux critères. Un quartier doit avoir un nombre minimal d’habitants et un revenu médian très inférieur à celui de son unité urbaine d’appartenance. Le revenu fiscal a été retenu comme critère synthétique de fragilité suite à la concertation nationale « Quartiers, engageons le changement », conduite en 2012. Les travaux de définition ont été menés par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) à partir de données carroyées de l’Insee issues des revenus fiscaux localisés de 2011.
Les quartiers de la politique de la ville remplacent les zonages formés par les zones urbaines sensibles (ZUS) et les contrats urbains de cohésion sociale (CUCS). 1 296 quartiers sont situés en France métropolitaine, 140 dans les départements d’outre-mer et environ 80 en Polynésie française et à Saint-Martin. Cette étude se limite aux quartiers franciliens.
Le contrat de ville est l’outil de gouvernance et de stratégie territoriale. Il repose sur trois piliers : le développement de l’activité économique et de l’emploi, la cohésion sociale, et l’amélioration du cadre de vie des habitants des quartiers. Il coordonne au niveau de chaque ville les orientations et les engagements des partenaires institutionnels, économiques et associatifs. Les habitants des quartiers de la politique de la ville sont directement associés à l’élaboration, au suivi et au pilotage du contrat de ville. Des conseils citoyens sont créés dans les territoires de la politique de la ville. Ils ont pour mission d’être des lieux d’échange entre habitants, de développer leur expertise d’usage, d’assurer leur représentation dans toutes les instances du contrat de ville et de constituer un espace permettant de valoriser les initiatives locales.
Le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), mis en œuvre par l’ANRU, concentre l’effort public sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus graves, selon des critères d’état du parc de logements, de sa diversité, de mixité des activités, de disponibilité foncière, d’ouverture du quartier et d’accès au transport, de la qualité de l’environnement urbain. Parmi les 200 quartiers classés en quartiers d’intérêt national par l’ANRU, 58 sont situés en Île-de-France.
Pour comprendre
Typologie des QPV franciliens
L’analyse porte sur les 272 quartiers politique de la ville franciliens. L’objectif de la typologie est de constituer des groupes de quartiers relativement homogènes et en nombre limité à partir d’indicateurs issus de la source FiLoSoFi 2012 et de la Base Permanente des Équipements 2014.
Les 12 indicateurs utilisés comme variables actives de la classification sont :
- la dispersion du revenu disponible (rapport de l’écart interquartile à la médiane) ;
- la part des revenus d’activités dans le revenu disponible ;
- la part des revenus du patrimoine dans le revenu disponible ;
- la part des prestations familiales dans le revenu disponible ;
- la part des prestations logement dans le revenu disponible ;
- la part des minima sociaux dans le revenu disponible ;
- la part des ménages imposés ;
- le niveau de vie médian des ménages pauvres (intensité de la pauvreté) ;
- le nombre d’unités de consommation ;
- le taux d’équipement « jeunes adultes » de la commune englobant le QPV ;
- le taux d’équipement « seniors » de la commune englobant le QPV ;
- la superficie du QPV.
Les paniers « jeunes adultes » et « seniors » sont construits à partir de la BPE 2014 et des besoins en équipement de ces deux catégories de population. Pour calculer les taux d’équipement, on recense la présence de ces équipements dans la commune.
Panier « jeunes adultes » : maternité, agence de proximité Pôle emploi, centre de formation d’apprentis, cinéma, agence de travail temporaire, spécialiste gynécologie médicale, bassin de natation, athlétisme, gare sous convention CD ou STIF, école de conduite, salle ou terrain spécialisé, plateau extérieur ou salle multisports, tennis.
Panier « seniors » : urgences, soins à domicile, spécialiste cardiologie, bassin de natation, laboratoire d’analyses médicales, magasin d’optique, hébergement des personnes âgées, pharmacie, services d’aides aux personnes âgées, masseur kinésithérapeute, médecin omnipraticien, infirmier, boulodrome, plateau extérieur ou salle multisports.
Cette typologie a été réalisée à l’aide d’une « classification ascendante hiérarchique ». Elle permet de regrouper les quartiers qui se ressemblent le plus, tout en maximisant les différences entre les groupes.
Sources
Les statistiques présentées ici sont issues du Fichier Localisé Social et Fiscal (FiLoSoFi) de 2012, issu du rapprochement des données fiscales exhaustives en provenance de la Direction générale des finances publiques (déclaration de revenus des personnes physiques, taxe d’habitation et fichier d’imposition des personnes physiques) et des données sur les prestations sociales émanant des organismes gestionnaires de ces prestations (Cnaf, Cnav, MSA). Ce rapprochement permet de reconstituer un revenu déclaré et un revenu disponible avec les prestations réellement perçues. Le champ couvert est celui de l’ensemble des ménages fiscaux ordinaires : il exclut les personnes sans domicile ou vivant en institution (prisons, foyers, maisons de retraite...). Les indicateurs portant sur les revenus déclarés/disponibles sont calculés sur le champ des ménages dont le revenu déclaré est positif ou nul.
Définitions
Niveau de vie : revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d’un même ménage. Le nombre d’UC est calculé selon l’échelle d’équivalence dite de l’OCDE modifiée : le premier adulte compte pour 1, les autres personnes de 14 ans ou plus pour 0,5 et les enfants de moins de 14 ans pour 0,3.
Le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épargner. Il comprend les revenus d’activité (salaires, revenus d’activités non salariées), les revenus de remplacement (retraites et pensions, indemnités de chômage, indemnités de maladie), les revenus du patrimoine (dont en particulier les revenus financiers, qui sont imputés pour ceux qui ne sont pas soumis à déclaration, les revenus fonciers, les revenus accessoires, etc.) et les prestations sociales reçues (prestations familiales, minima sociaux et prestations logement). Au total de ces ressources, quatre impôts directs sont déduits : l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Intensité de la pauvreté : permet de déterminer à quel point le niveau de vie de la population est éloigné du seuil de pauvreté.
Pour en savoir plus
Ouvrir dans un nouvel ongletLes quartiers parisiens de la politique de la ville, principales données de l’observatoire des quartiers prioritaires - Contrat de ville 2015-2020, Apur, janvier 2016.
Drieux S., Martinez C., « 13 % de la population francilienne vit dans un quartier de la politique de la ville », Insee Flash Île-de-France n° 10, mai 2016.
Renaud A., Sémécurbe F., « Les habitants des quartiers de la politique de la ville : la pauvreté côtoie d’autres fragilités », Insee Première n° 1593, mai 2016.
Musiedlak Y., « Les ZUS franciliennes : un paysage contrasté », Insee Île-de-France à la page n° 356, mai 2011.