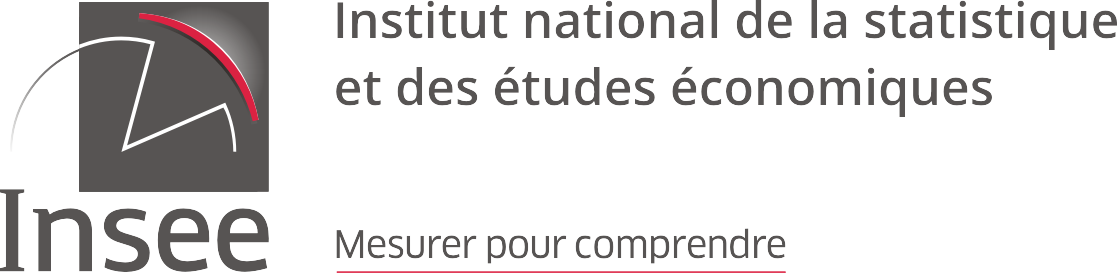En 2009, la consommation des ménages résiste malgré la récession
En 2009, la consommation des ménages résiste malgré la récession
En 2009, durant la récession, la dépense de consommation des ménages résiste : elle continue de progresser, à un rythme toutefois modeste (+ 0,6 % en volume après + 0,5 % en 2008). Le pouvoir d’achat des ménages, quant à lui, accélère (+ 1,6 % après + 0,4 %) sous l’effet d’une très forte décélération des prix (− 0,6 % après + 2,9 %). Mais les ménages accroissent leur épargne, probablement pour des motifs de précaution. Les achats d’automobiles neuves, soutenus par la prime à la casse, et les souscriptions en assurance-vie, dynamiques car de nouveau attractives face aux autres produits de placement, font figure d’exception, alors que la plupart des autres achats décélèrent.
- En 2009, les dépenses des ménages progressent à un rythme faible
- Rebond des achats d’automobiles neuves
- Repli des dépenses de chauffage
- Les services de télécommunications en baisse
- Faible croissance pour les biens et services de loisirs
- L’assurance-vie et les biens et services de santé en hausse
- La consommation alimentaire se redresse faiblement, les achats de vêtements se contractent
- Les produits énergétiques, alimentaires et les services financiers à l’origine du recul de l’inflation en 2009
En 2009, les dépenses des ménages progressent à un rythme faible
En 2009, la dépense de consommation des ménages en volume continue d’augmenter à un rythme modeste : + 0,6 % après + 0,5 % en 2008. La consommation finale effective des ménages est un concept plus large qui inclut des dépenses directement financées par la collectivité. Elle est un peu plus soutenue (+ 0,9 % pour les deux années) car la dépense de consommation individualisable des administrations publiques progresse de + 2,0 % en 2009. En cette année de récession, elle résiste donc et constitue le principal soutien de l’activité : elle contribue positivement pour 0,6 point à l’évolution du produit intérieur brut, alors que celui-ci baisse de 2,6 %.
En valeur, le revenu disponible brut des ménages décélère (+ 1,0 %, après + 3,2 % en 2008), mais leur pouvoir d’achat accélère à + 1,6 % après + 0,4 % en 2008 (graphique 1). Le prix de leurs dépenses de consommation baisse en effet de − 0,6 % après + 2,9 % en 2008 (encadré).
Cette augmentation du pouvoir d’achat est celle mesurée à partir de la masse totale des revenus perçus des ménages. Mesuré au niveau individuel, c’est-à-dire rapporté au nombre d’unités de consommation, le pouvoir d’achat progresse en moyenne de 0,8 %, après avoir baissé de 0,4 % en 2008. Une fois déduites les dépenses « pré-engagées », le pouvoir d’achat du revenu arbitrable par unité de consommation croît à un rythme similaire (+ 0,9 %), alors qu’il avait davantage reculé l’année précédente (− 1,1 %).
Malgré l’accélération du pouvoir d’achat, la consommation n’a que modestement progressé : les ménages ont augmenté leur taux d’épargne de 0,8 point à 16,2 % en 2009 (tableau 1), sans doute pour des motifs de précaution face notamment à la forte dégradation du marché du travail.
graphiqueGraphique 1 – Évolutions de la dépense des ménages, du pouvoir d'achat du revenu disponible brut et du taux d'épargne

- Source : Insee, comptes nationaux, base 2000.
tableauTableau 1 – Évolutions de la consommation, des prix, du revenu et taux d'épargne
| en % | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation effective (en volume) | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 0,9 | 0,9 |
| Dépense de consommation (en volume) | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 0,5 | 0,6 |
| Prix de la consommation effective | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,6 | − 0,1 |
| Prix de la dépense de consommation | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 2,9 | − 0,6 |
| Pouvoir d'achat du revenu disponible brut ajusté | 1,1 | 2,5 | 1,5 | 2,4 | 2,8 | 0,7 | 1,6 |
| Pouvoir d'achat du revenu disponible brut | 0,8 | 2,6 | 1,6 | 2,6 | 3,1 | 0,4 | 1,6 |
| Taux d'épargne (en % du revenu disponible brut) | 15,8 | 15,8 | 14,9 | 15,1 | 15,5 | 15,4 | 16,2 |
| Taux d'épargne financière (en % du revenu disponible brut) | 6,6 | 6,2 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 6,8 |
- Source : Insee, comptes nationaux, base 2000.
Rebond des achats d’automobiles neuves
En 2009, les achats d’automobiles rebondissent nettement : + 8,3 %, après − 6,9 % (tableau 2). La mise en place de la prime à la casse en décembre 2008 dope les achats de voitures neuves (+ 18,0 %), aux dépens des véhicules d’occasion (− 11,8 %). Les petites cylindrées ont le vent en poupe, les ménages profitant à la fois de l’opportunité de la prime à la casse et de l’avantage du bonus écologique. Les marques françaises en bénéficient grâce à leur bon positionnement sur les petits modèles : la part des voitures de marques françaises dans les immatriculations passe de 52,8 % en 2008 à 53,9 % en 2009. Les achats en volume de carburants continuent de diminuer : − 2,1 % après − 2,5 % en 2008. Ce repli est d’autant plus notable que le prix des carburants baisse très nettement (− 17,4 %) sous l’effet de la chute des cours du pétrole. Il s’explique, pour partie, par la tendance à la « diésélisation » du parc.
Malgré un marché automobile bien orienté, les dépenses de transports reculent, en volume, pour la deuxième année consécutive : − 0,3 % après − 2,3 % en 2008. Ce repli est imputable à la chute des dépenses de transports collectifs (− 2,2 %) après quatre années de hausses soutenues, ainsi que des transports aériens (− 4,2 %) et des transports ferroviaires (− 5,7 %). Le trafic aérien se contracte notamment sous l’effet du repli du nombre de voyages touristiques des résidents français, tant en France qu’à l’international. L’activité de la branche TGV de la SNCF est également en retrait par rapport aux années précédentes.
tableauTableau 2 – Consommation de biens durables
| en % | ||||||
| Évolution en volume | Poids dans la valeur de la consommation en 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Automobiles | 3,0 | − 2,1 | 4,3 | − 6,9 | 8,3 | 3,4 |
| Automobiles neuves | 3,4 | − 4,2 | 3,3 | − 5,7 | 18,0 | 2,5 |
| Autres automobiles 1 | 2,3 | 2,5 | 6,2 | − 9,3 | − 12,1 | 0,9 |
| Téléviseurs | 31,7 | 49,9 | 51,1 | 24,7 | 35,1 | 0,5 |
| Réfrigérateurs, congélateurs | 2,5 | 7,3 | − 0,6 | 0,0 | − 0,1 | 0,2 |
| Lave-linge | 4,2 | 7,0 | 7,7 | 2,1 | − 2,5 | 0,1 |
| Meubles | 4,8 | 1,6 | 4,5 | − 3,1 | − 3,9 | 1,3 |
| Autres biens durables 2 | 16,0 | 13,5 | 12,8 | 5,3 | 2,4 | 2,4 |
| Ensemble des biens durables | 8,4 | 5,8 | 9,3 | − 0,4 | 5,5 | 7,9 |
- 1. Échanges standard de moteurs et véhicules d'occasion comprenant les véhicules de démonstration, les véhicules appartenant aux loueurs et les véhicules des ménages lorsque la vente est réalisée par des intermédiaires (dans ce cas sont comptées uniquement les marges réalisées par l'intermédiaire).
- 2. Matériel téléphonique, lecteurs de DVD, lave-vaisselle, appareils de cuisson, caravanes, cycles et motocycles, etc.
- Source : Insee, comptes nationaux, base 2000.
Repli des dépenses de chauffage
En 2009, les dépenses que les ménages consacrent au logement, à son chauffage et à son éclairage ralentissent (+ 1,0 % après + 1,9 %), mais leur part dans les dépenses des ménages progresse légèrement : elle atteint 19,7 % de leur consommation effective en valeur, après 19,5 % en 2008. Ce poste représente 75 % des dépenses « pré-engagées », sur lesquelles les ménages peuvent difficilement arbitrer à court terme. La part de ces dernières dans le revenu disponible brut des ménages se replie toutefois pour la première fois depuis 2005 : elle perd 0,4 point à 28,2 % en 2009. Cette baisse s’explique par la chute du prix des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (encadré).
En valeur, les loyers directement pris en charge par les ménages progressent au même rythme qu’en 2008, à + 3,6 %. En revanche, les aides au logement augmentent moins vite qu’en 2008 (+ 5,7 % après + 8,5 %). Les prix des loyers décélèrent encore légèrement : + 1,8 % après + 2,0 % en 2008 et + 3,3 % en 2007. D’une part, l’indice de référence des loyers progresse moins vite ; d’autre part, les hausses lors des changements de locataire sont moins importantes que les années antérieures.
Les dépenses de chauffage et d’éclairage en volume se retournent à la baisse en 2009 : − 1,8 % après + 4,3 % (tableau 3). Les prix se replient également du fait du fioul domestique (− 27,2 %), qui a suivi la tendance des cours du pétrole brut. L’électricité fait exception : les volumes de consommation et les prix augmentent (respectivement + 1,0 % et + 1,9 %).
tableauTableau 3 – Évolution de la consommation des ménages par fonction
| en % | |||||||||
| Poids dans la valeur de la consommation effective | Évolution en volume | Évolution en prix | Valeur 2009 (en milliards d'euros) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Consommation effective des ménages | 100,0 | 100,0 | 2,4 | 0,9 | 0,9 | 2,0 | 2,6 | − 0,1 | 1 418,6 |
| dont : | |||||||||
| Dépense de consommation des ménages, dont : | 77,5 | 76,5 | 2,5 | 0,5 | 0,6 | 2,0 | 2,9 | − 0,6 | 1 084,6 |
| Alimentation et boissons non alcoolisées | 11,3 | 10,4 | 1,6 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 4,9 | − 0,1 | 147,8 |
| Produits alimentaires, dont : | 10,5 | 9,6 | 1,5 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 5,1 | − 0,3 | 135,8 |
| pain et céréales | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 5,7 | 0,8 | 20,8 |
| viandes | 3,1 | 2,7 | 0,6 | − 1,2 | − 0,3 | 2,0 | 4,5 | 1,3 | 38,4 |
| poissons et crustacés | 0,9 | 0,8 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 1,2 | 2,6 | − 0,7 | 12,0 |
| lait, fromages et oeufs | 1,6 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 9,7 | − 1,5 | 21,3 |
| fruits et légumes | 1,8 | 1,7 | 0,9 | − 0,7 | − 0,1 | 2,1 | 2,8 | − 2,9 | 23,5 |
| Boissons non alcoolisées | 0,8 | 0,8 | 3,0 | − 1,0 | 2,4 | 1,9 | 3,6 | 1,7 | 12,0 |
| Boissons alcoolisées et tabac | 2,7 | 2,2 | − 0,4 | − 2,4 | − 0,3 | 1,9 | 3,7 | 2,2 | 31,5 |
| Boissons alcoolisées | 1,3 | 1,1 | 1,2 | − 2,4 | 0,0 | 1,2 | 3,5 | 3,1 | 15,3 |
| Tabac | 1,4 | 1,1 | − 1,9 | − 2,4 | − 0,6 | 2,6 | 3,9 | 1,4 | 16,3 |
| Articles d'habillement et chaussures | 4,3 | 3,3 | 2,4 | − 1,6 | − 3,1 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 47,4 |
| Articles d'habillement | 3,5 | 2,7 | 2,5 | − 1,9 | − 4,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 38,4 |
| Chaussures | 0,8 | 0,6 | 1,6 | − 0,1 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 9,1 |
| Logement, chauffage, éclairage, dont : | 18,5 | 19,7 | 1,2 | 1,9 | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 0,9 | 279,2 |
| location de logement | 13,5 | 14,6 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 3,3 | 2,0 | 1,8 | 206,8 |
| chauffage, éclairage | 2,8 | 2,8 | − 3,6 | 4,3 | − 1,8 | 2,3 | 9,2 | − 5,0 | 39,7 |
| Équipement du logement, dont : | 4,8 | 4,5 | 4,6 | 0,1 | − 2,4 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 64,2 |
| meubles, tapis | 1,3 | 1,1 | 4,6 | − 3,1 | − 4,5 | 2,3 | 2,6 | 1,4 | 15,8 |
| appareils ménagers | 0,7 | 0,6 | 4,9 | 3,1 | − 0,5 | − 1,9 | − 2,1 | − 0,1 | 9,1 |
| Santé, dont : | 2,6 | 2,9 | 4,9 | 5,8 | 4,4 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 41,1 |
| médicaments | 1,2 | 1,3 | 6,2 | 8,4 | 6,3 | − 1,4 | − 1,1 | − 1,4 | 18,6 |
| médecine non hospitalière | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 4,1 | 3,6 | 2,3 | 1,5 | 0,8 | 16,8 |
| Transport, dont : | 11,9 | 10,9 | 2,5 | − 2,3 | − 0,3 | 2,5 | 5,4 | − 2,6 | 154,6 |
| achats de véhicules | 3,6 | 2,8 | 4,4 | − 6,1 | 6,5 | 1,5 | 1,0 | − 1,2 | 40,1 |
| carburants, lubrifiants | 2,7 | 2,3 | 1,0 | − 2,5 | − 2,1 | 1,8 | 12,9 | − 17,4 | 32,0 |
| services de transports | 1,5 | 1,7 | 3,8 | 3,6 | − 2,2 | 1,5 | 3,0 | 3,2 | 23,4 |
| Communications (t), dont : | 1,7 | 2,1 | 6,3 | 3,2 | − 0,4 | − 1,8 | − 0,4 | 0,0 | 29,2 |
| services de télécommunications | 1,3 | 1,8 | 6,1 | 3,3 | − 0,4 | − 1,1 | 0,5 | 0,6 | 25,9 |
| Loisirs et culture, dont : | 7,1 | 7,0 | 6,6 | 2,5 | 2,9 | − 2,4 | − 1,7 | − 2,3 | 98,9 |
| appareils électroniques et informatiques (t) | 1,7 | 1,5 | 19,5 | 8,7 | 13,3 | − 13,8 | − 12,8 | − 13,4 | 20,8 |
| services culturels et récréatifs | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 37,7 |
| presse, livres et papeterie | 1,2 | 0,9 | 0,6 | − 1,1 | − 1,9 | 1,7 | 2,0 | 3,1 | 13,5 |
| Éducation | 0,5 | 0,7 | 1,9 | 0,9 | 2,2 | 4,2 | 6,3 | 9,1 | 9,4 |
| Hôtels, cafés et restaurants | 4,8 | 4,7 | 2,1 | − 2,2 | − 2,6 | 2,8 | 2,9 | 1,6 | 66,2 |
| Autres biens et services, dont : | 8,5 | 8,7 | 1,9 | − 0,4 | 2,0 | 5,6 | 2,9 | − 4,6 | 122,9 |
| soins personnels | 1,9 | 1,8 | 2,8 | − 0,3 | − 1,4 | 1,2 | 2,3 | 1,5 | 24,9 |
| action sociale | 1,3 | 1,4 | 5,2 | 0,5 | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 3,3 | 20,1 |
| assurances | 2,4 | 2,7 | − 1,0 | − 1,9 | 8,7 | 2,5 | − 0,5 | 0,0 | 38,3 |
| Sifim 1 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 2,5 | 2,3 | 34,8 | 11,0 | − 41,1 | 11,8 |
| Correction territoriale | -1,3 | -0,6 | 5,3 | − 16,0 | − 14,6 | 2,0 | 2,9 | -0,5 | − 8,0 |
| Dépense de consommation des ISBLSM 2 | 1,9 | 2,0 | 4,6 | 0,9 | 0,0 | 2,6 | 3,2 | 4,3 | 28,2 |
| Dépense de consommation des APU 3 , dont : | 20,6 | 21,6 | 1,6 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 305,8 |
| santé | 8,9 | 9,5 | 2,6 | 2,0 | 3,2 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 135,3 |
| éducation | 7,0 | 6,2 | − 0,5 | − 0,3 | − 0,4 | 2,8 | 2,6 | 2,0 | 87,7 |
| action sociale | 1,3 | 2,3 | 4,9 | 6,9 | 4,2 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 32,1 |
| logement | 1,0 | 1,0 | − 1,0 | 6,2 | 3,5 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 14,6 |
- 1. Services d'intermédiation financière indirectement mesurés.
- 2. Dépenses de consommation des institutions sans but lucratif au service des ménages.
- 3. Dépenses de consommation des administrations publiques en biens et services individualisables.
- (t) Principaux postes concernés par les TIC.
- Source : Insee, comptes nationaux, base 2000.
Les services de télécommunications en baisse
En 2009, les achats de biens et services des technologies de l’information et de la communication (TIC) restent soutenus, mais ils augmentent moins vite qu’en 2008 : + 6,0 % en volume, après + 6,8 % en 2008. Cette progression, loin des taux de croissance à deux chiffres des dix années précédentes, reste toutefois assez forte pour contribuer à hauteur de 40 % à la croissance de la dépense totale des ménages. Les prix baissent au même rythme qu’en 2008 (− 6,5 %). Ce sont les services de télécommunications (abonnements, forfaits, ...) qui sont à l’origine du ralentissement en volume (− 0,4 % après + 3,3 %).
À l’inverse, les achats d’appareils de réception, de reproduction et d’enregistrement du son et de l’image accélèrent (+ 23,7 % après + 13,1 %), portés en particulier par le dynamisme du marché des téléviseurs (+ 35,1 %), sous l’effet de la diffusion de la haute définition dans les foyers.
Les achats de matériel de traitement de l’information continuent de ralentir (+ 8,6 %, après + 11,0 %). Les netbooks tirent le marché.
Faible croissance pour les biens et services de loisirs
En 2009, la consommation de biens et services de loisirs et de culture progresse modérément pour la deuxième année consécutive (+ 2,9 % après + 2,5 % en 2008, contre + 6,3 % en moyenne lors des dix années précédentes). Elle est soutenue essentiellement par celle des biens des TIC. Le ralentissement est net pour les jeux et jouets, même si la hausse reste forte (+ 5,0 % après + 10,0 %). La chute est marquée pour les équipements de sport, camping et plein air (− 6,7 %, soit la baisse la plus forte depuis 1980).
Pour les jeux de hasard, le rebond est marqué en 2009 : + 7,3 % après − 5,0 %. En 2008, les dépenses, notamment pour les jeux de tirage, avaient été pénalisées par la baisse de la fréquentation des cafés occasionnée par la mise en place de l’interdiction d’y fumer.
Le nombre d’entrées dans les salles de cinéma progresse de 11 millions, à 201 millions, après une progression de même ampleur l’année précédente. Mais contrairement à 2008, ce sont davantage les films américains que français qui ont attiré les spectateurs. Si, en 2009, les ventes de CD audio enregistrés restent mal orientées (− 9,2 %), celles de DVD reprennent (+ 4,3 %) après trois années de forte baisse. La montée en charge des supports haute définition (Blu-ray) est pour l’essentiel à l’origine de ce rebond. Pour la musique enregistrée, la progression des téléchargements payants est loin de compenser la baisse de la vente de CD.
En 2009, les dépenses en hôtels, cafés et restaurants diminuent de 2,6 % en volume (après − 2,2 %). Le repli est moins prononcé qu’en 2008 pour les restaurants et cafés (− 1,8 % après − 4,3 %), pour partie en raison de la baisse de la TVA sur la restauration au 1er juillet, qui a eu un effet d’incitation pour les consommateurs. À l’inverse, les dépenses en services d’hébergement diminuent davantage qu’en 2008 (− 4,5 % après − 0,4 %), sous l’effet de la baisse de la fréquentation des touristes étrangers.
L’assurance-vie et les biens et services de santé en hausse
Les dépenses des ménages en produits d’assurance-vie correspondent aux frais prélevés sur ces contrats d’épargne. En 2009, elles rebondissent (+ 16,8 %) après deux années de forte baisse (− 11,2 % en 2008 et − 3,7 % en 2007). La baisse des taux d’intérêt a fait diminuer la rémunération des livrets réglementés et rendu ainsi les contrats d’assurance-vie plus attractifs.
Les dépenses de santé des ménages, couvertes ou non par une assurance complémentaire, continuent de progresser à un rythme élevé (+ 4,4 % en volume). Il en est de même pour les dépenses des administrations publiques, c’est-à-dire pour la partie des soins remboursés par la collectivité (+ 3,2 %). Fin 2009, la campagne de vaccination contre la grippe A a contribué à ce dynamisme.
Les dépenses d’éducation des ménages, principalement financées par les administrations publiques, continuent de baisser légèrement en volume (− 0,4 %), avec la diminution du nombre d’élèves.
La consommation alimentaire se redresse faiblement, les achats de vêtements se contractent
En 2009, la consommation en produits alimentaires, hors boissons alcoolisées et tabac, accélère légèrement (+ 0,5 % après + 0,2 % en 2008). Les prix stagnent (− 0,1 %), après les fortes hausses enregistrées en 2008 sur certains produits. Ceux des produits laitiers et des œufs se replient (− 1,5 %), et plus encore ceux des fruits (− 6,4 %). La légère accélération de la consommation en volume provient pour partie des boissons non alcoolisées hors cafés, thés, cacao (+ 3,1 % après − 1,6 %). Les jus de fruits ont notamment bénéficié de températures estivales élevées. En outre, la consommation de viandes a moins baissé qu’en 2008 (− 0,3 % après − 1,2 %).
Après une baisse déjà marquée en 2008 (− 1,9 %), les dépenses d’habillement subissent un recul encore plus fort en 2009 : − 4,0 %. En période de récession, les ménages semblent arbitrer en défaveur de ce type d’achats qui peuvent plus facilement être différés.
Les produits énergétiques, alimentaires et les services financiers à l’origine du recul de l’inflation en 2009
Alors que l’indice des prix à la consommation reste globalement stable en 2009 (+ 0,1 %), le prix de la dépense de consommation des ménages recule de 0,6 % en moyenne annuelle après une hausse de 2,9 % en 2008. L’écart provient des services d’intermédiation financière indirectement mesurés, qui ne sont pas comptabilisés dans l’indice et dont le prix a fortement chuté (− 41,1 %). En effet, les marges engrangées par les banques sur les dépôts de leurs clients ont diminué mécaniquement sous l’effet de la baisse des taux d’intérêt.
En 2009, les cours du pétrole brut se sont retournés à la baisse (− 33 % en euros pour le baril de Brent après + 24 % en 2008), ce qui a entraîné un fort recul des prix des produits énergétiques : − 17,4 % pour les carburants et lubrifiants et − 5,0 % pour le chauffage et l’éclairage.
Les prix des produits alimentaires ont également contribué à la baisse de l’inflation en 2009 : − 0,3 % après + 5,1 % en 2008. Ce sont les produits laitiers qui ont le plus contribué au repli des prix alimentaires, sous l’effet notamment d’une surproduction de lait.
Si l’on exclut les dépenses en services financiers, tabac, produits alimentaires et produits énergétiques, les prix ont progressé de + 1,3 %, mais plus faiblement qu’en 2008 : + 1,5 % en 2008 (graphique).
graphiqueGraphique – Évolution annuelle des prix de la dépense de consommation des ménages

- Source : Insee, comptes nationaux, base 2000.
Définitions
Dans l’ensemble du texte, les évolutions sont en volume, aux prix de l’année précédente, sauf mention contraire.
La consommation effective des ménages est la somme de la dépense de consommation des ménages et des consommations individualisables des administrations publiques (APU) et des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM). La dépense de consommation des ménages se limite aux dépenses que les ménages supportent directement. Elle comprend la part des dépenses de santé et d’éducation restant à leur charge. Les consommations individualisables sont celles qui bénéficient directement aux ménages tout en étant prises en charge par la collectivité. C’est le cas en particulier des dépenses pour l’éducation, la santé, l’action sociale et le logement.
Le revenu disponible brut ajusté ajoute au revenu disponible brut les dépenses individualisables des APU et des ISBLSM.
Les dépenses « pré-engagées » sont celles qui sont supposées réalisées dans le cadre d’un contrat difficilement renégociable à court terme. Suivant les préconisations du rapport de la Commission « Mesure du pouvoir d’achat des ménages » (février 2008), ces dépenses comprennent :
- les dépenses liées au logement, y compris les loyers imputés et les dépenses relatives à l’eau, au gaz, à l’électricité et aux autres combustibles utilisés dans les habitations ;
- les services de télécommunications ;
- les frais de cantine ;
- les services de télévision (redevance télévisuelle, abonnements à des chaînes payantes) ;
- les assurances (hors assurance-vie) ;
- les services financiers (y compris Sifim).
Le revenu arbitrable retire du revenu disponible brut les dépenses pré-engagées.
Les dépenses de consommation des ménages en logement incluent les loyers versés par les locataires (aides au logement déduites) mais également les loyers imputés, que les propriétaires auraient à payer s’ils étaient locataires du logement qu’ils habitent.